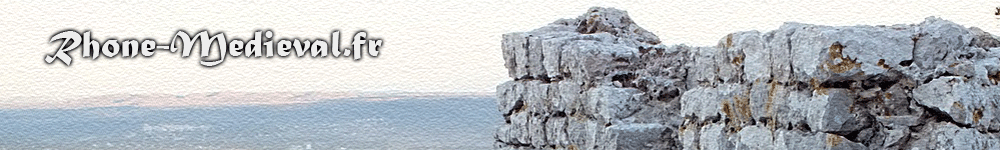Cliquez ici pour accéder à la liste des châteaux de ce département
Menthon
Photos:
- Jimre (2024)
Posté le 01-09-2024 10:04 par Jimre
Marlens Le Villard
Photos:
- Jimre (2024)
Posté le 01-09-2024 10:03 par Jimre
Cruseilles
Voici ce que dit Jean Téaldi en 1976 dans le livre: Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.
"Il reste ben peu de choses du château comtal de Cruseilles. Mais le site demeure intact, situé à l'extrémité nord du bourg. Sur deux cotés, au nord et à l’ouest, il était entouré de rochers abrupts. Celui de l’est doté d'une forte pente interdisait également l’assaut.
Le château était séparé du bourg par un mur haut de 1 70 m d'épaisseur. Le donjon, à cheval sur ce mur défendait l'entrée. Tous les murs ont disparu de la surface du sol à l'exception des restes de la courtine sud avec ce qui subsiste du donjon en saillie à l'extérieur. Louis blondel n’a probablement pas relevé le plan du château car celui-ci est beaucoup plus spacieux pue la mappe de 1730.
Son périmètre est différent. S’il est facile de reconstituer les fronts sud et ouest, au nord et à l'est par contre, il ne reste absolument rien. J'ai vainement cherché au sol des indices, même légers, qui auraient marqué l'existence de fondations sur l’espèce de Plateforme en pente rocheuse qui prolonge l’assiette du château, mais sans résultat. Actuellement, des fouilles pratiquées dans le sol pour y construire une balustrade en vue d’y installer un parc à biches, ont mis à nu des cailloux qui sembleraient appartenir à des fondations, mais tout cela est si ténu qu’il est impossible d’en faire une certitude. Pour le front oriental, le tracé indiqué est purement conjoncturel mais, comme il suit le rebord de la pente, il ne doit pas être loin de la réalité, tout comme le front ouest d'ailleurs.
Il faudrait faire des fouilles pour mettre à nu les fondations du donjon, son emplacement étant d’une épaisse couche herbeuse ainsi que le reste du site."
Source fournie par Nano.M
Posté le 07-02-2024 16:59 par Jimre
Le Château de Faverges
Le château de Faverges domine la Ville sur son promontoire au Pied de la Dent-de-Cons.
Le château du XIIe siècle se trouvait au Crêt de Chambelon.
Il servait cette époque de frontière entre le Genevois et le comté de Savoie.
En 1173. Berlion, un des premiers seigneurs, et Ponce de Faverges sont témoins du mariage entre la maison d'Angleterre avec le fils du roi Henry II à la fille du comte Humbert III.
En 1316, Amédée V s'en porte acquéreur et restaure le château.
Le château sert d'appui lorsque Amédee VII s'engage dans campagne contre le faucigny qu'il vient d'acquérir par le traité de Paris.
Le chateau reviendra à la famille Milliet en 1569 par Louis Milliet, qui sera le plus efficace collaborateur du duc Emmanuel-Philibert.
Tour à tour ambassadeur, président du Sénat. Grand Chancelier de Savoie, il sera baron en 1572.
Les Milliet de Challes et les Milliet de Faverges seront réunis par héritage en 1777
Le bâtiment, après être resté pendant Cinq générations dans la famille, passera par le mariage d'une fille Milliet à la famille du comte Leprotti di Fontanello, qui eux-mêmes le revendront aux soyeux Jean Pierre Duport.
Il est le créateur de la filature d'Annecy. Sa fille épousera Nicolas Blanc qui créera une importante soierie dans les bâtiments du château. Il sera distingué du titre de baron en 1835. Après diverses sociétés, l'activité s'arrêtera en 1976 et la commune transformera le château en maison familiale de vacances.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Posté le 05-02-2024 22:07 par Jimre
Le Château de Cornillon
Ce château était situé sur un rocher terminant la chaine de la montagne de Cou et dominant les Gorges du Borne, à l'est du hameau de Moussy sur la commune de Saint-Laurent.
Selon Louis Blondel, cet ancien château était un "véritable nid d'aigle", plus tour de guet que résidence ou logis.
Perchée à 822 m d'altitude sur ce rocher plongeant en falaise côté nord-ouest, cette tour domine non seulement tout le plateau de Saint-Laurent, mais aussi l'ensemble de la basse vallée de l'Arve et assure une vue s'étendant de Bonneville à la colline de Monthoux et au lac Léman.
On y accède par un chemin muletier reliant Saint-Laurent à Beffay, un hameau du Petit-Bornand, par le col des Gardes. Ce chemin passe tout d'abord près d'une grotte en partie cachée par des taillis.
Il s'élève ensuite rapidement et s'engage, par un col taillé dans le roc, entre le rocher de Cornillon et la mon-tagne des Pierriers.
Autrefois, ce petit col était dominé par une croix en bois. Elle figure toujours sur les dernières cartes de l'I.G.N. révisées en 1979, ancienne chapelle aujourd'hui disparue.
C'est à la sortie de ce petit col, en prenant un petit sentier, plus ou moins marqué, partant sur la gauche, que l'on parvient aux ruines du château.
Selon Louis Blondel, le château primitif, datant de l'époque romane, était formé seulement par une tour carrée irrégulière, d'environ 9 m sur 8,50 m, avec des murs de 1 m d'épaisseur.
La minceur toute relative de ces murs se comprend quand on songe que ce château était inabordable et ne pouvait être bombardé de nulle part. Il ne reste de cette ancienne tour carrée que quelques murs de fonda-tion. A l'un des angles nord de cet édifice carré s'élève un donjon circulaire, qui semble être de construction plus récente.
Voici la description de Louis Blondel qui le visita au milieu du siècle :
C'est une œuvre parfaitement bien établie, les murs s'élèvent encore à 5 m de hauteur il est éventré du côté Nord. II a un diamètre de 7,36 m avec des murs épais de 2,18 m et un vide intérieur de 3 mètres. L'intérieur est rempli de blocs dus à la chute d'une voûte sphérique dont on voit la naissance reposant sur un chaînage en tuf. Nous avons ici la disposition bien connue des donjons circulaires de l'époque de Pierre de Savoie, avec une cave surmontée d'une voûte qui la sépare des étages supérieurs.
L'appareil soigné de moyenne grandeur est bien celui du milieu du XIIIe siècle. Les dimensions de ce donjon sont peu connues mais se rapprochent de celles du châtelet du Crédo (7,68 m), mais ici, le vide intérieur est plus important, car, protégé par sa position, il n'était pas nécessaire de prévoir un siège à pied d'œuvre.
Tout le côté de l'entrée et le pourtour du donjon sont défendus par un fossé sec dont on voit encore très bien le dessin. Le glacis de ce fossé est recouvert de matériaux et il n'est pas impossible qu'il y ait eu un peu au-dessous du donjon, sur une des terrasses dominant le Borne, des constructions, communs ou dépendances. Le côté opposé est défendu seulement par un talus se prolongeant jusqu'aux parois vertigineuses du rocher. De cette position imprenable, on surveillait au loin tout le pays sans grand danger d'être surpris, car le sentier d'accès pouvait être facilement coupé. Il ne faut pas oublier que les comtes de Genève avaient dû édifier ce château pour surveiller leur frontière, le Borne formant la limite entre les possesSions du Genevois et du Fau-cigny. Cornillon est une tour de garde, sorte de vigie, bien plus qu'un château organisé.
Tour de garde ou petit château, Cornillon semble bien en tout cas être l'une des plus anciennes constructions médiévales du Genevois et du Faucigny. Contemporain du château de La Roche et du Châtelet du Crédo de Cornier, son origine semble remonter au Xie siècle. Fief des comtes de Genève, à la limite du Faucigny, Cornil-lon aurait été, selon Lucien Guy, la propriété d'une famille de Cornillon, originaire de Tarentaise, ayant pour armoiries "Trois corneilles volantes".
En 1180, un Guillaume de Cornillon est témoin d'un accord, à Genève, entre l'Abbaye d'Aulph et Amédée, sei-gneur du Lieu, en Chablais.
En 1210, Béatrice, fille du comte Guillaume 1er de Savoie, reçoit en dot Cornillon qui revient ensuite à son frère le comte Guillaume II.
Le 5 octobre 1256, Alix, comtesse de Genève, veuve du comte Guillaume II, cède à son fils, le comte Ro-dolphe, le château de Cornillon avec tout le territoire du Bornand, sous la condition que le comte paiera jus-qu'à concurrence de cent marcs d'argent, les dettes qu'elle a contractées.
Par son testament du 24 septembre 1306, Amédée II, comte de Genève, fils de Rodolphe, institue ses fils, Amédée et Hugues, héritiers de divers châteaux, entre autres, Cornillon et Rumilly-sous-Cornillon, pour le Vicomté des Bornes. A partir de ce moment, les documents se multiplient pour Rumilly-sous-Cornillon alors que le silence devient complet pour Cornillon même. Déjà la famille de Cornillon ne l'occupe plus et s'est transplantée, une branche dans la région de Sallanches et l'autre branche, à Reignier, au château de Meyrens. Le vieux château, perché sur sa montagne, n'est plus mentionné que pour désigner un fief, réuni à la seigneu-rie de Saint-Laurent et celle de Rumilly-sous-Cornillon.
Posté le 05-02-2024 21:47 par Jimre
Montrottier
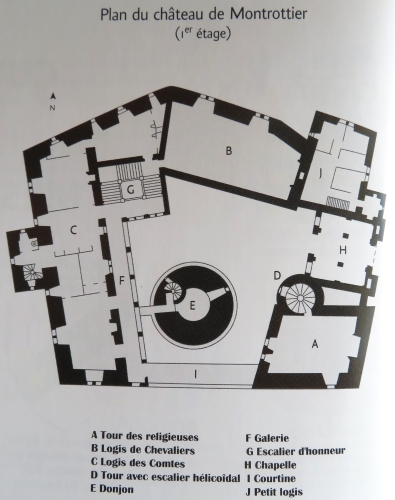
Le blason de Lovagny
Définition héraldique
Ecartelé
Au premier de Gueules (rouge) à la croix d'argent
En deux d'azur à clocher d'argent
En trois de gueules avec loup d'argent
En quatre d'azur à trois ponts d'argent posés 2 et I
En chef d'une fasce de sable (noir) semée de 5 tours d'or-
Lécu est surmonté d'un listel « Lovagny »
Signification
- Les cinq tours, en souvenir des châteaux implantés sur le territoire de cette ancienne paroisse : Montrottier, Saillon, Petit Grésy, Pontverre, Chavaroche.
- La Croix de Savoie, en souvenir de l'appartenance à l'ancien duché.
- Un clocher, en rappel de l'ancien prieuré bénédictin dont la fondation est antérieure à 1040 et qui est men-tionné dans la confirmation des biens de l'Abbaye de Savigny dans le Rhône par l'empereur Frédéric Barbe-rousse en 1162. Parmi les prieurs, on trouve : Aymon de Menthon en 1292, Janus de Pontverre en 1492, Gal-lois de Regard en 1558, qui fut ensuite évêque de Bagnoréa en Italie, près de Naples, puis secrétaire particu-lier du pape Pie V à Rome. En revenant d’Italie, séduit par l’art
De la Renaissance, ce dernier fit construire le château de Clermont en Genevois de 1575 à 1577
- Trois ponts, pour évoquer les points stratégiques de franchissement du Fier : le pont des Liasses, celui de Pontverre ou celui du Saut du Fier aussi appelé pont des Contrebandiers.
- Le loup (lupus en latin) qui se retrouve dans l'étymologie de Lovagny sous les écritures Laupanacium (village où vivent les loups), Lupania après le 3ème siècle puis Lauvaniacum Lovagniez au XVe siècle.
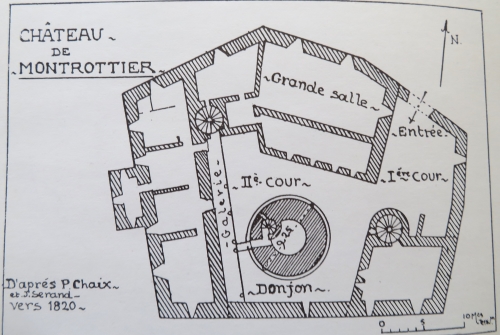
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
- Panneau trouvé sur le site
Posté le 07-01-2024 20:07 par Jimre
Chaumont
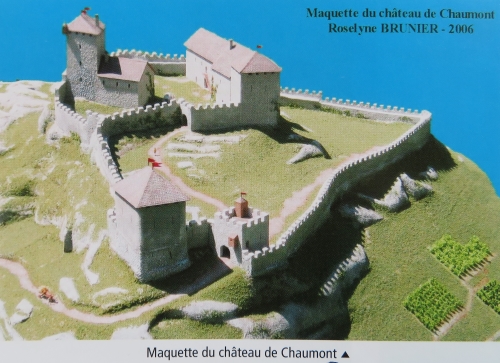
Le château de Chaumont fut construit au XIe siècle sur une butte terminant le Vuache au sud-est. Il avait une vue dominante sur les deux vallées. C'était pratique pour cet endroit de passage obligé, d'autant plus qu'il existait un péage sur la route de Chambéry à Genève. A cette époque, C'était le fief des comtes de Genève.
En 1401, il devient la propriété des comtes de Savoie.
En 1536, lors de l'invasion de la Savoie par les Français, François 1er dormira au château.
Deux fois de suite en 1589 et 1590, le château sera attaqué par les troupes bernoises et genevoises.
Pour faire bon compte, il sera rasé lors de l'invasion de la Savoie par Louis le XIII en 1630.
Chaumont sera érigé en marquisat pour la famille Thiollaz.
Il ne reste du château que quelques pans de murs en ruine.
Dès 1124, il est inféodé aux Chaumont, puis à Pierre de Bossy.
Après être revenu à la maison de Savoie et élevé en marquisat, il passera de Marc Louis Deschamps, originaire de Villefranche, à Joseph Nicolas de la Grange, également marquis du Vuache.
Les sires de Chaumont donneront deux branches principales : les Vidomnes de Chaumont et les Sallenove.
De la citadelle comtale à la ruine romantique

Le château de Chaumont présente les caractéristiques architecturales des sites castraux alpins des XIIe-Xllle s. : enceintes adaptées au relief, tour maîtresse quadrangulaire (donjon), puissante et isolée par une muraille (chemise), maçonnerie en petit appareil. La forteresse se compose d'une première enceinte (plain-château) servant de refuge à la population et accueillant peut-être les maisons de quelques familles nobles. Cette zone est surplombée par le château qui comprend la tour maîtresse, une seconde tour dite petite, un corps de logis avec salle de réception, cuisine, cellier et une seconde habitation abritant une grande salle de réception, des cuisines, un four, une citerne.
Les ruines pendant et après la restauration de 2006.
La vente du comté de Genève au comte de Savoie en 1401 porte un coup sévère à la forteresse qui perd son rôle stratégique. Elle ne bénéficie plus d'aucun perfectionnement militaire et les châtelains savoyards négligent peu à peu le simple entretien des bâtiments. Seule la tour maîtresse est encore l'objet d'attentions puisque servant de prison. Au milieu du XVIe s., les châtelains commencent le démantèlement du château et y puisent les matériaux nécessaires aux réparations de la halle de Chaumont et du moulin de Borbannaz, près du Fornant.
En 1589, bien qu'affaibli, le château protège encore le bourg. II est placé sous le commandement du capitaine Jean-Louis de Thiollaz assisté de son frère Gaspard chargé des munitions et des gens de guerre. En effet, lorsque les troupes réformées de Genève attaquent Chaumont, elles évitent le château et dirigent leur assaut contre la maison forte de Thiollaz qui est pillée et brulée.
Le château de Chaumont connaît sa dernière heure de gloire à l'été 1616, à l'occasion de la guerre que le duc de Savoie et le roi de France se livrent pour la maîtrise du cours du Rhône. Le duc de Savoie entretient une garnison de treize hommes au château avant d'ordonner la démo-lition des murailles afin d'éviter d'offrir à l'ennemi toute possibilité de retranchement. La forteresse ainsi ruinée servira dès lors de carrière et de lieux de promenade romantique alliant vestiges et panorama grandiose.
Du domaine abbatial à la chatellenie comtale
On connaît peu l'histoire de Chaumont au Haut Moyen Age. Il s'agit probablement d'une propriété des rois de Bourgogne (888-1032) puisque le domaine de Chaumont (villa Calvomonte) est attesté dès 1039 ; il doit être déjà commandé par un premier château comme le prouve un acte de 1178 relevant de l'abbaye Saint-Maurice d'Agaune (Suisse, Valais).
Au XIIe s., l'abbé de Saint-Maurice délègue ses droits de justice sur Chaumont à la famille Vidomne dont le patronyme vient de la fonction, le « vidomne » (vicedominus) étant au Moyen Age un agent seigneurial.
En revanche, l'abbé confie la protection du domaine et la garde de la forteresse au comte de Genève.
La dynastie comtale a finalement étendu sa domination sur Chaumont en obtenant la fidélité (hommage féodal) de la famille Vidomne et des autres lignages nobles du pays, en créant, au milieu du XIIIe s., une châtellenie. Ce territoire, couvrant les paroisses de Chaumont,
Clarafond, Dingy, Epagny, Frangy et Marlioz, est administré par un châtelain, fonctionnaire révocable, qui cumule les pouvoirs de commandement, de contrainte et de punition.
Pour le comte de Genève, le châtelain lève les impôts, prélève des taxes sur le commerce et les péages. Il assure la police courante, juge les causes mineures alors que les délits punissables de mort sont transmis au juge du comté. Il veille à la validité des transactions et des poids et me-sures, contraint les hommes à l'accomplissement d'un service militaire pour garder le château et surveiller les champs et les chemins.
Cette dernière obligation s'est évidemment avérée cruciale lors du conflit delphino-savoyard (1268-1355), guerre de cent ans opposant le comte de Savoie aux dauphins de Viennois et leurs alliés.
Les apports des sources manuscrites
Le châtelain « fonctionnaire » nommé par le comte de Genève puis par son successeur, le comte/duc de Savoie, est soumis à la justification annuelle de ses recettes et de ses dépenses. Ce bilan est contrôlé par la Chambre des comptes, souvent en la présence du prince. Bien que cette comptabilité ne soit malheureusement conservée pour Chaumont qu'à partir de 1352, elle se poursuit de manière continuelle jusqu'en 1528. S'y ajoutent divers comptes particuliers et inventaires, le tout sous la forme de rouleaux de parchemin et de cahiers en papier aujourd'hui déposés aux Archives départementales de la Haute-Savoie et de la Savoie.
Cette documentation considérable d'environ 9500 pages renseigne la vie sociale et économique de la châtellenie de Chaumont pendant près de 200 ans. Elle détaille les travaux d'entretien opérés sur le château : remplacement des toitures, réfection des planchers, rénovation de murs, construction d'échauguettes, etc.
Autant d'informations qui, associées aux observations archéologiques, permettent de comprendre la disposition de la forteresse et de restituer tous ses bâtiments.
La consolidation des vestiges existants
Les principales interventions ont consisté à jointoyer les parements, à injecter par gravitation un coulis de mortier de chaux hydraulique pour redonner une cohérence interne aux murailles, à consolider les fourrures des murs par une maçonnerie de blocage et à protéger le faîte des murs des infiltrations par une feuille de plomb. Les consolidations sont signalées par un retrait de 10 cm du parement original et par un enduit à la chaux imitant le cœur de mur. Les travaux de consolidation (2003-2006) s'élèvent à 170 000 euros.
72% ont été assurés par des financements publics : Conseil Général de la Haute-Savoie, Conseil Régional Rhône-Alpes, Etat (DRAC et FNADT) et 28% par autofinancement (Gaz de France, Crédit Agricole, mairie de Chaumont, propriétaire du site et la population par souscription).
Maîtrise d'ouvrage : Mairie de Chaumont avec Ké Viva Chaumont.
Maîtrise d'oeuvre : François Chatillon, architecte du patrimoine - Ferney-Voltaire 01210.
Réalisation : Entreprise Comte — 42600 Champdieu.
Etudes et suivi archéologique : Service archéologique, Direction des Affaires Culturelles, Conseil Général de la Haute-Savoie.
Ces informations proviennent largement des études des historiens Matthieu de la Corbière et Laurent Perrillat .
Sources fournies par Nano.M:
- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal,
- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,
- panneaux trouvés sur le site.
Posté le 07-01-2024 19:48 par Jimre
Pierrecharve
Les ruines du château de Pierrecharve
L'association des Compagnons du château de Pierrecharve se bat pour restaurer et entretenir cette maison forte du XIIIe siècle.
Voilà un édifice dont la sauvegarde est un combat quotidien. Celui des Compagnons du château de Pierre-charve, une association de passionnés qui a pour objectif la restauration et l'entretien de cette ancienne maison forte du XIIIe siècle, dont les vestiges se dressent sur la commune de Mûres. Il est l'un des sept châteaux qui assuraient la défense d'Alby-sur-Chéran.
Il est situé sur un rocher de molasse de 40 m de haut. Des bâtiments, il ne reste qu'une tour rectangulaire, en partie en ruine, haute encore de 17 mètres dominant la rivière du Chéran.
Source fournie par Nano.M:
- Article paru dans le Dauphiné Libéré du 20 mai 2019.
Posté le 04-01-2024 15:58 par Jimre
Thural
Maison forte de Thural ou des Thurals
Située au lieu-dit du même nom, la maison forte était une possession de la famille de Thoire et vendue à la famille de Loche en septembre 1476. Propriété de Jeanne de Loche, il arrive par voie d'héritage à sa petite fille Marie Louise Cartier Gongrain, épouse de François Joseph Gradel. Elle devient par ce mariage le berceau de la famille Gradel des Thurals.
Située sur la commune de Magland, cette tour a été modifiée profondément et à plusieurs reprises, car des dates aussi éloignées que 1620, 1624 et 1787 figurent au-dessus de deux portes et sur le linteau d'une autre.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-11-2023 09:17 par Jimre
Arbusigny
Châtelard d'Arbusigny ou du Foug
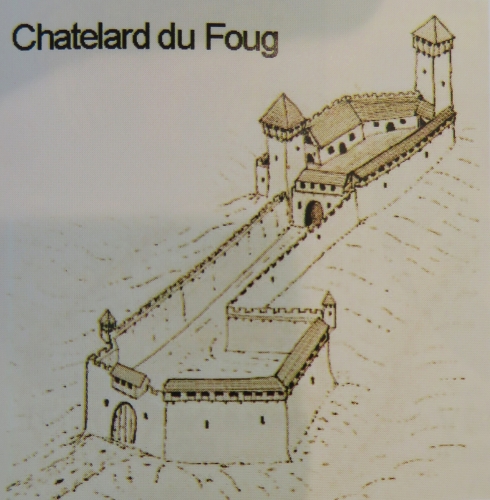
Longtemps confondu avec les ruines du Châtelet du Crédo ou Crédoz, le châtelard du Foug dépendait des seigneurs du Faucigny. En ruine depuis fort longtemps, le château du Foug appelé aussi le châtelard du Foug, existait déjà au XIIe siècle.
En 1355, il était possession de Girard de
Montfort. En 1364, il était détenu par Nicolet de Montfort.
En
1463, il est inféodé à Jean de Compey (voir notamment l'article sur Thorens-Glières, qui parle de cette famille importante de la région). Dès la fin du XVIe siècle, il était en
ruine.
Aux environs de 1613, Jacques de Gex était seigneur de Vallon, Morillon, Arbusigny, Couvette et du châtelard du Foug. Il était baron de Saint-Cristophe.
Pour finir, les pierres du château ont servi à construire les fermes en contrebas de ce dernier.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et
blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-11-2023 09:16 par Jimre
Pollinge
Château de Pollinge ou Polinge ou Pollinges
Le château de Pollinge, autrefois sur la commune d'Esserts-Salève, est situé au-dessus de Reignier en allant vers Mornex. Dès le XIVe siècle, la seigneurie relève des Chissé, originaires de Sallanches, où une tour porte encore leur nom.
En 1591, le château fut mis à mal lors de l'attaque des troupes franco-genevoises.
Il fut partiellement reconstruit par Monseigneur Granier, évêque d'Annecy et oncle de Philibert de
Chissé, en 1748.
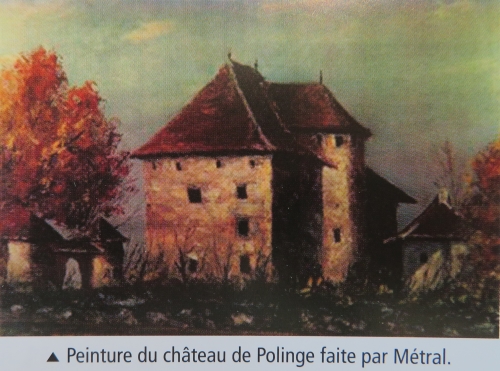
En 1830, Jean-Georges de Chissé de Polinge, dernier du nom, cède la propriété aux Constantin de Magny.
Ils le revendront eux-mêmes, en 1865, au prince Charles-Marie de Lucinge Cystria. Il fut vendu à la famille Chevallier, puis à la famille Achard.
Pas entretenu, il s'effondrera brutalement en 1977.
Il n'en reste que les deux petites tours de l'enceinte extérieure.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita,
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos :
- Nano.M (2023)
Vidéo fournie par Nano.M:
- une vidéo du château de Pollinge réalisée par Amandine C. qui parle du château.
Posté le 06-11-2023 09:05 par Jimre
Tour de Sauterens
La tour se situe entre la gare et l'église, en retrait de l'avenue de la République. Elle est connue localement sous le nom de « tour chez Bouvard ».
Le toponyme "Sauterens", à l'emplacement d'une ancienne tour, proviendrait d'un patronyme, Saltarinus. Il s'agit très probablement du dérivé médiéval de saltuarius, saltarius, qui désigne un magistrat communal, chargé des forêts, un garde-champêtre. Il semble que cette charge se soit transmise. Dans les comptes de la Châtellenie du XIe siècle, une famille Tréper (Trappier) venue du Valais s'efforça de mettre en valeur les plaines et montagnes par un défrichement (l'essartement), elle séjournait à Sauterens.
Le XIVe siècle vît naître la volonté des évêques de Genève de s'installer durablement dans la vallée de l'Arve. Le 24 septembre 1306, l'existence de la tour de Sauterens est confirmée par Amédée, comte de Genève qui testa en faveur de son fils Guillaume et le fit Seigneur de Sauterens.
Le 7 novembre 1415, François de Menthon, seigneur de Sauterens, octroie cinq florins de rente aux curés de l'église de « Rumilly » près de la maison de Sauterens. Un Pierre de Menthon, seigneur de Montrottier, Petit-Grésy, Sauterens est mentionné en 1451. Un François de Menthon, seigneur de Sauterens, Cormant et Beaumont, épouse en 1522 Louise, fille de Grégoire de Roverea, un contrat de mariage atteste cette seigneurie.
Dans les minutes du notaire d'Annecy, le tabellion Collomba, datées de 1601, on trouve une ordonnance concernant les moulins de « Borbonges », et en 1674 une vente à la Visitation d'Annecy, par Jacquet Gaspard de Montford, seigneur de Cohendier et de Sauterens.
Elle figure notamment sur la Mappe Sarde de 1730 sous le nom "tour de Sauterens". En 1748, le curé Delisle écrit que "cette construction est la plus ancienne de la commune".
Sources:
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 10-10-2023 15:41 par Jimre
Novéry
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 10-10-2023 15:29 par Jimre
Arcine
Le château de Rumilly-sous-Cornillon ou château d' Arcine
Situation
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : La Roche-sur-Foron
A la sortie de Saint-Pierre-en-Faucigny, prendre la direction de Petit-Bornand par la D12. Le château est situé à l'entrée de la route qui conduit à la vallée du Borne et surplombe la rivière de ce nom.
Propriété de M. Coblens, ne se visite pas.
Histoire
Situé sur les hauteurs de Saint-Pierre-en-Faucigny, occupant une position stratégique, aux confins du Genevois et du Faucigny, il domine la vallée de l'Arve.
C'est sur le testament du comte Amédée Il de Savoie, en 1306, que le château de Rumilly-sous-Cornillon ou d'Arcine est cité pour la première fois. Il apparaît dans de nombreux documents comme étant le centre de la châtellenie.
À partir du début du XVe siècle, le duc de Savoie, dans le but de se faire de la trésorerie, l'inféode à plusieurs reprises, tout en se gardant un droit de rachat. A cette époque, c'est une forme d'emprunt sur gages.
De 1452 à 1518, le château est aux mains des sires d’Amancy.
En 1520, il est acheté par Philippe de Savoie-Nemours (Genevois-Nemours) pour être cédé en 1528 à Pierre de La Forest, issu d'une famille de Saint-Jean-le-Chevelu (Savoie) dont les descendants survivront jusqu'en 1733, prenant le titre de comtes de Rumilly en 1681.
Il restera dans la famille jusqu'en 1753. A cette date, il deviendra la possession des Muffat de Saint-Amour, famille très riche, originaire de Megève.
En 1807, il passera aux Planchamp de Cluses et, au XIXe siècle, aux Collomb d'Arcine d'où son nom. Au décès d'Eugénie de Collomb d'Arcine, dernière du nom, il reviendra à son neveu Louis Riverieulx de Chambost.Il le revendra à M. d'Ennemont. Par sa fille, il abritera la famille de Gravilow.
Le propriétaire actuel est un Allemand, M. Hazelton.
Description
Actuellement, le château comprend une grosse tour carrée à trois étages, coiffée d'un toit d'ardoises, reliée à un corps de logis massif, dont l'angle rentrant forme une cour intérieure. Il a été entièrement reconstruit et il est difficile de retrouver l'aménagement primitif.
Sources fournies par Nano.M:
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
-Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos:
-Nano.M (2023)
Posté le 10-10-2023 15:13 par Jimre
La Pérouse
La maison forte de la Pérouse
Le
chemin du Vieux Château n’est pas facile à trouver, parce que le quartier de
Marlioz s'est densifié. Il se trouve au pied du coteau de Passy, au lieu-dit Nom, un peu au-dessus du hameau
des Outards.
Cette maison forte est probablement la plus ancienne. Elle est citée à la fin du XIIIe siècle comme possession de Rodolphe Mistralis (alias Métral) et de son neveu Amédée, premiers métrals* de Chamonix. Elle Passa ensuite à une famille de Cornillon, originaire du bas-Chablais, qui la conserva jusqu'à la Révolution.
Très
plus proche de l'état d'origine
malgré quelques transformations, c’est une bâtisse massive, rectangulaire, et flanquée d'une tour
carrée munie de petites ouvertures en façade occidentale.
Son
rehaussement par un grenier de bois et sa couverture par une toiture à deux pans
lui ont conféré une allure de ferme, donnant sur une cour fermée.
* Métral : Agent seigneurial chargé des tâches fiscales, policières et judiciaires.
Sources fournies par Nano.M:
- les châteaux et maisons fortes du Pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions des chats-huants de Charousse,
- Patrimoines des vallées du Mont-Blanc, Patrick Ollivier Elliot, Edisud.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 10-10-2023 14:57 par Jimre
Megève
Le château de Megève
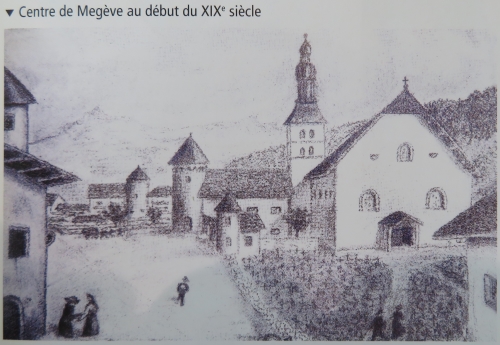
L'origine de Megève est fort ancienne puisque des documents consultés par Charles Socquet dans son livre "Megève entre dans l'histoire" datent la formation de la paroisse de Megève en 523.
Dans l'ordre, il est à remarquer une tourelle à l'angle du jardin du prieuré. Au second plan, son bâtiment avec la tour, puis la tour du Four annexée à une boulangerie, le vieux pont dit des « Cinq rues » et enfin le bâtiment et sa tour féodale érigée dès 1550.
Les maisons fortifiées de la ville étaient au nombre de douze au début du XVIIIe siècle. Il en existe encore quelques-unes, dont la tour du prieuré, la tour seigneuriale, la tour de Blay.
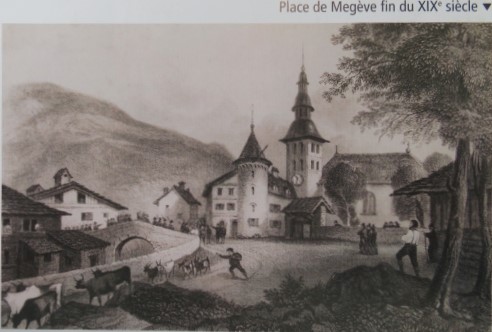
Entre les deux tours de la place actuelle, aussi bien le jour que la nuit, les belles touristes doivent impérativement "se montrer" sur cette belle place pavée à l'italienne, à la douceur de vivre et où bat le cœur commercial de la ville.
Les animations attirent toujours autant de touristes. L'une des tours agrémente la façade d'une marque de vêtements mégevanne et l'autre abrite entre autres une pharmacie. Il s'agit de la tour Magdelain.

Dans le centre-ville, en contrebas de l'église, on trouve le tour de demi-quartier ou des Comtes Capré.
A l'état d'origine malgré l'adjonction d'une toiture et de volets modernes, seul le bâtiment auquel la tour est accolée ayant été modernisé. la tour est ronde, en petit appareil irrégulier, percée de fenêtres de faibles dimensions et munie d'une porte latérale. D'autres fenêtres, plus grandes, ont visiblement été murées.
Possession des Capré, Comtes de Megève, elle fut acquise en commun en 1756 par les deux communes, de Megève et de Demi-Quartier, aujourd'hui mairie de cette dernière.
Sources fournies par Nano.M:
-châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions neva,
-Les châteaux et maisons fortes du pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions des chats-huants de Charousse.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 10-10-2023 14:48 par Jimre
Bourbonges
Le château de Bourbonges
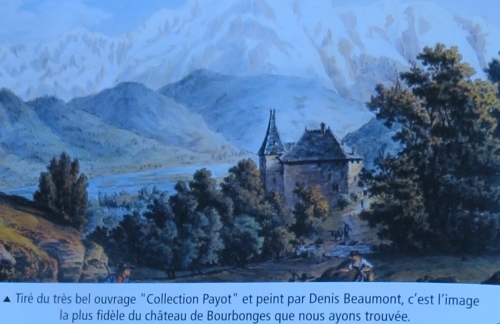
Durant l'occupation romaine, vraisemblablement sous le règne de l'empereur Vespasien, les relations entre les Ceutrons et les Allobroges étaient si mauvaises que l'Empire dut marquer leur frontière par des bornes. La plus célèbre est celle retrouvée au-dessus de Saint-Gervais, au Col de la Forclaz, datée de l'an 74, toutefois des dizaines d'autres, et probablement des centaines, jalonnèrent les limites ; elles étaient plus grossières que les bornes milliaires (qui étaient soigneusement taillées sur quatre faces), et certaines portaient distinctement la mention « AD FINES » (= aux limites).
Signalé par la pancarte, le château est dans l'intérieur du virage, réaménagé en ferme traditionnelle.
Le château
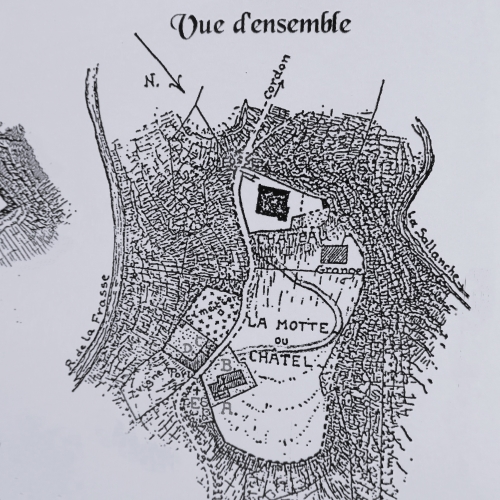
Situé à environ trois kilomètres de Sallanches en direction de Cordon, le château de Bourbonges dominait la Ville et la haute vallée de I Arve d'une bonne centaine de mètres.
Ici aurait d'abord existé un fortin burgonde, sur le resserrement qui domine les gorges de la Sallanche et de la Frasse, remplacé vers le XIe siècle par un château plus important.
Dès la fin du XIIe Siècle, Sallanches et le château étaient déjà un lieu de passage Important.
Il était le centre de la châtellenie de Sallanches et de nombreuses familles de la plus haute noblesse savoisienne ont eu possession de cette bâtisse. Il a porté différents noms le Chastel, la Motte, lieu de Gay (déformation de Gex) et enfin Bourbonges du nom d'une propriété que les Menthon possédaient à Montrottier près de Lovagny.
Détruit par un incendie, il fut reconstruit en 1263 par Pierre de Faucigny, et devint une place-forte de même importance que la forteresse de Charousse, de l'autre côté de l'Arve.
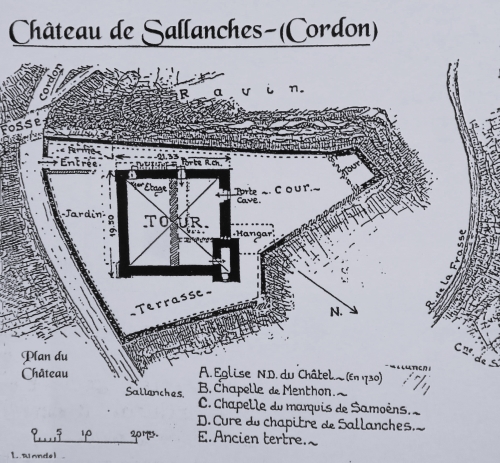
À l'intérieur de l'enceinte castrale propre se trouvaient :
- Au centre : un puissant donjon carré, d'une vingtaine de mètres de côté, avec des murs de près de 1,8 mètre d'épaisseur sur environ 16 mètres d’élévation ; un dessin ancien le représente avec des échauguettes aux angles mais il faut se méfier des images anciennes, souvent chimériques. Un solide mur de refend le divisait intérieurement en deux et améliorait sa solidité. Fin du XIVe ou début XVe siècle, l'angle nord fut renforcé par une tour rectangulaire (8 x 5 mètres au sol) à plusieurs niveaux sous voûtes :
- A l’est : un jardin
- Au Nord : une terrasse dominant la plateforme inférieure
- A l’ouest une cour triangulaire, à la pointe de laquelle s'élevait une tourelle-belvédère à plan carré, juste au droit du ravin
Il regroupait dans son plain-château, outre les Faucigny, les habitations de plusieurs familles telles que les du Châtel, les Chissé, les de La Frasse.
Après le mariage de Marguerite du Châtel avec Henri de Menthon, cette famille renforcera encore son implantation dans ce château avec le mariage de François de Menthon, fils d'Henri, avec Jeannette de Chissé.
Humbert de la Porte l'achète en 1360, cinq ans après l'incorporation du Faucigny à la Savoie.
En 1426, Pierre de Menthon, dont la famille habite dans la place depuis plus d'un siècle en fait l'acquisition et prend le nom de « Bourbonges » et donne naissance à la branche des Menthon de Bourbonges.
En 1606, François de Salles en visite à Cordon constate des conditions de vie des plus précaires pour les habitants du bourg situé à 2 km du château, en un lieu beaucoup moins accidenté que celui du château.
En 1746, Joachim de la Grange achète la bâtisse au comte Bernard de Menthon, puis elle est acquise par les La Tour, qui la revendent en 1768.
Une petite chapelle, Notre-Dame-du-Château, construite par la famille de Menthon, abritait les sépulcres de plusieurs générations.
Accidenté une première fois par un tremblement de terre, sans intérêt militaire, le château fut progressivement démantelé et transformé en ferme, et courant XIXe siècle, les restes de la tour annexe furent plus ou moins abattus par un chercheur de trésor.
Le château de Cordon le fut une seconde fois et c'est avec les pierres récupérées que le chalet ci-dessus a été construit.
Début XXe siècle, on voyait encore des vestiges de l'enceinte et du portail méridional. Aujourd'hui, fors la pancarte et l'épaisseur des murs (qui se discerne peu de l'extérieur !), le bâtiment n'a plus grand-chose de castral.
On peut encore voir une belle cave à voûte, une porte en tiers-point du XIVe siècle et quelques ouvertures apparemment anciennes. Si ses reliquats sont infimes, il n'en reste pas moins que ce château a eu une belle et glorieuse histoire. Le propriétaire actuel est M. Bottollier-Veuvaz. La fermeture de la porte d'entrée est originale. Cela consiste en une poutre de section carrée fixée coulissant sur la porte et qui vient s'encastrer dans le mur assurant ainsi une fermeture inviolable.
Restent la position du château dominant les deux gorges (il suffit d'ailleurs de voir comment doit se faufiler la route moderne, pour en comprendre l'intérêt) et, sans doute, d'ultimes moignons de l'enceinte reconvertis en terrasse dans la boucle.
De l'autre côté de la route, le petit édicule sur deux niveaux porte la date 1894 ; il a apparemment récupéré des éléments de constructions démontées - une baie tréflée et deux bouches de tir en face nord - et ressemble à une chapelle, ce qu'il ne fut jamais.
Feue la chapelle Notre-Dame-du-Château
En face du « château », citée dès le XIIe siècle, Notre-Dame-du-Château était de style roman, avec un chœur voûté très massif. Au bas Moyen Âge, on lui accola un porche gothique encadré de pilastres, un auvent décoré d'une frise, et un clocher à flèche très élancée.
Tout ayant été démonté pour construire Notre-Dame-de-l'Assomption, on ne voit plus rien sur le terrain, si ce n'est, à l'aval, quelques murs de soutènement que la route moderne n’a pas détruit.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,
- Les châteaux et maisons fortes du pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions les chats-huants de Charousse.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 10-10-2023 09:20 par Jimre
Maison forte de Chedde dite de Montfort
La maison-forte de Chedde ou tour de Chedde, dite de Montfort
Elle est située au pied du coteau de Joux et a subi dans le temps quelques transformations depuis sa construction (recrépissage, toiture).
Une petite maison-forte du XVe ou XVIe siècle, bien classique avec sa tourelle carrée plaquée en milieu de façade, à la face ouest duquel est accolé un second de plus petite dimension.
Edifiée au XVe ou au XVIe siècle, ce fut la dernière demeure de la famille de Montfort. Son dernier descendant, le Noble de Bieux, devenu Comte de Flumet en 1681, la vendra en effet en 1738 au Couvent des Ursulines de Sallanches, qui ne l'occupera d'ailleurs jamais.
Une toiture XVIIIe à quatre pans cassés lui confère un air bourgeois. Vendue ensuite à la Révolution, sous le titre de biens nationaux, à un bourgeois de Sallanches. En 1880, elle appartenait à une famille de cultivateurs du hameau de Joux.
Sources fournies par Nano.M:
- Patrimoine des vallées du Mont-Blanc, Patrick Ollivier Elliot, Edisud,
- Les châteaux et maisons fortes du pays du Mont-Blanc, Dominique Dilphy, éditions des chats-huants de Charousse.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 08-10-2023 14:44 par Jimre
Commanderie Hospitalière de Moussy
Au bord de la route, dans le petit village de Moussy, commune de Cornier, vous pourrez contempler à loisir une commanderie religieuse de l'ordre des Hospitaliers, comparaison à faire avec l'ordre des Templiers, l'importance et la célébrité mises à part.
La face nord nous laisse découvrir une porte de style roman, alors que sur le côté sud apparaît une ouverture plutôt de style gothique.
Les piliers sont en calcaire dur, et les murs en molasse. Sous les avant-toits, une grande quantité de symboles maçonniques sont taillés en relief tout autour du bâtiment.
On sait peu de choses sur cet ordre religieux. Il y a deux propriétaires différents actuellement, un au sud, l'autre au nord. Leurs prédécesseurs ont découvert, en faisant des travaux, que les membres de cet ordre se faisaient enterrer à l'intérieur de ce bâtiment où il y avait une petite chapelle.
Dès 1262, nous trouvons mention dans le testament d'Agnès de Faucigny de la chapelle de Vège, ci-contre.
Elle était placée, comme c'était la coutume, sous la protection de saint-Lazare et sainte-Madeleine.
C'est d'ailleurs "La Madeleine" le nom du petit hameau à deux pas de la chapelle de Vège.
De la léproserie qui était attenante, il ne reste rien.
Par contre, la chapelle, rachetée et transformée en lieu d'habitation, a été très bien restaurée.
Ancienne léproserie qui faisait partie de la chapelle de Vège
La face nord nous laisse découvrir une porte de style roman, alors que sur le côté sud apparaît une ouverture plutôt de style gothique.
Les piliers sont en calcaire dur, et les murs en molasse. Sous les avant-toits, une grande quantité de symboles maçonniques sont taillés en relief tout autour du bâtiment.
On sait peu de choses sur cet ordre religieux. Il y a deux propriétaires différents actuellement, un au sud, l'autre au nord. Leurs prédécesseurs ont découvert, en faisant des travaux, que les membres de cet ordre se faisaient enterrer à l'intérieur de ce bâtiment où il y avait une petite chapelle.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 08-10-2023 14:36 par Jimre
Amancy
Château d’Amancy
Nous ne possédons que peu de notes concernant le château du Carroz, ou du Quarre. Il est visible depuis la départementale qui passe au bas de La Roche-sur-Foron. Il aurait été la propriété de noble Favre d'Usillon.
Sa construction remonterait au XVIIe siècle.
Largement transformé, il a été récemment vendu en plusieurs appartements.
Il a appartenu à la famille de Thoire, puis aux de Benevix.
Au centre du village se trouve le château d'Amancy.
Le propriétaire en est M. Hintermann, un Suisse-Allemand.
Les historiens présument que le bâtiment a été le berceau de la famille de Vège.
Le hameau de Vège, non loin de là, a donné son nom à cette famille qui, par l'exercice du notariat et du sacerdoce, a su s'élever à la noblesse des années 1546 à 1563 où ils reçurent leurs patentes.
La pierre tombale de noble Nicod de Vège, décédé en 1 514, se trouve à l'entrée de l'actuelle église d'Amancy.
Le plus célèbre membre de la famille, Guillaume de Vège, au XVIe siècle, était un ecclésiastique qui reçut, du pape Clément VII les plus hautes distinctions, dues à ses mérites personnels.
On citait autrefois le château de Boex sur la commune actuelle d'Amancy.
Le blason des seigneurs d’Amancy a été repris par la commune.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 08-10-2023 14:34 par Jimre
Lullin
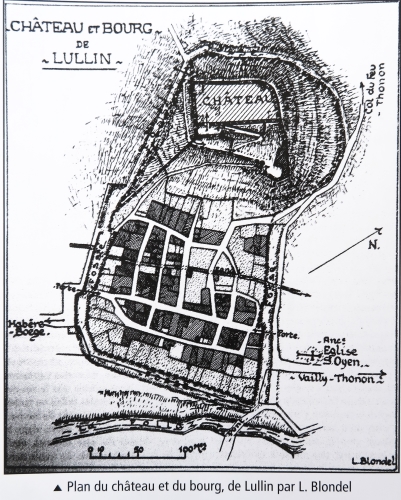
Le nom primitif du bourg était Saint-Oyen, soit « Sancti Eugendi de Lullino ».
Le château de Lullin, actuellement en ruine date du XIVe siècle.
Il est qualifié de "bâtie" à cette époque. En 1305, le dauphin Hugues de Faucigny, allié du comte de Genève contre les comtes de Savoie, fait édifier la forteresse.
II sera assiégé et bien endommagé. En 1308, Lullin est annexé par la Savoie, mais le château reste possession des sires de Faucigny.
Il est inféodé en 1345 aux seigneurs de Fernay. Par le mariage de Guillemette, fille de Jean de Fernay, avec Thomas de Genève, le château revint aux Genève-Lullin. L'extinction de cette famille voit le château venir dans le giron de la famille d'Allinges, marquis de Coudrée.
Sources fournies par Nano.M :
- Châteaux, vieilles pierres et blasons savoyards, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 17:27 par Jimre
Montforchat
Château de Montforchat ou Montforchet ou Montforchier
Les
ruines s'élèvent à 1545 mètres, au sommet du mont Forchat dominant les vallées d'Habère
et de Lullin et toute la région du Chablais.
Histoire
L'histoire
de cette fortification, élevée à la limite des Etats du Faucigny et de la
maison de Savoie, est obscure ; sa construction est vraisemblablement
contemporaine de celle du château de Lullin en 1305, mais aucun texte ne le
précise.
En
1307, le château qualifié de " bâtie " subit un siège et fut brûlé
par les troupes du comte de Savoie : « quando Montforchia fuit combustum per gentes
domini comitis Sabaudiae ».
Montforchat
était situé sur des possessions de l'abbaye d'Aulps, un texte de 1320 spécifie
que la fortification a été édifiée en partie sur leur terre et leur propriété.
Après transaction, est décidé que le château restera aux mains du seigneur de
Faucigny.
Celui-ci ne désirant pas garder cette seigneurie l'inféode avec celle de Lullin à Humbert de Cholay en 1322. Puis, ces biens passent à Nycod de Fernay par Guillemette de Fernay, puis à Thomas de Genève-Lullin. Cette famille conserve la propriété jusqu'au XVIIe siècle ; elle revient ensuite aux Gerbaix de Sonnaz, d'Habère.
Après
avoir organisé de nombreux sermons et missions, François de Sales convertit le
Chablais au catholicisme en septembre 1598.
Pour célébrer son tricentenaire, 3 paroissiens de Lullin prénommés François et sous le contrôle du Curé Gaillard, décident à l'été 1898 d'édifier une statue est érigée à l'emplacement des ruines en l'honneur de leur Saint Patron François de Sales. Les fossés sont comblés et les pans de murs sont détruits pour aménager une terrasse formant belvédère.
Après
2 mois de travail intense soutenu par des bénévoles du village, une statue en
bronze de 700 kg posée sur un piédestal de 5 m de haut est installée. Le 21
septembre 1898, Mgr Philippe, entouré de quelques 2000 paroissiens, bénit
solennellement la statue de Saint-François de Sales.
Depuis, et chaque année le dernier dimanche de juillet, un pèlerinage est célébré à la chapelle avec une procession jusqu'à la statue.
Description
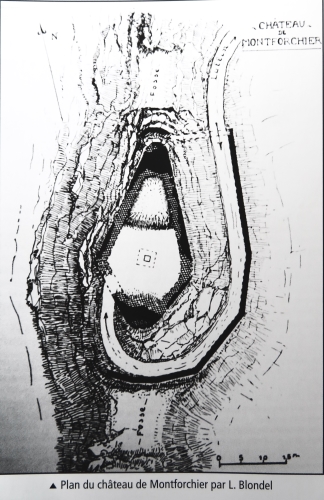
La
forteresse présente un plan original, en forme de losange, épousant les
contours du rocher.
Elle
mesure 41 mètres dans son axe longitudinal et 21 mètres de large. Elle était
défendue par de profonds fossés taillés dans le rocher et par une enceinte
maçonnée sur les faces est et sud, les plus accessibles.
Cet
ouvrage aujourd'hui détruit était remarquable par la puissance de ses éléments
défensifs et par sa situation en altitude.
Sources fournies par Nano.M :
-châteaux,
vieilles pierres et blasons de huate-Savoie, Jacques Grombert, éditons Neva,
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
-Châteaux
de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 17:19 par Jimre
Marcossay
Château
de Marcossay ou Marcossey
Marnaz
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville, Canton : Scionzier
C'est
sur le territoire de Marnaz qu'est situé le fief de Marcossey, domaine de 90
poses (270 ha) « tant prés que bois », d'un bon rapport avec maison et autres
édifices, et qui appartenait jusqu'en 1369 au comte de Savoie. II l'échangea
alors avec des terres possédées par les Chartreux et dispersées dans différentes
communes d'Arenthon à Samoëns et à Sallanches.
Avant
cet échange, ces biens semblent avoir été inféodés à une famille Fournier de
Cluses, différente de celle qui reçut le fief de Marcossey à Viuz-en-Sallaz. On
peut lui rattacher Guillaume de Marcossey, évêque de Gap au milieu du XIVe siècle,
nommé évêque de Genève en 1366. Il transmit le fief à son neveu Girard qui,
voulant participer avec le comte Amédée VI à l'expédition de Naples et de
Tunis, testa vers 1355 en faveur de son frère Ivan de Marcossey, chanoine de
Genève.
Girard
fut enterré dans la chapelle qu'il avait fondée dans l'église de Scionzier.
Quelques
pans ruinés du château existeraient encore au bord de l'Arve en aval de Marnaz
et en face de l'église de Thyez, au lieu-dit " Les Mues".
A noter : Lorsque les seigneurs de Rocafort à Boëge ont quitté le château, ils sont venus s'installer au château de Marcossay.
Source fournie par Nano.M :
-
Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot,
éditions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 16:56 par Jimre
Thy
Château du Thy
Le château du Thy ou de Thiez, situé à environ 500 mètres au sud-ouest du village de Ville-en-Sallaz, au bord du ruisseau du Thy, a été édifié au XIIe siècle par la famille de Faucigny. Il devint ensuite la propriété des évêques de Genève. La maison forte est citée implicitement au mois d'octobre 1257, lors d'un séjour de l'évêque Aymon de Grandson, dans un échange intervenu entre l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune et Pierre II de Savoie. Elle est mentionnée le 17 juillet 1276 dans l'abergement concédé par l'évêque Robert de Genève [in domo nostra de Tez].
Au mois d'août 1291, le dauphin de Viennois Humbert I de la Tour du Pin investit la terre de Sallaz, enlève le château et y place une garnison. Excommunié, il doit rétrocéder le mandement et sa maison forte.
Après la Réforme, La maison forte servit de prison épiscopale, puis fut laissée à l'abandon.
Sur la commune de Viuz, au lieu-dit " Bregny", existaient une seigneurie et un château bâti par les seigneurs de Boëge au XIIe siècle, les documents citent les Chedal et fut également possession de l'évêque de Genève.
Source fournie par Nano.M :
- Châteaux, vieilles pierres et blasons savoyards, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 16:44 par Jimre
Montanier
Château de Tournelette ou de Montanier ou de la Tornalta
Situation
Samoëns
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville, Canton : Samoëns
L'emplacement du château se situe sur un rocher dans l'actuel parc alpin de la Jayssina. Cette butte rocheuse qui domine le village est un lieu chargé d'histoire. C'est là que se dressait ce château des Sires de Faucigny, appelé château de Montanier. Il commandait au Moyen-Âge le bourg de Samoëns et la haute vallée du Giffre.
D’origine probablement antérieure, cette fortification apparait au XIVe siècle comme résidence des sires de Faucigny. Il est en effet mentionné pour la première fois dans un document en 1309. Hugues le dauphin, seigneur de Faucigny, épouse Marie, fille d'Amédée comte de Savoie et lui accorde en dot une hypothèque sur le château de Samoëns castrum Montanerii.
Acquis par les comtes de Savoie avec l'ensemble du Faucigny en 1355, le château est devenu un siège de l'administration savoyarde.
Après 1355 et l'annexion du Faucigny par la Savoie, les comptes de châtellenie mentionnent de nombreuses réparations. En 1431, le duc Amédée VIII autorise les habitants du bourg à élire leurs syndics.
En juin 1476, les troupes du Haut-Valais, en guerre contre le Duché de Savoie, ont envahi la vallée du Giffre. Le 11 juin, ils incendièrent le bourg de Samoëns et détruisirent le château de Montanier.
Celui-ci ne semble jamais avoir été reconstruit.
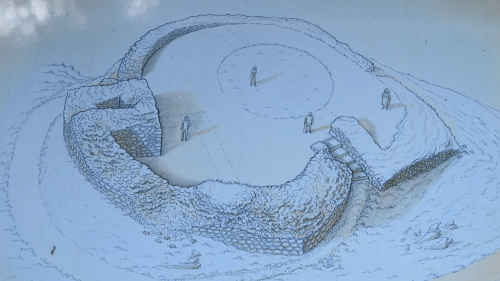
Cette demeure seigneuriale qui constitue le centre d'un mandement est inféodée à différentes familles.
En 1699, le mandement est érigé en marquisat puis vendu à la commune de Samoëns en 1754. Au XVIIe siècle, les sires de Gex, seigneurs de Vallon, joueront un rôle important à Samoëns.
Entre 1903 et 1906, l'architecte Jules Allemand, engagé par Madame Cognacq-Jay pour convertir le site en jardin botanique, a choisi de couvrir les anciens vestiges d'un pittoresque auvent de fonte et béton.
Description
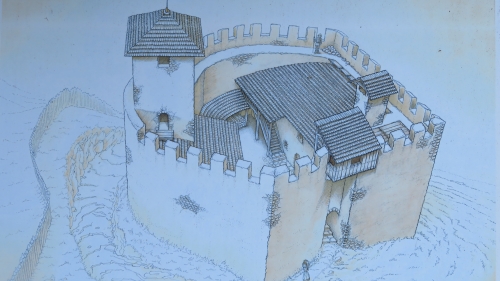
Singulier dans son implantation, vu qu'il était pratiquement rond, ce château, construit en pierre, était défendu par un mur d'enceinte portant des créneaux. Il possédait un corps de logis de trois étages qui s'appuyaient à la muraille au sud, et une tour carrée de 4,50 m de côté au nord, qui faisait office de donjon.
Assis sur son promontoire rocheux, alors dépourvu de végétation, le château devait avoir l'apparence d'une grosse tour massive. La face septentrionale, la plus vulnérable, était défendue par un fossé.
Modeste mais d'allure défensive, l'édifice était un siège de surveillance et de commandement. Le site et la configuration, l'absence de point d'eau proche devaient en faire une construction au confort sommaire, plus propice à la vie de garnison qu'à la vie de cour.
Ses ruines sont restées apparentes, au sommet de la butte, et c'est de façon postérieure qu'elles auront reçu le nom de La Tornalta, en souvenir de l'ancienne tour qui se dressait là.
De nos jours, il ne reste pratiquement rien de cette bâtisse qui jouissait d'une vue très étendue sur les environs, à part des morceaux de l'enceinte, située dans le parc de la Jayssina.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita.
- Panneaux présent sur le site. Nous avons inséré dans l'article des illustrations de David Fert, proposées par la commune de Samoëns et son service du patrimoine, qui sont une tentative de reconstitution. Elles s'appuient sur des descriptions issues d'enquêtes du XIVe siècle et sur les observations rapportées par l'archéologue Louis Blondel (1956). Cette approche met à profit toutes les données existantes sur le tracé, les dimensions et formes de l'édifice.
Elles s'inscrivent dans les proportions des remparts, du corps de logis et de la tour, traduites d'après des mesures anciennes exprimées en toises et en pieds. Elles comportent une part d'interprétation.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 16:23 par Jimre
La Tour
La Tour
Trônant au centre du village de Samoëns, le château de la Tour, autrefois propriété de la famille de Gex, est devenu en 1842 et après réfection, la mairie du village.
À l'origine, il appartenait aux Faucigny-Lucinge.
En 1555, la ville est possession de Jacques de Genevois-Nemours.
En 1574, il procède à un affranchissement collectif et les premiers bénéficiaires de cette mesure furent les membres de la famille Jay. Pierre Jay obtint les patentes de lieutenant châtelain. Un siècle plus tard, Michel Jay est scelleur (garde du sceau), son fils Charles est châtelain. En 1540, il achète aux Lucinge, criblés de dettes, la maison forte de Lucinge à Samoëns et la seigneurie de Vallon.
Après avoir habilement manifesté son attachement à la maison ducale en exil pendant la guerre contre les Français, Charles Jay alias Charles de Gex se trouve récompensé par un ennoblissement en 1563 par les souverains revenus d'exil. Il l'acquit, après avoir levé une milice contre les Bernois, mais sans effusion de sang, puisque tout ce beau monde s'était arrêté à Saint-Jeoire, une solide réputation guerrière.
En 1622, devenus barons de Saint-Christophe, ils tiendront rang jusqu'au XVIIIe siècle. Nous en voulons pour preuve la découverte faite sur un vitrail de l'église de Samoëns. Sur ce vitrail, nous supposons qu'il s'agit du blason de cette famille.
La façade nord du château de la Tour montre bien la forme en L du bâtiment, cachant dans son angle interne une tour carrée de la mème hauteur que le bâtiment.
Source fournie par Nano.M :
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 10:09 par Jimre
Choisy
Château de Choisy
Situation :
Choisy
Haute-Savoie - Arr. : Annecy, Canton : Annecy-le- Vieux
Le château occupe une position isolée, au bord de la RD 3, en contrebas du village de Choisy.
Sa fonction a toujours été résidentielle. Il n'a donc jamais eu de rôle défensif.
Propriété privée.
Histoire :
La commune de Choisy conserve deux châteaux, le plus ancien est celui de La Vulpillière ou de Rossy, dont le premier propriétaire serait le seigneur du même nom.
Le village de Choisy fait partie, donc, de la seigneurie de la Vulpillière, qui passe au XIIIe siècle à la famille des seigneurs de Compey pour qui le comte Gérold de Genève construisit le château de Thorens. En 1508, le château est racheté par un seigneur de Choisy : Louis Reydet.
Le château de Choisy ou de la Balme, bâti en 1559, est la propriété de notaires originaires de Bonneville. Devenu président du Conseil présidial du Genevois lorsque le duc Emmanuel-Philibert crée le Souverain Sénat de Savoie, Catherin Pobel achète en 1557, au père de saint François de Sales, la juridiction du fief de Choisy. C'est à cette époque qu'il fait construire le château qui marque l'aboutissement de l'ascension sociale de la famille.
Son fils Thomas sera évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, et sa fille Louise épousera Louis Reydet à qui elle apportera le château de Choisy.
Originaire de Saint-Sigismond-sur-Cluses, notaire de la Chambre apostolique à Rome, Louis Reydet a été anobli en 1560 et a acheté la seigneurie de la Vulpillière en 1568.
Il est la souche des Reydet de la Vulpillière, branche ainée de la famille, et des Reydet de Choisy, branche cadette qui s'éteindra avec Jeanne-Françoise, élevée au rang de comtesse de la Balme en 1681, et mariée au marquis d'Allemogne, André-Gaspard de Livron. Elle est déjà veuve lorsqu'elle hérite du château.
Ses trois fils étant morts sans postérité, Choisy reviendra à sa fille Marguerite, épouse d'Edmond de Conzié.
Devenus, par cette alliance, marquis d'Allemogne, comtes de la Balme et seigneurs de Choisy, les Conzié conserveront le château de Choisy jusqu'à la Révolution française. Depuis, il a été transformé en exploitation agricole.
Description
Cet édifice se dresse encore avec ses quatre tours rondes, mais il a été très remanié pour accueillir une exploitation agricole. Il offre dans son état actuel de beaux vestiges de l'architecture du XVIe siècle.
Le château de Choisy est une massive construction quadrangulaire que complète le bâtiment de la chapelle.
La porte du château présente le plus beau décor architectural que la Renaissance ait produit en Savoie. Ses pilastres cannelés, à chapiteaux d'ordre toscan, supportent un magnifique entablement dont la frise fait alterner triglyphes et métopes, celles-ci étant décorées de deux rosaces et d'un bucrane. Le fronton triangulaire entoure un blason aux armes familiales.
Le portail d'accès, flanqué de deux constructions basses, dont l'une abrite le four, il s'ouvre dans une tour faisant fonction de pigeonnier. II est surmonté des armes de Louis Reydet et de Louise Pobel.
Quand on entre, la cour est encadrée par les communs à gauche et par le château proprement dit à droite.
A l'intérieur, on remarque un bel escalier, une porte dont I 'encadrement est décoré d'entrelacs, et une autre dont seul le linteau est orné : elle porte la date de 1559.
Au rez-de-chaussée, le splendide manteau d'une cheminée est richement agrémenté de stucs dont les motifs raffinés sont uniques en Savoie. Il y a là une qualité artistique bien supérieure à ce qu'on peut voir au château de Clermont, bâti une vingtaine d'années plus tard.
A noter que le Château de Choisy est appelé par les autochtones le château Perroud.
Le porche-colombier du château en réparation. II est redevenu une résidence après avoir été transformé en exploitation agricole.
Les annexes du château ont également été restaurées.
La cheminée Renaissance du château est inscrite aux Monuments historiques depuis 1982.
Sources fournies par Nano.M :
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita,
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 10:04 par Jimre
Pontverre
Château de Pontverre
L'ancien château de Pontverre ou " pons vitréus " dominait un pont enjambant le Fier. Il appartenait à la famille de Pontverre, citée au XIIIe siècle et possessionnée en Valais, au château de Saillon et à Cruseilles, où subsiste encore le château de Pontverre. On retrouve également cette même famille à Ugine en Savoie où le comte de Savoie, Thomas Ier concède le château à Aymon de Pontverre en 1221.
Le château de Pontverre est mentionné en 1305. Il s'agit d'une reconnaissance passée par Jean de Pontverre en faveur du comte Amédée de Genève avec reconnaissance d'hommage. Même reconnaissance avec Guichard de Pontverre en 1340.
Ces seigneurs, bien implantés dans l'ancien comté de Genève et dans le comté de Savoie, s'éteignent au XVIe siècle, après avoir été propriétaires du château de Chavaroche, situé non loin de celui de Pontverre.
Les vestiges de la fortification sont encore visibles sur un promontoire dominant les gorges du Fier, on peut identifier des pans de mur assez grossiers, mais le plan de la fortification n'apparait pas très clairement.
On peut encore citer, sur la commune de Lovagny, le château de Saillon, totalement disparu et la tour du Petit Grézy, située au pied de la rampe de Montrottier et en ruine.
Sources fournies par Nano.M :
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
-Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 09:28 par Jimre
Cluses
Château de Cluses appelé aussi le château de Chessy
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville, Canton : Cluses
Les ruines dominent la ville, sur le rocher de Chessy, juste au-dessus de l'actuel Office de Tourisme. Il était très important autrefois, car il marquait la limite entre la haute et la basse vallée de l'Arve.
Propriété privée.
Histoire
La situation géographique exceptionnelle de cette ville lui valut, dès l'époque romaine, une importance stratégique toute particulière. Elle commande en effet la cluse de l'Arve et le pont franchissant cette rivière.
Cluses est citée en 1200 où l'on mentionne le pont sur l'Arve et le château de Châtillon, situé plus haut et décrit alors comme étant une possession des seigneurs de Faucigny.
La fortification qui fait l'objet de cette étude s'élevait au sud de la ville, sur le roc de Chessy surplombant l'Arve et isolé par des pentes abruptes.
Il est possible que la famille de Chissier soit à l'origine de ce château, mais nous ne pouvons l'affirmer. Très tôt, il fut inféodé à différentes familles mais il relevait des Faucigny. Il passa ensuite aux mains de la maison de Savoie ; il est de nouveau inféodé aux Chissé, puis le souverain Victor-Amédée vendit Cluses et Châtillon à Joseph du Fresnoy, seigneur de Chuyt en 1700. La seigneurie est érigée en marquisat à cette époque et transmise par héritage à noble Joseph Planchamp.
La forteresse fut assez rapidement supplantée par celle de Châtillon, située hors de la ville, néanmoins le mandement de Cluses et la châtellenie de Châtillon seront toujours réunis.
Description
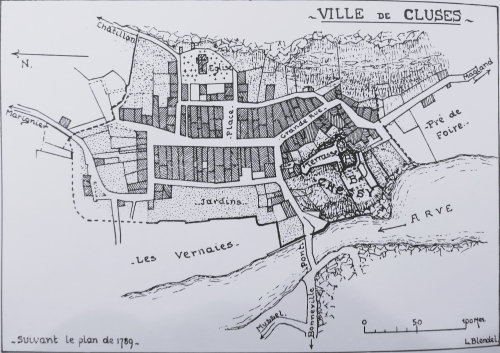
Le rocher de Chessy, bien défendu par ses pentes naturelles, a servi d'assiette à la fortification comprenant une première cour avec les logis seigneuriaux et un peu plus haut une forte tour carrée reliée à l'enceinte et constituant le donjon.
La bâtisse imposante, accolée à une terrasse fortifiée de 33 m de longueur et adjointe d'une grosse tour quadrangulaire, en faisait une fortification puissante, facilement sécurisée.
On accédait au château par le sud, après avoir gravi un chemin tournant. Des vestiges de murailles et l'importance des bases de la tour nous laissent présager qu'il s'agissait d'un château de grande ampleur.
Le pont de Cluses
On retrouve également sur la carte de L. Blondel le vieux pont de Cluses. Il est toujours gaillardement debout.
Avant le grand incendie de 1845, une grande partie du bourg de Cluses se développe aux abords de cet ouvrage. Il en constituait une porte d'entrée modeste, pourtant son emplacement n'en n'était pas moins stratégique grâce à la route qu'il ouvrait en direction des villes de Magland et Sallanches.
Une première mention d'un franchissement à cet endroit date de 1225. Des passerelles en bois puis des ponts en planches sont dressés successivement sur ce resserrement rocheux.
En 1626, le pont s'effondre une nouvelle fois, il faut attendre 47 ans pour qu'il soit remplacé. Le nouvel ouvrage est conçu en 1673 par l'architecte François Cuenot, l'ingénieur des travaux publics le plus renommé de Savoie à cette époque. C'est Charles Barbier, maçon originaire de Sixt qui est chargé de son édification.
Il est rénové en 1833. Dès lors, il fait l'objet de travaux d'entretien réguliers. La proximité d'une grande usine de décolletage, les Établissements Carpano, et la construction de la ligne de chemin de fer après 1893 sur cette section, rendent obsolète ce point de passage.
Il est fermé progressivement à la circulation routière avec le percement de l'autoroute Blanche entre 1973 et 1976 et condamné avec la mise en place d'un nouveau plan de circulation urbaine dans les années 1990.
Il participe cependant à la vie des habitants de Cluses en devenant un espace apprécié des promeneurs, des sportifs et des cyclistes. Ses nouveaux usages récréatifs sont pris en compte dans le projet de restauration du pont.
Sources fournies par Nano.M :
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
- Panneaux dans la ville
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 06-09-2023 09:02 par Jimre
Château de Pierrecharve
Situation
Haute-Savoie - Arr. : Annecy
Canton : Alby-sur-Chéran
Mûres
Pierrecharve ou Pierre-Charve se situe sur le territoire de la commune de Mûres, sur la
rive droite du Chéran. Il est juché sur un rocher dominant ce torrent d'une
soixantaine de mètres.
Le château de Pierrecharve, qui signifie étymologiquement
"pierre chauve", n'est plus représenté que par une tour perdue au
milieu de la nature et abandonnée.
Il gardait un pont de bois qui permettait de franchir le
torrent en un point où son cours est assez resserré.
Actuellement, il est très isolé et perdu dans la végétation.
Propriété privée.
Histoire
L'origine de la construction de Pierrecharve est mal
connue. Si l'on en croit M. Coutin, le bâtiment, au XIIIe siècle, était la
propriété de Guillaume Paradin, qui le cédera au troisième fils du comte Amédée
III de Genève, Jean de Genève, seigneur d'Alby.
Au XVe siècle, il est entre les mains de la famille de La
Rochette qui possède aussi le château de la Pesse à Annecy-le-Vieux.
Par le mariage de Jacqueline de La Rochette avec François de
Montfalcon de Flaxieu, le château de Pierrecharve entre dans les possessions de
la puissante Maison de Montfalcon, tout comme le château de la Pesse.
Le frère du nouveau seigneur de Pierrecharve est Mgr Aymon de
Montfalcon, évêque de Lausanne, où il entreprend d’Importants travaux à la
cathédrale.
Description
La fortification a subi de multiples adjonctions et
modifications, ce qui lui confère une allure assez particulière avec son toit à
deux pans et ses fenêtres vitrées. On peut encore apercevoir, de-ci de-là,
quelques détails trahissant l'ancienneté de la demeure.
Les murs sont en petit appareil, recouverts d'un enduit
récent, tandis que les chaînages d'angle sont en blocs de molasse usée par le
temps. Au rez-de-chaussée, s'ouvre une porte en arc brisé surmontée d'un arc
plein cintre en molasse qui suggère à n'en pas douter les modifications
successives subies à l'emplacement d'une ouverture plus ancienne.
Au-dessus, deux baies rectangulaires à meneaux ont été
ouvertes, succédant sans doute à des archères anciennes. Des embrasures de tir,
rappelant le rôle défensif de la tour subsistent sur une face.
Cette construction d'environ 8 m de côté repose sur le
rocher qui constitue ses fondements, l'esplanade qui lui sert d'assiette est
très exiguë et propre à la défense, grâce aux fossés qui la cernent.
Un état des lieux effectué au XVIIIe siècle par l'expert
Balthasard Métral, maçon à Gruffy, exprimait déjà l'état de délabrement de la
fortification :
« Ce château dont il n'existe plus qu'une partie couverte
par un toit en forme d'appentis et composé d'un cellier servant d'écurie
creusée dans la molasse et deux chambres l'une sur l'autre, au-dessus, ne peut
être envisagé que comme masure soit par sa vieillesse et sa caducité, soit pour
sa disposition quant au surplus dudit château, on voit les vestiges de
différents appartements au couchant et au midi, j'estime comme masure soit de
nulle valeur. »
Actuellement, Pierrecharve est tout à fait à l'abandon et
très menacé par une nature qui reprend ses droits.
Sources:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert,
éditions Neva,
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions
Cabédita,
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot,
éditions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2023)
Posté le 05-06-2023 10:25 par Jimre
Les châteaux de Cruseilles
Le château comtal de Cruseilles
Les ruines se situent sur un promontoire rocheux dominant l'ancien bourg de Cruseilles, à l'intérieur d'un virage formé par la N 203 se dirigeant vers Genève.
Propriété privée.
Histoire
Situé au cœur de la ville, le château comtal de Cruseilles était le centre d'un important mandement s'étendant jusqu'aux Usses, bordant celui d'Annecy à l'est et au nord ceux de Chaumont, Viry, Mornex et le bailliage de Ternier.
Ce site fut occupé dès l'époque gallo-romaine puis durant le Haut Moyen Age, comme l'attestent des découvertes de sépultures.
A l'origine, la seigneurie relève de la famille de Cruseilles, citée avant 1113. En 1179, Humbert, vicomte de Cruseilles, assiste à une donation aux Chartreux de Pomier. Très tôt, semble-t-il, les comtes de Genève acquièrent ce territoire qu'ils inféodent à différentes familles.
Les comtes de Genève conservèrent toujours ce fief, mais l'inféodèrent à diverses familles. Guy de Genève, évêque de Langres, seigneur de Cruseilles, donne en 1282, le 25 avril, des franchises aux habitants du bourg en accord avec Robert, évêque de Genève et le comte Amédée.
En 1308, Agnès de Chalon, veuve du comte Amédée, reçoit en garantie pour sa dot le château de Cruseilles. Elle le laisse en héritage à son fils Hugues de Genève, sire de Gex, le 19 octobre 1350.
Cette remise devient définitive en 1311. À l'extinction de la dynastie des comtes de Genève, Cruseilles est inféodé à plusieurs seigneurs dont Guillaume de Menthonnay, évêque de Lausanne, puis à Mermet Métral en 1411 et enfin en 1681 à Jean-François, Angot de Bonnières, créé Marquis de Cruseilles. En 1411, il comptait 140 feux.
Le seigneur de la Palud se verra propriétaire du petit château de Cruseilles et des masures de la chapelle Sainte-Agathe. La chapelle est citée en 1371.
Ce bourg fortifié qui possédait un droit de péage et qui abritait d'importantes halles fut assiégé par les Genevois et incendié en 1532.
Description
Il ne reste aujourd'hui que quelques pierres de cette position forte dominant la route de Genève, la Semine et les Usses. Seule la mappe de 1730 peut retracer le plan initial de la fortification avec ses trois portes. La rue principale du Corbet conduisait au château en longeant les halles où avaient lieu d'importants marchés et foires. La demeure seigneuriale était de plan carré et commandait l'accès septentrional.
En 1872, Raverat, dans ses promenades historiques décrit le bourg de Cruseilles alors qu'il possédait encore des vestiges de fortification :
« Au temps de leur puissance, les comtes de Genève jetèrent les fondations d'un château fort sur l'esplanade du rocher ardu et isolé qui défend le défilé du Moulin, passage obligé de la grande route.
le château de Fésigny
Très ancienne, la partie du bourg voisine du château présente un aspect sévère. On y remarque un vieux bâtiment en grosses pierres de taille qui servit tout à la fois de prison seigneuriale et de demeure au juge châtelain.
La porte est basse, à cintre surbaissé, les fenêtres très allongées se terminent par un ornement trilobé. Ses voisines ont également un caractère assez tranché, soit comme style, soit à cause de leur ancienneté, de leurs culs-de-lampe bizarres et de leurs meneaux prismatiques ».
Admirablement conservé, il est le type même de l'habitation urbaine du XVIe siècle. Cette propriété des sires de Fésigny est confirmée par la présence, au-dessus du porche d'entrée, du blason de la famille.
C'est la même famille qui possédait un autre château à Cusy. Sa construction remonte au XVe siècle.
De Foras précise que les Copponex ou Copponay possédaient une maison forte, ainsi que des biens à Corsier.
Au lieu-dit de « Féchy », M. Bouchet est propriétaire d'une vieille maison datant de 1787 et que chacun appelle « le château».
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita,
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 11:28 par Jimre
Le château de Fésigny
Situation
Haute-Savoie - Arr. : Annecy
Canton : Alby-sur-Chéran
Histoire
Les premiers propriétaires du château seraient les seigneurs de Fésigny, vassaux des comtes de Genève.
Les sires de Fésigny ou Feysignier, Feissiaco, sont connus dans l'ancien comté de Genève dès le XIVe siècle. Il est probable qu'ils soient originaires de Cruseilles, car on retrouve dans cette ville une maison portant les armes de la famille de Fésigny.
Mais dès la fin du XIIIe siècle, bien avant l'annexion du Genevois à la Savoie, le comte Amédée V prendra possession de Cusy et de Fésigny.
Rolet de Feysigné, damoiseau, est cité en 1385, en tant que possesseur de biens à Cusy et à Saint-Ours.
Le 14 janvier 1462, Guigues de Feysigné avait obtenu : « des patentes d'inféodation de la terre et juridiction de Feysigny avec le mère et mixte empire, l'omni mode juridiction, haute, moyenne et basse jusqu'au dernier supplice inclus, sur tout le territoire dudit lieu Feysigny avec le pouvoir d'établir des fourches patibulaires et des piloris ».
Les Fésigny ont un puissant voisin en la personne de Jacques de Montmayeur.
Ce dernier a pris possession du château comtal de Cusy, aujourd'hui disparu.
Christian Regat relate dans son livre " Châteaux de Haute-Savoie" les relations orageuses que ces deux familles ont entretenues.
Le château de Fésigny appartient à M. et Mme Mathieu, qui l'ont magnifiquement relevé de ses ruines, comme vous pouvez le constater.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 11:17 par Jimre
Gruffy
Lorsque la Maison de Savoie rentre en possession du comté de Genève, au XVe siècle, le château de Gruffy est inféodé au seigneur Jean de Compey ( voir la page de Thorens-Glieres). La famille le conservera jusqu'au XVIe siècle où il est acquis par les de Menthon.
Les vestiges du château sont encore importants et on peut encore identifier deux tours, une de forme circulaire et une autre en forme d'éperon.
Au lieu-dit « Le Mollard" se dressait autrefois le château Villam ou Velam.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 10:52 par Jimre
Château de Saint-Eustache
Haute-Savoie - Arrondissement d'Annecy
Canton Annecy
La commune de Saint-Eustache conserve les vestiges d'une habitation seigneuriale du XVe siècle, citée dans la documentation médiévale en tant que " bâtie ".
Elle appartenait à l'origine, aux seigneurs qui détenaient à Saint-Eustache, un droit de péage. Au XVIIIe siècle, on retrouve la famille Paquelet de Moyron, également possessionnée à Villaz.
Actuellement, il subsiste dans le village, les ruines d'une tour circulaire.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 10:13 par Jimre
Hauteville sur Fier
L'ancien château, en ruines, se dresse sur une motte au-dessus de la rive droite du Fier, dans le village.
Propriété privée.
Histoire
L'histoire médiévale d'Hauteville reste dominée par la présence d'itinéraires importants et anciens. La commune abrite au pied de la fortification, un passage du Fier qui fut à l'origine un gué, dont l'importance fut capitale puisqu'il permettait de franchir la rivière pour relier Genève à la Savoie.
La vocation de voie de passage d'Hauteville est attestée encore par la dotation des deux chapelles du château et de l'hôpital, à deux saints patrons des voyageurs : Saint-Nicolas et Saint-Christophe. La présence d'une étape hospitalière a dû s'avérer nécessaire sur cette route fréquentée où s'établissent également de nombreux postes fortifiés.
Le passage du Fier à Hauteville s'effectuait sous le château comtal situé sur la rive droite et mentionné en 1178 : « Le comte de Genevois fait en mains de Brocard, abbé de Saint-Maurice-d‘Agaune, hommage-lige et reconnaissance, pour le château de Chaumont, pour celui de la Roche et pour la moitié de celui d'Hauteville Par cet acte, on remarque que les comtes de Genève sont vassaux des abbés d'Agaune. Si l'apparition du château d'Hauteville dans les textes est tardive, on peut supposer une occupation bien antérieure par l'ancienne famille d'Hauteville, de ce site particulièrement favorable à l'établissement d'une fortification. Cette famille s'illustre surtout à partir du XIIIe siècle et fournit des ecclésiastiques importants dans tout le diocèse de Genève. En 1282, Hauteville, " alta-villa " est citée en tant que mandement comtal dépendant entièrement du comte, puis le mandement est inféodé et cédé en fief par le comte de Genevois sous la charge d'hommage.
En 1309, lors d'un traité de paix conclu à Saint-Georges-d'Espéranches, entre Amédée III, comte de Savoie et Guillaume, comte de Genevois, ce dernier reconnaît tenir en fief du comte de Savoie les châteaux et juridictions d'Alby-sur-Chéran et Hauteville. La châtellenie passe donc à la Maison de Savoie, mais elle est toujours entretenue par un châtelain nommé par un seigneur. En 1338, elle est inféodée par Amédée III à Nicod d'Hauteville, puis en 1395, aux nobles Dufresnoy qui la possèdent jusqu'en 1467.
Ensuite, la famille de Montluel leur succède, puis on trouve mentionné sur la mappe sarde de 1730, le nom du propriétaire suivant : « Chabod qui possède le château, avec tour et masure en ruines ».
A Hauteville, comme dans beaucoup de bourgs castraux de l'ancien diocèse de Genève, il y avait deux châteaux à l'intérieur de la même enceinte : le château comtal qui fait l'objet de cette étude et le château de la famille d'Hauteville en contrebas, au lieu-dit "Le Verney ". Il semble que la famille d'Hauteville soit à l'origine du château sur motte, mais soit rapidement devenue vassale des comtes de Genève. Placée dans cette situation d'infériorité, elle aurait édifié dans un deuxième temps, le château du Verney. L'étude archéologique des bâtiments montre, en effet, l'ancienneté du château sur motte par rapport à celui situé en contrebas.
Description
Le site d'Hauteville, avec ses deux châteaux et son église paroissiale, occupe une aire quadrangulaire au bord du Fier.
La motte qui abrite les ruines du château comtal est un mamelon crayeux formant un promontoire dominant le Fier. Cette éminence a été aménagée avec un apport de terre de manière à former une butte homogène et d'une élévation constante.
Elle est limitée sur un pourtour par un fossé encore visible. On accède à la fortification par un petit chemin qui, partant de la place de l'église, contourne la motte par l'ouest. Au même niveau que le chemin d'accès, s'étend une basse-cour limitée elle aussi par un fossé vertigineux.
Les vestiges du château ont perdu tout leur aspect médiéval en raison de nombreuses transformations et du pillage des pierres. On reconnaît pourtant le plan du donjon, ou grande tour quadrangulaire de 8 m sur 9,15 m avec des murs épais de 1,90 m.
On remarque dans l'angle nord-est un retrait intérieur destiné à placer une échelle pour accéder aux étages. Cette tour est appareillée avec de petits moellons de galets et de tuf, le chaînage d'angle est en molasse.
Le premier étage a été reconstruit et la partie haute revêtue de briques suggère plutôt l'architecture du XVe siècle.
Ce donjon, situé dans l'angle nord-ouest de la plateforme, fut rattaché, lors d'une deuxième période de construction, à un logis dont il ne reste que des pans de murs envahis par les broussailles.
La maison forte des Hauteville constitue un bâtiment carré cantonné de tours fortes quadrangulaires en bel appareil de galets avec un chaînage en bloc de molasse, alternant avec des blocs de calcaire.
La tour principale occupe un des angles proches de l'entrée. Les ouvertures d'époque ont été remplacées par des fenêtres modernes. Les caves conservent des portes en arc brisé et des petites fenêtres ébrasées.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 09:35 par Jimre
Château de Lathuile
Situation
Haute-Savoie - Arrondissement d'Annecy.
Canton : Faverges
Le château de Lathuile ou Lathuille est l'un de ceux qui jalonnaient la route de l'Italie à Genève entre Faverges et Annecy. L'édifice est visible de la route traversant le village, juste à côté de l'église. Il est aussi appelé "La tour carrée des nobles de Sales".
Comme la seigneurie de Beauvivier à Doussard, celle de Lathuile appartient initialement aux Duingt de Châteauvieux. Dès le XIIIe siècle, elle passe à la famille Richard.
En 1323, la maison forte relève de la seigneurie de Châteauvieux de Duingt.
Le château de Lathuile entre dans la famille de Sionnaz par le mariage de Béatrice Richard avec Amblard de Sionnaz, seigneur de Vallières. En 1547, Melchior de Sionnaz épouse Bonnaventure de Chevron-Villette, veuve de Philippe de D’Héré.
Leur fille Françoise, née en 1552, est donnée en mariage dès l'âge de huit ans à François de Sales, seigneur de Novel, de trente ans plus âgé qu'elle. Elle lui apporte les châteaux de Lathuile et de Boisy avec le titre de seigneur de Boisy.
Au XVIe siècle, Melchior-Urbain de Sionnaz épouse une descendante de la famille de Chevron-Villette. Leur fille Françoise épouse, à son tour, en 1560, noble François de Sales, père du saint bien connu, qui deviendra seigneur de Lathuile.
Saint François de Sales séjourna quelque temps au château et l'on rapporte que c'est à Lathuile qu'eut lieu la scène célèbre où le jeune François finit par obtenir de son père, l'autorisation de se faire prêtre et qu'il reçut la tonsure dans l'église paroissiale.
Le château restera la propriété de la famille de Sales jusqu'à la Révolution. Comme on peut l'apercevoir, il reste une tour carrée et une porte au linteau en accolade sculpté.
Il abrite aujourd'hui une SCI ; le gérant est M. Deleuze (voir aussi château de Nernier).
A voir également le château de Reveu qui abrite aujourd'hui la mairie.
En 1521, Louise de Savoie hérite de sa mère, Hélène, l'apportant à son mari, Janus de Savoie, qui possédait déjà Choisy, Veyrier, Doussard, Chevaline et Giez. Au XVIIe siècle, le château reviendra à Peronne de Reveu.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 09:32 par Jimre
Château du Cengle
Le château du Cengle (cingulum) est une tour troglodytique, dont l'origine remonterait au Xe siècle. Il est le chef-lieu d'une seigneurie, dont les ruines se dressent sur la commune d'Allèves dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le château du Cengle, que l'on trouve également sous les formes de Sangle, Cengie, Seingle ou encore Single, dérive du latin cingulum, qui désigne une « ceinture ».
Situation
Les ruines du château du Cengle se dressent dans le département français de la Haute-Savoie sur la commune d'Allèves, au-dessus du village de Martinod au nord de la grotte de Bange. Le château était installé à l'entrée du défilé de Bange, lui permettant de défendre l'étroit passage qui ferme l'entrée des Bauges.
Histoire
Le château du Cengle est au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime le chef-lieu de la seigneurie du Cengle et d'un mandement (Mandamentum de Cingulo), relevant de la châtellenie des Bauges, aux mains de la Maison de Savoie. En 1352, le comte Amédée III de Genève l'inféode avec dix journaux de terres proches à François du Cengle. Il échoit par héritage à Jacques d'Orlyé. Sa Sœur, Jeannette d'Orlyé de Viuz, ayant épousé vers 1375, François du Cengle, fils de François, qui n'eurent pas de descendant.
Après Jacques d'Orlyé, son fils, Hugonin d'Orlyé, damoiseau, est en possession de la seigneurie. Le 19 décembre 1406, Pierre d'Orlyé, fils d'Hugonin, rend hommage pour le château et la moitié des dîmes de Gruffy au comte Amédée VIII de Savoie.
Le 20 avril 1464, Pierre et son fils François sont investis du château ainsi que de la maison forte de Viuz (Viuz-la-Chiésaz). François, le fils de Pierre, lègue le château en 1491 à son fils qui se prénomme aussi François qui reconnait, le 7 novembre 1502, le tenir de Philibert II de Savoie. Son fils, Pétremond, le vend avant 1539 à Françoise de Montfalcon, mère de François de Chabod-Lescheraines qui le vend probablement avant sa mort survenu en 1630. Les de Chabod continueront à porter et ce pendant quatre générations le titre de seigneur du Cengle.
Lors d'une visite pastorale, en 1640, où il est témoin, Jacques, fils de Claude-Henri de Montfalcon-Roasson, héritier universel d'Anatoile d'Alby († 1650), porte le titre de seigneur du Cengle. Ses deux fils : Louis, résident à Saint-Offenge-Dessous et Jean, résident au Villard de la Biolle seront coseigneurs du Cengle après leur père. Le fils de Louis, Aimé Philibert né en 1666 sera à son tour seigneur du Cengle ; il testera en 1715 en faveur de son fils Claude, héritier universel, né en 1692 et mort en 1739. Ce dernier transmit la seigneurie à son fils louis (1724-1774) qui ne laissa qu'une fille et le Cengle échut à son frère François, né en 1726, qui à son tour n'eut que deux filles et le transmis à son frère Joseph de Montfalcon du Cengle, archevêque de Tarentaise, évêque de Moutiers. À la mort de ce dernier survenu en septembre 1793, sa sœur Marie ainsi que ces deux nièces, Joséphine de Savoiroux et Anne Favier de la Biguerne, héritèrent du Cengle.
Guillaume d'Orlyé dit le « bienheureux », dominicain, se retirera au château du Cengle et y mènera une vie d'ermite de 1450 à sa mort survenu le 19 février 1458.
La seigneurie étant détenu en toutes justice, près du château du Cengle était érigé des fourches patibulaires. Elles servirent au départ aux deux terres : celle du Cengle et celle de Villard-Chabot (Saint-Jorioz), possession également des seigneurs du Cengle avant qu'elle ne soit acheté par la famille Asinari et que ces derniers n'en dressent d'autres.
La famille d'Orlyé avait également en sa possession une maison forte sis à Balmont (Seynod).
Description
Le château du Cengle se présentait sous la forme d'une tour-résidence ; au rez-de-chaussée on y trouvait un puits, la cave et la prison, le premier niveau abritait la cuisine et les offices, le second, les alcôves et les cabinets de conversation et le troisième la grande salle qui occupait tout l'espace.
La tour était en ruine dès le XVe siècle. Ces pierres ont notamment été réutilisées lors de la reconstruction de la maison « Grabier » détruite par un incendie survenue le 3 janvier 1738. Voir notamment la fenêtre placée à droite de la porte d'entrée.
Source:
- Wikipedia avec des avertissements quant au manque de sources...
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 08:23 par Jimre
Les Crêts
Le château de Cusy et château de Fésigny
Situation
Haute-Savoie - Arr. : Annecy
Canton : Alby-sur-Chéran
Le château de Cusy
Histoire et description
Les vestiges du château de Cusy se situent à 700 mètres au nord-est du village sur un promontoire dominant le Chéran. Le château de Cusy aux crêts s'élève sur une ancienne motte romaine.
Il fut fondé en 1022 par Humbert de Savoie, dit Humbert aux blanches mains, fondateur de la maison de Savoie. Il s'agit de l'ancienne propriété des seigneurs de Montmayeur qui revint ensuite aux Pingon, titulaires de la baronnie de Cusy au XVIe siècle.
L'ensemble était très imposant et abritait comme celui de Fésigny une chapelle.
L'ensemble aujourd'hui ruiné devait être très imposant comme le laissent supposer les dimensions de la plate-forme ayant servi d'assiette au château qui abritait également une chapelle.Site et vestiges d'un château.
Source:
- Nano.M
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 01-06-2023 08:11 par Jimre
La Roche sur Foron
L'histoire de la Tour
Au XIe siècle, La Roche est une petite cité du comté de Genève, comté appartenant au deuxième royaume de Bourgogne. Après une défaite militaire contre l'empire germanique en 1032, le comte est chassé de sa capitale, Genève, mais conserve le reste de son territoire et son titre.
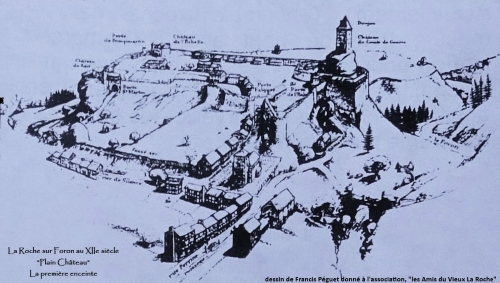
Il vient s'installer au château de La Roche avec sa famille. Ses conseillers et des familles nobles amies logent également dans des maisons fortes du Plain-Château. Les fortifications, portes et remparts, sont renforcées. Pendant deux siècles, La Roche tient le rôle de capitale du comté de Genève. En 1179, la comtesse et son fils subissent un long siège. Ils résistent et le comte, en déplacement, revient à La Roche et réussit à les dégager.
Si le château disparaît au cours des siècles, le donjon subsiste. Il est construit sur un bloc rocheux double calcaire, issu d'un écroulement de la montagne d'Andey sur le glacier qui l'a transporté jusqu'ici. C'est une tour de guet qui a été reconstruite, ronde, dans la première moitié du XIIIe siècle.
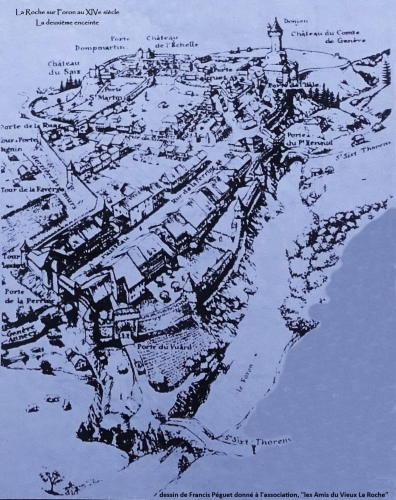
Après avoir failli disparaître sous le pic des démolisseurs au XIXe siècle, elle a été rebâtie sous sa forme actuelle par les capucins. Avec le clocher, la Tour est aujourd'hui un symbole de La Roche. C'est d'ailleurs le rocher de la tour qui a inspiré le nom de la ville, La Roche-sur-Foron.
Description

1. Grotte des Instituteurs
C'est l'entrée actuelle. Son nom provient de la proximité de l'école du Plain-Château, aujourd'hui médiathèque municipale. C'est en 1977 que la jonction est établie avec la grotte des Capucins.
2. Grotte des Capucins
Jusqu'en 1977, pour accéder à la tour on passait par le scolasticat, le bâtiment contre la Tour qui abritait l'école formant les capucins. Dans la grotte sous la Tour, ces derniers établissent au XIXème siècle leur chapelle d'été. Leur couvent était en contrebas de cette Tour.
3. Salle des Archers
C'est le premier étage de la Tour. Sous le plancher se trouve un « ratier ». Ces cavités ont probablement servi de prison ou d'oubliettes mais leur fonction première est celle de garde-manger en cas de siège.
L'épaisseur des murs et l'étroitesse des fenêtres qui ressemblent à des meurtrières permettent le maintien de la fraîcheur toute l'année. Des fenêtres plus grandes ont été percées ultérieurement. Un escalier intérieur permet d'accéder à l'étage suivant, il subsiste quelques marches d'origine, du XIIIe siècle.
4. Le Belvédère
A l'origine, la tour comportait trois étages et le tout était surmonté d'un toit conique. Actuellement, l'ensemble rocher et tour mesure 27m de haut avec 137 marches.
L'effort pour les gravir est récompensé par un splendide panorama. L'emplacement était donc bien choisi pour surveiller les environs et assurer la protection de la cité.
Les tables d'orientation vous aident à identifier les montagnes, vallées et localités environnantes.
De plus, l'organisation médiévale de la vieille ville devient plus évidente. Le site du Plain-Château avec les châteaux du Saix et de l'Echelle s'étend sous vos pieds. Le site protégé par l'enceinte construite vers 1320 débute place de l'église d'où partent deux rues perpendiculaires : la rue Perrine et la rue de Silence. Au-delà s'étend la ville nouvelle jusqu'aux bâtiments de la foire. A l'opposé, du côté Est, vous remontez l'active vallée de l'Arve, bon exemple de vallée glaciaire en auge (en forme de U).
Par temps clair, l'horizon est barré par la chaîne de montagne qui va des Dents Blanches au Buet. Cachée derrière la pointe d'Andey se trouve la vallée de Chamonix-Mont Blanc.
En redescendant, lorsque vous sortez de la Tour, prenez à droite. Une fois sur la terrasse, regardez de nouveau la Tour.
Vous constatez que les grosses pierres d'origine sont remplacées par endroits par des pierres plus petites. En effet, au XIXe siècle, certains bâtisseurs n'ont pas hésité à profiter de ces belles pierres inutilisées. Ce sont les capucins qui ont fait arrêter ces destructions et permis à la tour d'acquérir sa forme actuelle.
Source:
- Dépliant remis lors de la visite.
- Dessins de Francis Péguet donné à l'association, "les Amis du Vieux La Roche".
Posté le 31-05-2023 11:47 par Jimre
Château de la Comtesse
Brève histoire du Château de Comtesse
Situation
Le château se trouve dans la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Les origines
La question des origines du château de la Comtesse a été traitée par M. Henri Baud dans les articles cités ici en bibliographie ; il y a montré que la construction de cette maison forte était une conséquence indirecte de la cession du Dauphiné à la France (1354).
Lorsque les documents antérieurs à cette date parlent du château de Montjoie, il s'agit de l'édifice, aujourd‘hui presque totalement disparu, qui occupait le site de l’actuelle église des Contamines. Cette localisation excentrique du siège des autorités est due au fait que le Quartier-d’en-haut de Saint-Nicolas-de-Véroce, qui devait s’en détacher pour former la paroisse, puis commune, des Contamines était alors poste-frontière du Faucigny face à la Tarentaise et au Beaufortin, possessions du comte de Savoie.
La dernière héritière des sires de Faucigny, Agnès, épousa le comte de Savoie Pierre II, le Faucigny restant sa propriété personnelle qu’elle légua à sa fille Béatrice. A la mort de celle-ci, le Faucigny passa aux mains de son époux Guigues ou Hugues, dauphin de Viennois. Un arrière-petit-fils de Guigues, Humbert II, vendit toutes ses possessions à Philippe VI, roi de France (1343). Les terres de ce dernier se trouvaient ainsi si étroitement imbriquées dans celles du comte de Savoie qu'une remise en ordre s'avéra bientôt nécessaire : en 1355, Jean II le Bon céda la Faucigny et le pays de Gex à Amédée VI, le Comte Vert, en échange de ses fiefs du Viennois.
Le Faucigny ainsi réuni à la Savoie, il était naturel que le centre administratif de la vallée de Montjoie passe à la plus importante de ses deux paroisses, celle qui se trouvait au croisement de deux voies de communication : de Dauphiné en Valais, par la vallée de l'Arly et le col de la Forclaz, et de Genève en Italie, par la vallée de l'Arve et le col du Bonhomme à Saint-Gervais. Ce transfert fit apparaître le besoin d'une maison forte « où les châtelains et autres officiers du seigneur puissent résider et où les délinquants puissent être gardés en toute sécurité ». Ainsi s’expriment les comptes de châtellenie de l’an 1375, pour justifier l'achat d’une pièce de terre Saint-Gervais.
Les mêmes comptes témoignent des frais de construction de la maison en question dont le prix-fait fut donné pour soixante-cinq florins, non compris la fourniture des matériaux, à un certain Nycod du Fresney.
Quelle fut la comtesse qui donna son nom à cette maison ?
Certainement pas Béatrice de Faucigny : elle était alors morte depuis longtemps (1310) et n'avait jamais porté d'autre titre que celui de dauphine. On pense d’abord à Bonne de Bourbon, épouse du Comte Vert, qui exerça la régence après sa mort (1383), construisit ou répara maints châteaux de la région et reçut le Faucigny en douaire. Mr Henri Baud a bien montré qu'il s’agit plus probablement de Bonne de Berry, épouse d 'Amédée VII : devenue veuve, elle reçut en douaire les revenus de certaines châtellenies de Faucigny, Beaufort et Tarentaise, ceci à une date (4 mai 1393) qui coïncide avec l'apparition dans les comptes de la mention de la maison de la Comtesse. Il faut noter qu’à l’époque Bonne de Berry n'était plus comtesse de Savoie mais, de par son remariage, d’Armagnac.
La résidence des Dufresney
Le Nycod du Fresney qui construisit la Comtesse semble bien être le fils d’un certain Bertrand qui, d'après de vieux mémoires dont l'Armorial et Nobiliaire de Savoie fait état, aurait obtenu du dauphin Hugues abergement des eaux aboutissant au village du Fresnay, avec permission de construire sur ces eaux « des artifices de toute nature », c'est-à-dire des moulins, ce qui était un privilège seigneurial. Le même Bertrand obtint encore du dauphin Humbert II une déclaration (1328) suivant laquelle les Dufresney appartenaient à la famille de Faucigny et se trouvaient donc dispensés de payer tailles et subsides. Peut-être est-ce alors que les Dufresney prirent l'habitude d’arborer un écusson où leurs propres armes, de gueules au frêne d’or, se trouvaient écartelées avec celles des sires de Faucigny, pallé d'or et de gueules de six pièces. En tout cas, ils prirent rapidement rang parmi la noblesse locale, à côté des Bongain et des Hoste.
Cette ascension sociale semble s'être réalisée en deux temps. D'abord, par la participation aux charges publiques, en particulier celle de châtelain ; puis par rachat des droits féodaux du comte de Savoie sur une partie du territoire de la vallée. Souffrant d'impécuniosité chronique, les comtes se prêtaient volontiers à ce genre d 'opération pourvu que l'acquéreur se reconnût leur vassal. Ainsi s'explique qu'on trouve en 1560 un Gabriel Dufresney, châtelain de Montjoie, puis, en 1616, un Jean-Baptiste Dufresney, seigneur de la Comtesse.
C’est d'ailleurs entre ces dates que doit se situer l’installation des Dufresney dans la maison forte de Saint-Gervais : leur écusson, gravé dans le tuf du linteau de la porte d rentrée, porte le millésime de 1578. Les comptes de châtellenie de la fin du XVIe siècle font d’ailleurs mention d'une "refacture du château de Monseigneur" : on aura ajouté au bâtiment primitif les tours, dont le prix-fait de Nycod ne parlait pas.
Les Dufresney ont dû demeurer à la Comtesse jusqu' à la mort de Claude-Melchior (1698). Faute d’héritiers directs sa veuve, Anne-Charlotte Dutour, qui lui survécut près de vingt ans, testa en faveur des fils de son frère, Joseph et César Dutour. Ces derniers ne semblent pas avoir jamais résidé à Saint-Gervais, ni avoir éprouvé le moindre regret de se défaire de leur héritage lorsqu’une occasion avantageuse se présenta.
L’acquisition des Octenier
Les Octenier sont originaires de Saint-Nicolas-de-Véroce. La branche qui nous intéresse ici descend d’un certain Guillaume, du Nant-Blanchet, notaire et serf des religieux du prieuré de Contamine-sur-Arve, curés primitifs de Saint-Nicolas : ceux-ci l'affranchirent en 1463, dans l'intention clairement signifiée d’améliorer sa situation économique. Peut-être les résultats devaient-ils, avec le temps, dépasser leurs espérances.
Deux siècles plus tard (1634), Nicolas-Georges Octenier habite Bionnay ; il est bourgeois de Sallanches, titre acheté par son père ; il exerce la fonction de notaire curial et afferme les lods du mandement conjointement avec Jean-Baptiste Dufresney. Un peu plus tard, il accède à la charge de châtelain de Montjoie.
Avec lui, c'est toute la famille Octenier qui supplante les Dufresney dans l'administration du mandement. Durant le siècle suivant, le châtelain de Montjoie sera bien souvent un Octenier et en général un descendant direct de Nicolas-Georges. En même temps, les Octenier seront notaires : on en comptera jusqu'à quatre du même nom à exercer simultanément dans la vallée.
L'histoire des Octenier culmine avec Joseph (1697-1743), notaire et châtelain. II commença par louer la Comtesse aux Dutour, puis l’acheta le 26 novembre 1740, au prix de onze mille six cents livres. II acquérait ainsi quelque vingt-huit hectares de terre. Le fonds de la Comtesse était alors limité, au nord, par le ruisseau de Panloup, qui sépare la maison de l’agglomération centrale de Saint-Gervais ; à I ‘ouest, par le Bonnant ; au sud, par le petit ruisseau qui se jette dans le Bonnant à quelques mètres en aval du pont du Diable ; à l'est, une limite beaucoup moins nette passait au pied de la Mollaz puis remontait jusqu’au Mellerey. Ce à quoi il fallait ajouter les moulins des Champs, entre les Praz et la Perrette.
Ce domaine devait d 'ailleurs être bientôt démembré. Celui des fils de Joseph qui lui avait succédé dans ses charges, François-Alexandre, sut désintéresser ses frères et sœurs de manière à lui succéder aussi dans ses biens de Saint-Gervais. Mais sa position était de celles dans lesquelles il est bien difficile de ne pas se faire d 'ennemis. La Révolution l'amena donc à émigrer et ses biens furent mis sous séquestre au profit de ses enfants, tous mineurs. Rentré sous l’Empire, il obtint sa radiation de la liste des émigrés et récupéra la majeure partie de son patrimoine. Mais ses filles, grandies en son absence et mariées, I ’obligèrent à partager ses biens également entre eIles et Victor-André (1811) . En ce qui concerne les bâtiments, échurent à Catherine -Marie-Geneviève, épouse de Jean Batard, dont descend la famille Dablainville; le rez-de-chaussée du château, à Victor-André; le premier étage, à Constance-Emilie, épouse de Jean-François Cohendet (C'est très probablement Cohendet qui a fait construire le corps de logis qui s'adosse au côté est du château et communique avec lui au niveau du premier étage).
Quand François -Alexandre mourut, en 1819, son seul héritier mâle, Victor-André, vivait dans la gêne, sinon dans la misère.
Vingt ans plus tard, il se trouva obligé de vendre son bien pour désintéresser ses créanciers et, en premier lieu, ses propres sœurs. Seule l'intervention d'une de ses filles, Constance-Mélanie, empêcha la Comtesse de passer aux mains des étrangers.
La descendance des Octenier
En 1839, Constance-Mélanie Octenier travaille à Paris comme domestique. Elle est mariée depuis un an à Elie-Marie Delachat, originaire comme elle de Saint-Gervais et facteur aux Messageries Générales. Associés à un frère d'Elie-Marie qu'ils désintéresseront par la suite, ils achètent le bien de Victor-André pour dix mille livres neuves (25 novembre 1839). Victor-André se trouve alors à l’'asile de vieillards de Chambéry où il mourra trois ans plus tard. Quant à sa femme, Jacqueline Onillon, sa fille et son gendre lui réservent sa vie durant la pièce sise au nord-ouest du rez-de-chaussée. Les nouveaux propriétaires donnent leur bien à ferme en attendant de venir y prendre leur retraite.
A sa mort (1893), Delachat laisse deux enfants. Son fils Auguste s'est établi à Paris où il fera souche ; sa fille Constance-Eléonore, rentrée en Savoie avec ses parents, a épousé Jacques-Damien Béné, receveur des postes à Chamonix. Cette fois encore, c'est le gendre qui recueille la succession d 'Elie-Marie en rachetant la part de son beau-frère.
Cependant la famille Cohendet est sur le point de s'éteindre.
L'un des fils de Jean-François est mort ; l'autre, Eusèbe, n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il s’est embarqué à Boston pour la Californie, en 1849, les filles, restées célibataires, mourront l'une après l'autre à la Comtesse. La dernière, Marie-Félicité, fut assistée dans sa vieillesse par Jacques-Damien Béné et sa famille, ce qu'elle jugea bon de reconnaitre en lui léguant la quasi-totalité de ses biens. A son tour Jacques-Damien Béné manifesta sa gratitude, lors de l’ouverture du nouveau cimetière de Saint-Gervais, en faisant transférer dans son caveau de famille, avec les restes de ses beaux-parents, ceux de Marie-Félicité et de sa sœur Joséphine. Des deux filles de Jacques-Damien Béné seule la cadette, Elisa, se maria. Le nom de son mari, Gabriel Lionnet, est ainsi celui des actuels possesseurs de la Comtesse, qui sont ses descendants directs et par conséquent ceux de Joseph Octenier, l’acquéreur de 1743.
Fait à la Comtesse par André Lionnet le 30 Juillet 1983
Source fournie par Nano.M:
- Documents aimablement transmis par Marie-Hélène et Jean-Marie Sénéchal, les propriétaires, qui ont autorisé la publication.
Bibliographie
- BAUD, Henri : « La châtellenie de Montjoie », Revue de Savoie, No 3, 1955.
- BAUD, Henri : « Les origines de la châtellenie de Montjoie », Mémoires et documents de l'Académie de Faucigny, tome XIV, 1965.
- FORAS, Amédée de ; et alii: Armorial et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, Grenoble, 1863-1958.
- Archives de famille.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 30-05-2023 16:00 par Jimre
Château de Boisy à Groisy
Situation
Dressé sur le rebord du plateau des Bornes, le château de
Boisy domine, au midi, la vallée de la Filière. Au nord, il contrôle le
carrefour des routes venant de Villy-le-Pelloux, Cruseilles,
Menthonnex-en-Bornes et Evires.
Histoire
Le château de Boisy appartient, au début du XIVe siècle, à
la famille de Montfort. Peut-être tient-il son nom de l'autre château de Boisy
qu'elle a acquis par mariage en 1362 et qui se trouve à Ballaison.
en 1362, Nicolette de Montfort l'apporte en dot à son mari
Albert des Clets, dont la famille le conserve jusqu'en 1467. A cette date,
Jeanne des Clets épouse Bertrand de D’héré à qui elle transmet la propriété de
Boisy. Celui-ci deviendra président du Conseil du Genevois et donnera son aspect
actuel au château de Dhéré, à Duingt, habitation principale de la famille.
Au décès de Philippe de Dhéré, en 1546, le bâtiment
reviendra à sa veuve, Bonnaventure de Chevron-Villette qui se remariera avec
Melchior de Sionnaz. Quand leur fille, Françoise de Sionnaz, épouse François de
Sales, ce dernier reçoit de sa belle-mère le château de Boisy sous réserve
qu'il en porte le nom.
Monsieur et Madame de Boisy furent les parents de saint François de Sales. La famille de Sales conserve le château de Boisy jusqu'à la Révolution française. Confisqué alors au marquis Benoît-Maurice de Sales, il est mis en vente comme bien national. Ce sont ses propres fermiers qui s'en portent acquéreurs et il est partagé aujourd'hui entre deux familles.
Il abrite aujourd'hui des habitations et un commerce.
Description
Situé au centre du village, jadis entourée de fossés, cette maison forte à l'imposante silhouette se repère de loin, que ce soit de la route nationale ou de l'autoroute.
Son plan en équerre fait penser à celui du château d'Aléry à
Cran-Gevrier. Une tour carrée, aujourd'hui rabaissée et couverte d'un toit à
deux pans lui est accolée. L'escalier à vis présente la particularité d'être construit
en bois.
Ainsi donc, le château de Choisy, au
cours des siècles, a appartenu aux plus prestigieuses familles savoyardes.
A voir également la maison forte de la Croix qui se situe au hameau du même nom. En 1542, elle appartenait à Louis de Mandallaz qui porte le titre de co-seigneur de la Croix, seigneur de Cernes, La Motte, La Croix en Borne. En 1730, le château appartient à un certain Duret.
Sources fournies par Nano.M:
-Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Gombert, éditions Neva,
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 07-05-2023 20:07 par Jimre
Château de La Cour à Lornay
Le château de la Cour appartenait en 1522 à Philippe de Savoie, comte de Genevois.
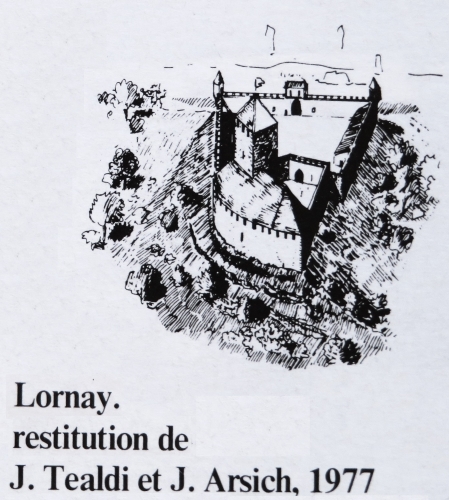
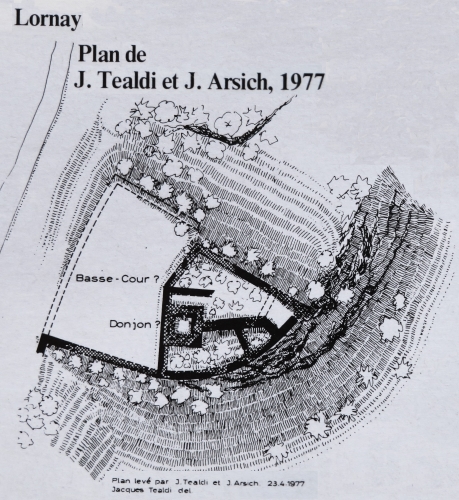
Source du plan et de la restitution fournie par Nano.M:
- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.
Texte et Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 07-05-2023 19:53 par Jimre
Feigères
Château de Feigères
Les ruines du " Châtelard " sont encore bien visibles, à l'est de Feigères. A cet emplacement a été érigée en 1876 la chapelle Notre-Dame de la Salette.
Histoire
La fortification était dès l'origine, semble-t-il, une possession faisant partie des principales résidences de la puissante famille voisine des Ternier.
En 1294, on mentionne Pierre de Ternier, qui tenait le château du comte de Genève, faisant une donation à Rodolphe de Menthon, sur les lieux du Châtelard.
Plusieurs textes médiévaux révèlent que les Ternier devaient prêter hommage, pour ce château, au comte de Genève. Au XIVe siècle, la fortification entre dans la mouvance des dauphins de Viennois. En 1400, il est fait état de travaux au château: le châtelain de Ternier fait réparer les toitures.
Le Châtelard comme la Poype des Ternier, passa aux Montchenu-Ternier. En 1516, François de Ternier dit de Pontverre, hérite du château et de ses dépendances.
Après de multiples contestations, le Conseil de Genève décida, en 1590, de détruire le Châtelard.
Au XIXe siècle, on érigea au milieu des ruines une petite chapelle.
Description

Le Châtelard occupait une position stratégique importante, dominant la route du Chable, à peu de distance de la Poype de Ternier. Son plan quadrangulaire était défendu par un donjon ou grand tour et par une autre tour à l'entrée, fortement talutée.
Au nord-est, s'élevait une troisième tour de forme irrégulière.
Le donjon, encore bien conservé à l'époque où Blondel en a fait la description, mesurait environ 7 m de côté et ses murs étaient épais de 2 m, l'archéologue genevois l'a daté du XIIe siècle. Il semble, en effet, que d'après les dimensions de l'appareil, on soit en présence d'une tour dite « romane », fréquente dans l'ancien comté de Genève à la fin du XIIe siècle et encore au XIIIe siècle.
La courtine orientale était flanquée d'une échauguette appartenant, sans doute, à une autre période de construction.
Posté le 07-05-2023 19:49 par Jimre
Etrembières
Château d'Etrembières, du Rosey ou de l'Hôpital
Arr. : Saint-Julien-en-Genevois
Haute-Savoie
Canton : Annemasse
A 4 kilomètres au sud d'Annemasse, par la N 206 reliant Collonges-sous-Salève à Thonon-les-Bains. Situé une trentaine de mètres au-dessus de la nationale le château se situe sur un monticule dominant le village d'Etrembières. Il est visible de la route et grâce à son point de vue, il surveillait tout le trafic passant au pied du Salève.
Propriété privée.
Histoire

Cette région de Salève comporte plusieurs gisements préhistoriques dont celui de la grotte d'Aiguebelle à Etrembières. La commune même, au pied du petit Salève, a abrité deux châteaux occupant une position stratégique remarquable, l'un en haut du village et relativement isolé dont il est question ici, l'autre en bas du village et commandant l'accès d'un bac pour passer l'Arve.
Le château qui reçut différentes appellations : château du Rosey, château de l'Hôpital, appartenait à la famille d'Etrembières, mentionnée dès 1201 avec la présence d'un certain Guido d'Etrembières, chevalier, aux côtés du comte de Genève. Au XIVe siècle, il revient aux sires de Compey, également seigneurs de Mornex, de Monnetier et de Gaillard. Mais cette famille sera impliquée dans des affaires sanglantes et sera condamnée à la perte de tous ses biens par le duc de Savoie.
En 1559, il est inféodé à François-Prosper de Genève-Lullin dont la fille Clémence, épouse de Bernard de Menthon, le lègue à l'hôpital d'Annecy en 1606, à charge pour celui-ci de subvenir à trois pauvres de la paroisse.
En 1589, il sera brûlé par les Genevois. Il sera une nouvelle fois remis en état et, en 1602, Charles-Emmanuel 1er y fait étape le 11 décembre avant de lancer contre Genève la fameuse « Escalade » qui vit la déroute des troupes savoyardes.
La légende veut que le soir de la grande bataille de l'Escalade, en 1602, le duc de Savoie ait trouvé refuge au château d'Etrembières.
Les archives ont conservé un document concernant les habitants d'Etrembières se plaignant des multiples incursions des troupes de Genève et de Berne sur leur territoire. Il s'agit d'une lettre de l'évêque Saint-François de Sales adressée au commandant général en Savoie, Antoine Favre, président du Sénat, le 16 mars 1611 :
« Je vous écris par celui qui m'a apporté ce matin votre lettre, mais ces pauvres gens d'Etrembières me forcent par leurs remontrances d'intercéder pour eux puisqu'ils recourent moi pour cela en qualité, disent-ils, de mes enfants les plus exposés à la persécution de leurs frères rebelles. Je vous supplie donc humblement en ce qui pourra bonnement et saintement se faire de les avoir en recommandation ».
Description
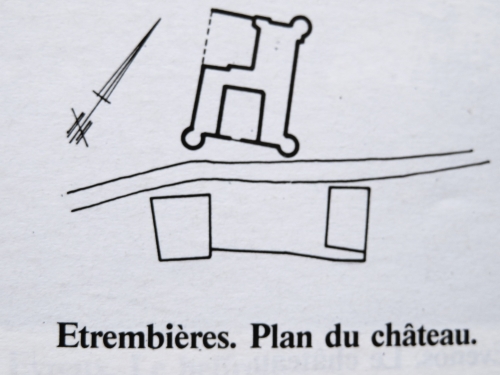
Le château se présente sous forme d'un quadrilatère d'environ 21 sur 27 mètres flanqué de tours circulaires aux angles. Il demeure aujourd'hui trois tours à poivrière, la quatrième ayant été détruite et non reconstruite.
Le château est actuellement très endommagé, transformé en ferme et a été très remanié.
Toute la partie nord-ouest a été démolie. Il subsiste la porte d'entrée fortifiée très intéressante par son système de coulisse pour la fermeture et le bâtiment de droite qui offre encore une salle voûtée et des fenêtres à moulures Renaissance.
Cette fortification au plan régulier est à mettre en relation avec l'église Notre-Dame qui fut peut-être à l'origine une chapelle castrale.
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, Cabédita,
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Gombert, éditions Neva.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen-âge en France, C-L Salch, éditions Publitotal
Posté le 07-05-2023 17:31 par Jimre
Soirier
Château de Soirier
Les ruines du château sont encore visibles au nord du village du Plot, sur un éperon boisé dominant la route nationale.
Le château de Soirier ou Suerye est mentionné en 1332 en tant que propriété des comtes de Genève.
Puis, au XVIe siècle, la seigneurie revient aux Luxembourg-Martigues. En 1555, François Ier de Luxembourg, vicomte de Martigues, passe hommage pour Soirier.
Posté le 07-05-2023 16:54 par Jimre
Le château de Rossy
Le château de Rossy ou de la Vulpillières, du nom de son premier seigneur, se situe au lieu-dit de " Rossy" à environ deux kilomètres du chef-lieu de Choisy.
C'était l'ancienne propriété des Reydet de la Vulpillières.
À l'origine, le château comprenait quatre tours rondes identiques à celle que l'on peut observer de nos jours.
Aujourd'hui, le nouveau propriétaire a entrepris de restaurer l'ancienne salle de réception où l'on peut encore apercevoir de magnifiques vitraux, aux armoiries du Genevois et du Dauphiné.
De l’extérieur de ce château, on peut observer un grand corps de logis rectangulaire, avec deux tours rondes semi engagées sur la façade est et une tour carrée au centre de la façade ouest. L'une des deux tours, étêtée, se fond dans l'ensemble du corps de logis.
Jeanne-Françoise de Reydet, dernière du nom, comtesse de la Balme, était aussi par mariage marquise de Sallemogne.
Les Reydet étaient seigneurs de Seigneurs de Choisy de Vulpillières, Manigod, Hauteville, barons de Grilly, comtes de la Balme de Consongier
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Gombert, éditions Neva.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 07-05-2023 16:38 par Jimre
Montaigu
Au sommet du roc de Nantbellet (1056 m), on trouve une croix et un magnifique panorama sur Faverges. Du château de Montaigu, il ne reste que des ruines. Cette place forte était jadis une tour de guet du IXe siècle.
Texte et Photos:
- Nano.M (2022)
Posté le 07-05-2023 16:26 par Jimre
Crête
Château de Crête ou de la Crête
Haute-Savoie - Arr. : Annecy
Canton : Rumilly
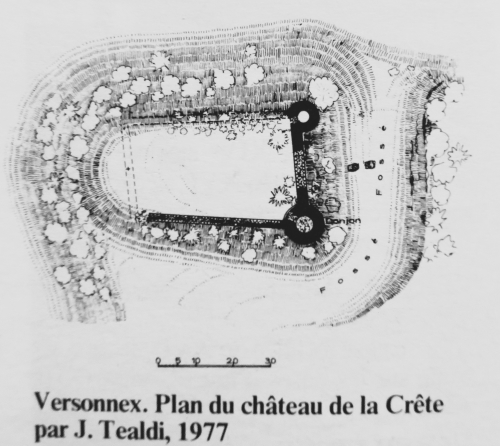
Situé non loin de Versonnex, le château de Crête, dont on pouvait encore apercevoir une tour il y a une quarantaine d'années, n'est plus aujourd'hui qu'une ruine.
Son nom est dû à une position dominante sur une crête. On trouve des vestiges d'une enceinte quadrangulaire flanquée de tours rondes aux angles du petit côté dirigé contre l'attaque. L'une d'elles, plus grosse, est le donjon.
II appartint aux seigneurs d'Hauteville jusqu'au début du XVIe siècle pour passer successivement aux Seyssel de la Chambre, aux Sion, puis au XVIIe siècle aux Montfort, aux Chabod et aux Duverger.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux,vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Gombert, éditions Neva,
- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen-âge en France, C-L Salch,
éditions Publitotal,
- plan levé par Jacques Tealdi, 1977.
Photos:
- Nano.M (2023)
Posté le 07-05-2023 15:57 par Jimre
Les Seigneurs de Boëge
La famille des seigneurs de Boëge marqua profondément son époque dans la vallée. On doit la ranger, disait le Comte de Foras, historien, parmi les plus anciennes races de noblesse immémoriale et chevaleresque de nos provinces.
Installée dans la vallée au début du XIIe siècle, elle s'est éteinte vers la moitié du XVe siècle.
Elle avait pour arme : écartelé d'or et d'azur et pour devise : « Le courage ne saurait déchoir ».
Elle possédait des droits, nombreux dans la vallée et d'importants biens et revenus féodaux dans le haut Faucigny, principalement sur le grain et le sel apportés aux marchés de Sallanches. Elle entretenait des relations de bon voisinage avec la cour souveraine des barons de Faucigny.
Les personnages connus
Le premier personnage connu de cette noble famille est Aimon, qui vivait en 1138. Un ancien document relève qu'il vendit un cheval à Hugues, prieur de la Chartreuse de Vallon (Bellevaux) pour le prix de 190 sols, en monnaie de Genève.
Le 22 janvier 1151, on trouva le nom de Pierre de Boëge qui assistait, avec Arducius, évêque de Genève, à l'établissement de l'acte de fondation de la Chartreuse du Reposoir.
On sait aussi qu'en 1209, Ganfred de Boëge, chanoine de Genève, mourut assassiné. Son éloge fut fait le 6 septembre de la même année au concile d'Avignon par le légat du pape Innocent Ill. Un Pierre de Boëge, religieux de l'ordre des Frères mineurs capucins arbitra un conflit entre Henri, évêque de Genève, prieur de Saint-Victor et Jean de Troinex, au sujet de torts que ce dernier aurait causés à l'Église.
C’est encore un autre Pierre de Boëge et son épouse Léonette qui reconnaissaient en faveur de l'Église de Genève, tout ce qu'ils tenaient d'elle en fief dans la vallée. Le 1 décembre 1333, Raymond de Boëge, seigneur de Rochefort, dans son testament rédigé en son château de Rochefort, demanda à être enterré dans l'église de Boëge, au tombeau de ses ancêtres et il laissait à sa femme Briande la grangerie du Villard-de-Boège.
Le fils de ce dernier, Pierre, avait épousé Catherine de Miolans. Il affranchit les hommes taillables de la vallée ne se réservant que l'hommage pour les biens qu'ils tenaient de lui en fief .
Son fils Antelme, qui avait épousé Pernette de Compey, ne laissa que deux filles, Guigonne et Catherine si bien que les châteaux de la famille passèrent en d'autres mains par suite de l'extinction de la descendance masculine.
Guigonne, dame de Boëge et de Rochefort, par acte en date du 12 mars 1458, reconnaissant que plusieurs de ses taillables ne pouvaient supporter les charges dont ils étaient grevés et s'expatriaient, abandonna une partie de ses privilèges et ne retint que ceux qui étaient communément reconnus en Faucigny.
Devenue veuve de Jean de Beaufort, chancelier du duché de Savoie, dame Guigonne épousa Jean de Blonay, bailli du pays de Vaud et mourut sans postérité.
Sa sœur Catherine, épouse de Guigon de Rovorée, seigneur de Cursinges, ne laissa qu'une fille, Claudine, qui hérita de sa tante et fit entrer tous les biens des seigneurs.
Son fils François-Melchior qui mourut avant son père sans descendance mâle laissa cependant deux filles : Jeanne, qui devint marquise de Lucey et Prospère, entrée au monastère de la Visitation de Thonon. Avec elles s'éteignit la brillante famille des Montvuagnard dont les biens furent unis à ceux de Victor de la Valdisère qui avait épousé la veuve de François Melchior, Catherine de Charmoisy.
Les demeures seigneuriales
Il est intéressant de situer les demeures seigneuriales de la famille de Boëge.
Elle résida successivement aux châteaux de Rochefort, de Marcossey et de Boëge, ce dernier au centre du bourg.
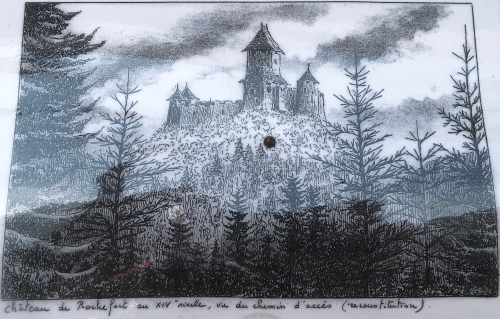
Au sujet du château de Rochefort, on trouve une note écrite au XVIIIe siècle dans les archives départementales qui le décrit: "Ce château est le plus ancien du pays. Il est appelé dans d'anciens titres Castellum de Rupeforte, de la Rochefort. Il avait été bâti sur une élévation au pied des Voirons et semble avoir été inhabité depuis le milieu du XIIe siècle, époque où les seigneurs de Boëge, construisirent celui de Marcossey. Il défendait le pas de Saxel, par où on pouvait se rendre du Chablais dans la vallée de Boëge et de là dans les vallées de Saint-Jeoire et de Fillinges."
Il est à noter que ce château appartint, de tout temps, aux seigneurs de Montvuagnard, soit de Boëge, qui prenaient le titre de seigneurs de Rochefort et de Boëge.
Les masures du château de Rochefort couvrent un assez grand espace et sont tout à fait considérables.
On raconte que ce château fut rasé et détruit lors des guerres et des inimités qui existèrent entre les comtes de Savoie et les comtes de Genève, ainsi que les seigneurs du Faucigny.
Ces ruines ont maintenant complètement disparu. Il est cependant facile de reconnaitre l’emplacement: un peu plus bas que le village de « Chez Neveu », entre le défilé étroit qui conduit aux Voirons, par le Pennaz et la route qui de « Chez Dupuis » aboutit aux Granges Gaillard, sur le petit éperon boisé qui se détache de la montagne, tel qu'on peut le voir de « Chez Ceria » sur la route de Saxel.
Source fournie par Nano.M:
- panneaux trouvés pendant la visite.
Posté le 06-05-2023 12:40 par Jimre
Rocafort
Château de Rocafort, ou château de Boëge ou Rochefort
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : Boëge
Description
Le château est situé au nord-ouest de Boëge, au pied du massif des Voirons. L'emplacement des ruines domine la vallée menant au col de Saxel, sur un éperon rocheux à 950 mètres d'altitude et sont importantes à plus d'un titre. Ces ruines sont importantes comme superficie, mais le donjon est rasé au niveau du sol ; seuls les murs de l'ancienne habitation sont encore assez élevés. Malgré cela il vaut la peine d'être étudié, tout d'abord par les dimensions imposantes et ensuite parce qu'il semble être un des plus vieux bâtiments du pays.

L'accès difficile et le relief naturel accidenté renforçaient la valeur défensive du site totalement isolé par le rocher. L'entrée se faisait par la cour basse. Cet ensemble fortifié comprenait trois parties : un noyau central constitué par le donjon carré et des logements d'habitation, flanqué de part et d'autre par deux cours intérieures cernées par un mur d'enceinte. Le donjon mesurait 8,50 mètres de côté et ses murs avaient une épaisseur de 2,40 mètres.
Les maçonneries présentent une alternance de pierres plates et d'assises en gros blocs.
Le château évoque le type de construction du premier âge roman. La tour circulaire et les bâtiments situés plus à l'est appartiennent à un aménagement postérieur.
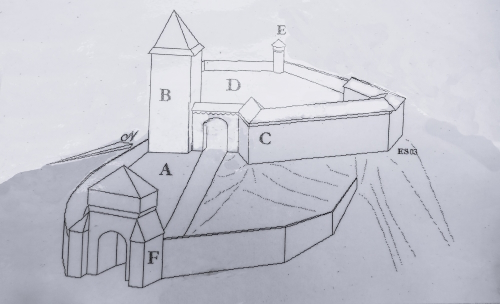
Le château de Rochefort, situé dans la province médiévale du Faucigny, fut la forteresse d'origine de la famille de Boëge qui semble avoir eu une forte emprise territoriale sur la région dès le Moyen Age. Simon et Pierre sont cités vers 1138.
Des conflits permanents ont lieu entre ces seigneurs et les abbayes d'Aulps, de Sixt et du Vallon. En 1170, l'évêque Arducius déclare qu'il a résolu les problèmes entre Pierre de Boëge (Buatio) et Sixt concernant les terres contestées.
En 1268, un document écrit nous précise que le chevalier Pierre reconnaissait tenir de Béatrice et du dauphin de Viennois, seigneur de Faucigny, le château de Rochefort.
L'année 1305 commence en fanfare. Les Faucignerans ayant achevé en janvier la construction d'un château de fort belle allure à Lullin, Amédée V le considérant menaçant pour ses territoires envoie son fils Édouard, jeune et redoutable chef de guerre, l'assiéger. La forteresse est prise en quelques jours. En réaction, le comte de Genevois et Jean II, fils du dauphin, assiègent le château de Boëge qu'ils prennent le 7 juin. Ils y sont installés depuis deux jours lorsqu'Édouard les attaque à son tour et reprend le bien de son père le 25 juin, après 16 jours d'encerclement. Pendant ce siège et en représailles, les forces delphino-genevoises s'emparent de deux maisons fortes : Villette le 16 juin dans la campagne genevoise et Brens le 18 juin, au pied des Voirons.
Les sires de Boëge s'implantent alors au château de Marcossey. En 1434, le mariage de Claudine de Boëge avec Jean de Montvuagnard amène le château dans la famille de ce dernier.
Dans un inventaire du 12 juin 1648, l'on peut voir deux seigneurie à Boëge : " seigneur Prosper Montvuagnard, seigneur de Boëge, d'une part, et généreux seigneur François Melchior de Montvuagnard, seigneur de Rochefort.
Par la suite se succéderont les familles de la Valdisère, les de Ville, et enfin aux Maréchal de Duingt.
Au XVIIIe siècle, il ne reste que des pans de murs et des tas de pierres.
Pour être complet, signalons donc à visiter le château de Marcossey, du côté de Saint-André, ainsi que le château de Montvuagnard au centre du village.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Gombert, éditions Neva
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos:
- Nano.M (2023)
Vidéos:
Nous vous présentons une vidéo YouTube, de Rocafort tournée par nos soins.
Une autre vidéo de Nsl Manu dans laquelle on peut voir le château de Rocafort il y a quelques années en hiver.
N'hésitez pas à aller faire un tour dans notre playlist Rhône Médiéval pour voir nos autres vidéos ainsi que sur la playlist "Les Invités de Rhône Médiéval" pour voir des vidéos réalisées par d'autres personnes sur la même thématique…
Si vous voulez voir les vidéos que nous faisons lors de nos déplacements en dehors de cette thématique, la playlist des "Videos de vacances" est également disponible.
Posté le 06-05-2023 11:51 par Jimre
Beaumont
Ruines de Beaumont
Base de donjon et vestiges. Ruiné en 1590.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 12:17 par Jimre
Mornex
Château de Mornex
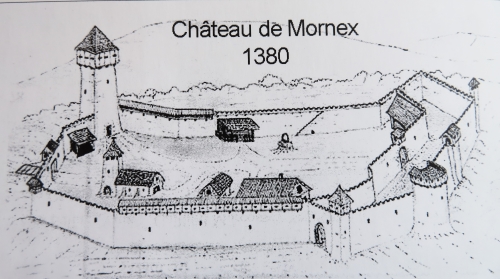
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : Reignier
Sur la commune de Monnetier-Mornex, les vestiges du château couronnent un promontoire rocheux
appelé depuis le XIXe siècle, mont Gosse, du nom du naturaliste genevois,
Henri-Albert Gosse, qui acheta la forteresse en 1802.
Propriété privée.
Histoire
Bien que plusieurs sites fortifiés portent le toponyme de
Mornex, tout porte à croire qu'à l'époque médiévale ce château fut le berceau
de la famille de Mornex. Celle-ci est citée en 1137, où l'on mentionne Freordus
de Mornex, feudataire du comte de Genève, qui assiste à une charte concernant
les propriétés de Saint-Victor dans la région.
En 1304, Amédée de Genève et Hugues, seigneur de Faucigny
concluent une transaction au sujet de la construction du château de Gaillard,
au château même de Mornex.
La seigneurie resta longtemps sous l'autorité des comtes de
Genève. En 1392, c'est Pierre V, comte de Genève et sa femme Marguerite de
Joinville qui sont propriétaires; puis Amédée VIII acquiert la châtellenie.
Ensuite Mornex fait partie d'un apanage de la Maison de Savoie et des
Savoie-Nemours.
En 1595, Charles-Emmanuel de Savoie vend le château à noble Claude
de Marolles. Le 21 février 1682, Mornex est érigé en marquisat en faveur de
Thomas de Graneri La Roche qui est propriétaire jusqu'au XVIIIe siècle. En
1802, Henri-Albert Gosse acquiert la fortification et érige un « temple aux
grands hommes de la science » dans la propriété.
Description
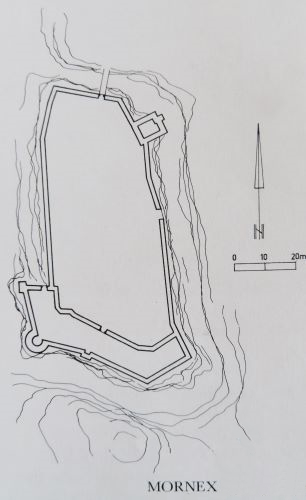
Le plan est celui d'un polygone de 85 mètres de long sur 40 mètres de largeur, épousant les contours de la roche. Le promontoire est isolé par des
fossés et défendu par une enceinte maçonnée flanquée d'une tour carrée au nord-est
et par une barbacane constituant un couloir clos donnant accès au château
proprement dit.
La première entrée était au nord, gardée par le donjon de 9
mètres de côté. La deuxième entrée était percée dans la courtine intérieure et
permettait d'arriver dans la demeure seigneuriale après avoir franchi la
barbacane. Une autre porte fut percée lors d'une deuxième campagne de
construction.
Les logis s'appuyaient sur le mur occidental et comprenaient
au XIV e siècle une salle " ancienne " une autre salle chauffée, la
chambre du seigneur et une chapelle. Dans la cour était creusé un puits pour
l'alimentation en eau.
Ce château appartient au type de fortification de montagne dont le plan est adapté à la situation topographique et dont les qualités défensives sont essentiellement tirées de la pente naturelle et de l'accès difficile.
Sources fournies par Nano.M:
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
-Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 12:15 par Jimre
Montfort
Le château de Montfort à Archamps
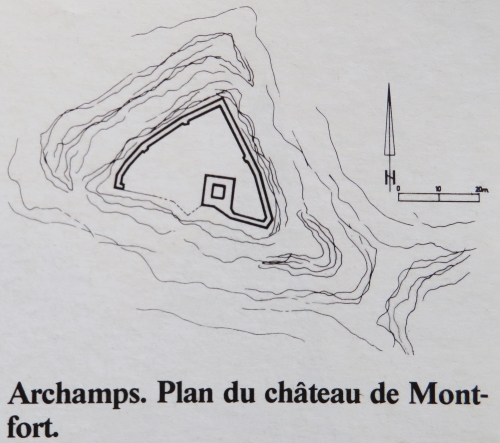
Il appartenait déjà au Moyen Âge à une branche des Ternier, les Montfort.
On relève en 1293 qu'Aymon de Montfort, qui détenait la charge de gonfalonier (porte-étendard), se porte caution pour le comte de Genève.
Le domaine, en 1470, passa, par mariage, aux Allinges.
Ceux-ci le revendirent en 1594 aux Vidomne de Charmoisy.
Il était déjà en ruine en 1547.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Gombert, éditions Neva,
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.
- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 12:10 par Jimre
La Bâthie
La Bâthie d'Arthaz
Haute-Savoie - Saint-Julien-en-Genevois
Canton : Annemasse
La Bâthie ou la Bâtie-Dardel ou d'Arthaz . Emprunter la N 205 reliant Nangy à Vétraz-Monthoux, au lieu-dit La Forge, tourner à droite.
Les ruines se situent 500 m à l'ouest, au bord des falaises dominant le cours de la Ménoge.
Propriété privée.
Historique
L'histoire de cette fortification ou "Bâtie Dardel " (Bastida Dardellorum) est à mettre en relation avec la position stratégique qu'elle occupe. En effet, elle défendait le tracé de la voie ancienne se dirigeant d'Annemasse à Bonneville et commandait le passage du gué qui permettait de franchir la Ménoge avant la construction du pont.
La famille Dardel qui détient la forteresse est parente de la dynastie des comtes de Genève, Guillaume Dardel est cité en 1124. Celle-ci était placée sous l'autorité des Faucigny pour ce château. En 1279, Mermet Dardel leur prête hommage pour la bastitam de Artas.
Dans l'état actuel de la recherche, nous ne pouvons dire de quand date cette construction, cependant, de nombreux textes mentionnent l'importance de ce site. Au XIVe siècle, le châtelain de Bonne spécifie que des messagers ont été envoyés dans différents châteaux pour que des hommes en armes se rendent à la Bâtie.
En 1342, on cite le castrum Bastide Dardellorum en tant que fortification dépendant des Faucigny, Guillaume et Pierre Dardel en étant les vassaux. Au XIV e siècle, le château passa aux Thoire par voie de mariage. En 1703, c'est le comte de Bonne, François Du Clos dit du Fresnoy qui est propriétaire de la Bâtie alors en ruines.
Description
Il s'agit d'une fortification de plan rectangulaire de 90 mètres de longueur et d'environ 40 mètres de largeur, défendue par un fossé au sud et par la Ménoge au nord. Une tour principale de 8 mètres de côté commandait le passage du gué ; une autre tour défendait le côté sud-ouest. Au sud, un corps de logis s'appuyait à l'enceinte maçonnée.
Ce type de forteresse aux vastes proportions ne correspond pas exactement à la définition que l'on donne habituellement aux bâties de plan régulier mais s'apparente davantage aux châteaux à vocation essentiellement militaire.
Source fournies par Nano.M:
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard - Elisabeth Sirot, Editions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 12:07 par Jimre
Vétraz-Monthoux
Château de Monthoux
Haute-Savoie - Arr. : Saint-Julien-en-Genevois
Canton : Annemasse
Les ruines du château et de son bourg subsistent sur la rive droite de l'Arve, couronnant un mamelon à 567 m d'altitude. Les vestiges dominent la D 907 reliant Annemasse à Bonne et la N 205 se dirigeant vers Bonneville.
Propriété privée.
Histoire
L'histoire de la fortification ou castrum est connue à partir du milieu du XIII e siècle. En 1245 Aimon de Faucigny est autorisé par le pape, à construire une chapelle dans son château de Monthoux qu'il vient d'édifier. Innocent IV précise que le seigneur a le droit d'entretenir un curé et de bénir un cimetière. Une rivalité entre Simon de Faucigny et l'évêque surgit, ce dernier étant hostile à l'implantation d'un nouveau lieu de culte à côté de l'église paroissiale. Une nouvelle bulle papale datant de 1249, exempte le châtelain de Monthoux de la juridiction de l'évêque, le protégeant ainsi des agressions du curé de la paroisse de Vétraz.
Le 15 novembre 1269, la seigneurie est donnée en gage par la dauphine Béatrice à sa tante Béatrice, dame de Thoire et de Villars. En 1270, le château reste en gage à Philippe de Savoie. Puis Béatrice, dauphine du Viennois, cède le château à Amédée de Savoie qui l'inféode à Béatrice, celle-ci lui prêtant hommage.
En 1304, un acte est signé entre Amédée de Genève et Hugues seigneur de Faucigny, qui se prêtent défense mutuelle pour les châteaux de Gaillard et de Monthoux. En 1308, Monthoux revient définitivement à la Savoie. Cette place forte tient un rôle très important dans les guerres médiévales.
Du 23 au 26 juillet 1332, Hugues de Genève, s'empare du bourg de Monthoux et assiège le donjon. Les habitants du château capitulent. Le comte de Savoie, venant de Seyssel, arrive le 26 Juillet avec 3000 hommes. Une bataille mémorable est livrée et le château est repris par le comte de Savoie le 28 Juillet.
Les comptes de châtellenie permettent de connaitre le détail des constructions entreprises après cette bataille dévastatrice. En 1518, le bourg abritait encore 26 feux.
Au XVe siècle, Monthoux perd de son importance en raison des conflits qui vont désormais se dérouler plus loin. Le château est inféodé à plusieurs familles dont les Guillet de Monthoux qui cèdent les vestiges de la fortification à l'évêché.
Description
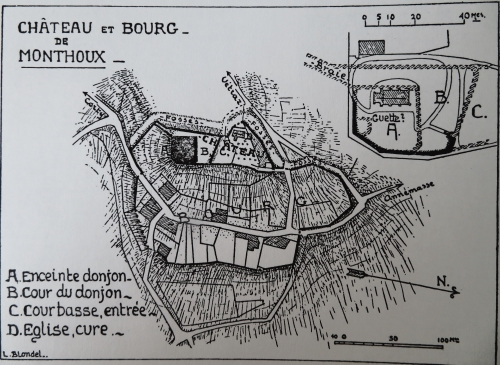
Il s'agit d'une vaste fortification cernée par une enceinte maçonnée comprenant un bourg avec eglise et cimetière et un château dominant l'ensemble.
Le dispositif fortifié se composait l'origine de deux grands enclos murés et séparés par une cour basse, munie d'une porte. Un donjon quadrangulaire s'appuyait sur le mur d'enceinte et commandait l'accès du bourg. Il constituait le réduit défensif et l'ultime refuge pour les populations assiégées qui venaient s'y abriter en cas d'attaque.
Les logis s'élevaient plus au nord. Une poterne renforcée par une tour permettait d'accéder au bourg s'étendant au niveau Inférieur.
Actuellement, il est difficile d'imaginer la forteresse primitive. L’ancienne église a été transformée en appartements d'habitation et une chapelle moderne a été édifiée sur les bases du donjon.
Seuls les récits de bataille au XIVe siècle et une gravure ancienne donnent une idée de la puissance de cette place forte dominant la plaine.
Source fournie par Nano.M:
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard - Elisabeth Sirot, Editions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 12:02 par Jimre
Les Rubins
Château des Rubins
Propriété de la ville.
Histoire et description
La maison forte fut édifiée au XIVe siècle et appartient aux de Loche a partir de 1563. Elle est ensuite rachetée par le chapitre de Sallanches. L'édifice se situe sur la rive gauche de la Sallanche. Il est encore reconnaissable avec sa haute tour carrée percée de fenêtres a meneaux. A l'intérieur de cette tour, on reconnait encore un escalier à vis desservant les appartements.
Source fournies par Nano.M:
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard - Elisabeth Sirot, Editions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 11:59 par Jimre
Boringe
Château de Boringe
Le château se situe sur la rive gauche de l'Arve dans la commune de Reignier, à un kilomètre du pont de Findrol.
Propriété privée.
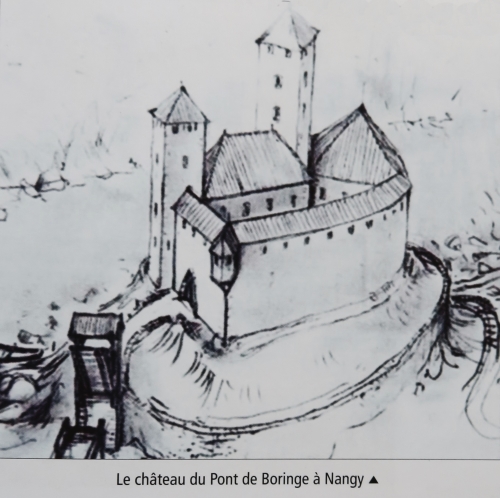
Histoire
Ce château commandait l'accès d'un petit pont très ancien, mentionné dès 1225, lors d'une querelle entre le comte de Genève et les Faucigny, au sujet du « pont sous Faucigny ». Ce passage sur l'Arve était très important car il se trouvait à l'intersection des possessions des Faucigny et des comtes de Genève, c'est-à-dire des mandements du Credo et du domaine de Nangy.
En 1242, un conflit est cité à propos du péage relevant du comte de Genève entre les habitants de La Roche et ceux de Cruseilles.
Le château lui-même n'est cité en tant que tel qu'en 1263 comme faisant partie des importantes constructions fortifiées, élevées par Pierre de Savoie et Agnès de Faucigny. En 1296, Béatrix de Faucigny inféode Boringe au chevalier Guillaume, seigneur de Confignon. En 1319, Hugues, dauphin, cède à Humbert de Cholay, le château et le mandement du pont de Boringe. Ce dernier laisse la propriété à son frère utérin, Nicod de Fernay. Puis le château est transmis par voie de mariage aux Genève-Lullin. En 1591, le château est assiégé par les troupes genevoises et bernoises et le pont est démoli. En 1693, la seigneurie est inféodée Janus Noyel de Bellegarde et érigée en comté.
Au XVIIIe siècle, la famille des Burnier Fontanel de Villy possède le domaine ; il est racheté en 1850 par le Docteur Bizot qui effectuera des fouilles et restaurera le château.
Description
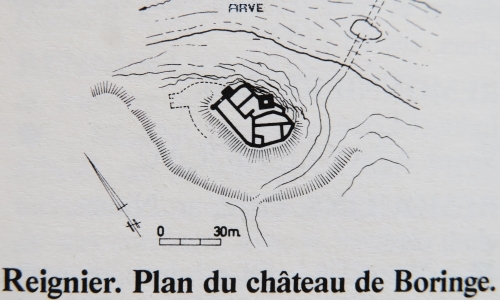
Actuellement, le château est ruiné et seules des descriptions anciennes et la mappe sarde conservent le souvenir de cette imposante fortification.
Plusieurs périodes de construction apparaissent : une première est constituée par un donjon carré élevé sur un rocher dominant l'Arve avec une chapelle. Les courtines, concernant la cour intérieure et les bâtiments du sud-est, sont attribuables à une seconde période de construction, plus adaptée à la résidence. La porte d'entrée, précédée d'un pont-levis, est encadrée de deux tours d'époques différentes, l'une carrée est ancienne, l'autre ronde, est plus tardive.
Le plan d'ensemble a subi de multiples transformations, mais l'impression d'une place forte importante, limitée par de larges et profonds fossés, demeure. Sa situation topographique est tout à fait propre à la défense et sa valeur stratégique est renforcée par le passage du pont sur l'Arve, au pied du château.
Le visiteur aura la surprise aujourd'hui de découvrir de belles ruines romantiques.
Les historiens Spon et Guichenon racontent le récit d'une bataille pittoresque lors de la guerre entre Genève réformée et la Maison de Savoie au XVIe siècle. « Arrivés fort tard dans la nuit devant le château de Boringe, les troupes campèrent sur les deux rives de l'Arve et, au point du jour, mirent les canons en batterie. La cavalerie napolitaine, venue de La Roche au secours de Boringe, fut surprise près de Magny. Sancy, qui s'était porté à la rencontre des Napolitains, revint bombarder Boringe avec acharnement. Le lendemain, après avoir essuyé soixante-douze coups de canon, la garnison demanda à capituler avec les honneurs de la guerre.
Devant le refus des assiégeants qui les menacèrent même de ne pas faire de quartier s'ils attendaient l'assaut, les Savoyards s'échappant par une poterne, réussirent à gagner le pont d'Arve et se dirigèrent sur Bonne. Sancy occupa le château qu'il fortifia, mais ne pouvant s'y maintenir, il démolit la forteresse et quitta le Faucigny avec ses troupes, le 15 janvier 1591. Les Savoyards occupèrent le château qu'ils réparèrent ».
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath,
- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 11:57 par Jimre
Bonne sur Ménoge
Château de Bonne-sur-Ménoge
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : Bonneville
Il ne reste rien du château ; les fortifications ont été détruites et à leur emplacement sont établies des villas avec jardins.
Histoire
La situation stratégique exceptionnelle de Bonne, au carrefour des routes venant de Genève par Annemasse, de celle menant à Bonneville et à la vallée de l'Arve et de la route conduisant à la vallée du Giffre, conféra à Bonne une importance certaine attestée par l'implantation d'un bourg fortifié.
La fortification est divisée en deux parties :
- Haute-Bonne où se dressaient le château et l'église Saint-Nicolas et Basse-Bonne ou « Pied d'Aye », c'est-à-dire située au pied des «aia », terme qui désigne au Moyen Age les fortifications ou défenses. - Basse-Bonne était le siège de l'église paroissiale Saint-Pierre édifiée plus à l'est, hors les murs.
La plus ancienne mention du site remonte à 1246 où l'on voit Aimon de Faucigny confirmer une donation faite par Etienne de Siraz à Bonne : « actum apud Bonam ». Nous ne savons à quel moment fut implanté le bourg castral, cependant il semble que très tôt, Bonne ait été le siège d'une importante châtellenie du Faucigny.
En 1293, Béatrice de Faucigny, grande dauphine de Viennois, fait don de Bonne à Amédée, comte de Savoie qui lui réinféode le fief un peu plus tard.
Pendant les guerres delphino-savoyardes, la fortification de Bonne a constitué une véritable place forte du dauphin et les comptes de châtellenie font état à plusieurs reprises de travaux de réparation du château.
Au XVIe siècle Bonne fut le point d'appui essentiel des armées savoyardes et les troupes de l'Escalade partirent du château en 1602 pour Genève.
En 1681, les fortifications sont détruites et l'ensemble est érigé en comté en faveur de Charles Duclos de Fresnoy.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Gombert, éditions Neva
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 29-03-2023 11:42 par Jimre
Pierre
Château de Pierre à Nangy
En préambule, nous mettons cette information sur le château:
Attention, c'est une propriété privée, et le site en ruine est potentiellement dangereux. Il est préférable de le visiter pendant les Journées du Patrimoine.
Merci à Mme Coutaz-Repland pour l'information 8;-))
Haute-Savoie Arr. : Saint-Julien-en-Genevois
Canton : Reignier
Les vestiges se situent sur un roc isolé, au sud-est du village de Nangy, le long de la RN 205 en direction d'Annemasse.
Histoire
La famille de Nangy, qui est à l'origine de cette fortification, est citée dès 1083, date à laquelle Guy et Amédée de Nangy assistent à la fondation du prieuré de Contamines-sur-Arve en tant que premiers témoins de l'évêque.
Amédée et Rodolphe sont mentionnés en 1188. Rodolphe est otage du comte de Genève en 1219, pour mille sous.
Cette lignée s'éteint rapidement puisque dès le début du XIIIe siècle, les héritiers sont les Faucigny, puis les Confignon qui doivent, pour le château de Pierre, hommage au comte de Genève.
Le château passa ensuite aux Cholex, aux Ferney puis aux Lullin. Au XVIIIe siècle, ces derniers porteront le titre de comtes de Nangy.
Le 14 juillet 1589, la forteresse est dévastée lors de l'Escalade par l'armée bernoise et les troupes genevoises, qui après avoir mis le siège devant Boringe, anéantissent le château de Pierre à Nangy.
Description
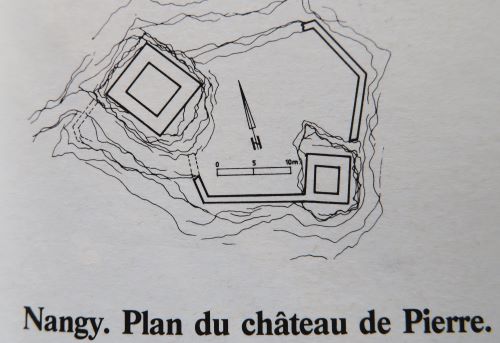
Il convient de rappeler la position stratégique avantageuse du château, élevé sur un rocher inaccessible et dominant la route menant au pont sur l'Arve et celle reliant Bonneville à Genève.
La fortification a malheureusement été dévastée par les pilleurs de pierres et par l'aménagement d'une carrière au pied du rocher qui la supporte. Cependant, le plan est encore identifiable et les fondations subsistent avec quelques pans de murs. Le château comprend un donjon quadrangulaire et une tour carrée au sud, reliées par une enceinte polygonale maçonnée cernant entièrement la plateforme rocheuse qui sert d'assiette à la forteresse.
Le donjon mesure 9,10 m x 9,30 m et abrite à l'angle nord un renfoncement intérieur d'environ 1 m x 0,95 m destiné à placer une échelle pour accéder aux étages. L'entrée au premier a disparu les étages étaient simplement séparés par des planchers.
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.
Photos:
Posté le 29-03-2023 11:38 par Jimre
Les Allinges
Les Allinges Château-vieux
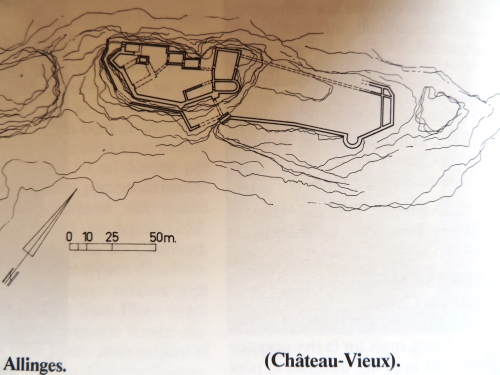
A 10 Km au Sud-Ouest de Thonon par la D903, situées sur la colline des Alinges / Allinges, on peut voir deux ruines de châteaux distincts dont les enceintes englobaient chacune un village. A droite Château-Vieux, qui appartenait aux Barons du Faucigny, dominait Chateau-Neuf, le plus vaste, propriété des Comtes de Savoie (XIIe siècle ).
Espacés de 100m par deux fossés, ils se livrèrent durant trois siècles à des bagarres perpétuelles.
Chapelle romane du XIème siècle qui possède la plus ancienne fresque de Savoie.
Le site est ouvert toute l' année de 7H30 à 21H - Entrée gratuite
Infos & Contact
Adresse: Mairie d'Allinges
53, rue Crêt-Baron
74200 - Allinges
Téléphone : +33 450 742 118
Origine:
L'ermite-pélerin de Bange cherchant l'origine du mot Allinges cite plusieurs hypothèses dans son livret de 1843 : Pèlerinage aux Allinges. Celles-ci n'ont rien de sérieux. « Les uns, assure-t-il, le font dériver de ad ligna (dans les bois) ; d'autres d'ad lingua (sans langue ou sans langage) ; d'autres encore, plus de vraisemblable, selon lui, — du mot teutonique alleinig (unique), que justifierait l'admirable et exceptionnelle position des Alinges, à moins que ce nom germanique n'appartînt aux seigneurs burgondes qui construisirent ou habitèrent le château... ».
La Seigneurie:
Sa Devise: " Sans Varier "
Les seigneurs d'Alinges existaient déjà dès l'an 1000, et selon les observation de "Grillet", l'ancien bourg des Alinges devait avoir une grande importance considérable dans le Chablais, au fait que le curé de cette paroisse,qui était l'un des huit doyens ruraux de ce diocèse, siégeait dans les assemblées générales du clergé, immédiatement après l'évêque et le prévôt.
La maison d'Alinges est d'ancienne chevalerie dont plusieurs seigneurs de cette maison se sont illustrés en différents siècles, par leurs emplois militaires, et par plusieurs ambassades.
Le Château-Vieux
Le château est situé sur une colline dominant Thonon situé à à deux lieues, soit 10 km, et offre une vue très étendue sur toute la plaine du Léman et la côte du canton de Vaud.
Châteauvieux fut édifié par les Burgondes, et au gré du temps, échoue au XIIe siècle dans les mains des seigneurs de Faucigny qui y placent une garnison sous les ordres d'un sénéchal.
1270, 13 février: Compromis entre Béatrix, dame de Thoire et Villars, et ses fils Humbert et Henri, d'une part, et Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, d'autre part. Les parties remettent à Philippe, comte de Savoie, le jugement de leurs différends au sujet de la succession de feu Aymon de Faucigny. On remet en gage, entre les mains de Philippe, les châteaux et terres de Faucigny, du Crédo, de Montoux, d'Alinges le vieux, de Cursinges, d'Hermance, d'Aubonne, etc. "Actum Camberiaci, anno domini MCCLXIX, die Jovis post octavam purificationis beate Marie. ( v. st.)"
En 1285, il dépend du comte de Savoie, qui le conservent jusqu'en 1355:
La fin de la lutte entre les deux châteaux, sonne le glas d'Allinge-le-Vieux, et sera définitivement abandonné à la fin du XIVe siècle.
La Chapelle d'Alinges:
François de Sales écrivit sans doute ici, et sous l'influence d'une température semblable, que le feu est bon pendant douze mois de l'année.
La chapelle, lieu de pèlerinage, n'a rien de remarquable. On découvre, sur les murailles du chœur, quelques traces de fresques, et on montre sous un globe de verre le chapeau de l'apôtre du Chablais.
Ce petit édifice, éclairé par des ouvertures en forme de croix, présente sur sa façade deux tablettes de marbre avec des inscriptions latines.
En voici la traduction: " Après deux cents ans, l'oratoire de la forteresse des Allinges, obstrué de décombres énormes, alors que tout croulait autour de lui ayant été conservé intact par la divine Providence, fut restauré, grâce aux travaux et aux dons volontaires des fidèles, aux offrandes du clergé chablaisien et surtout au zèle, à la piété et à la libéralité de Pierre-Joseph Rey, très-illustre et très-vénérable évêque d'Annecy, l'an du salut 1836. ".
La seconde inscription porte ce qui suit : "Ici le bienheureux de Sales répandit des larmes et pria ardemment pour des concitoyens égarés qu'il trouva d'abord ennemis déclarés de l'Eglise catholique et qu'il finit par rendre ses plus fidèles enfants. Accourez donc auprès du pasteur, de l'apôtre, du père, peuples du Chablais , accourez étrangers, accourez Genévois ! ".
Récit de la conservation miraculeuse de la chapelle: " Environ cent ans après la mort de saint François de Sales, c'est-à-dire au commencement du dix-huitième siècle, le roi Victor-Amédée II fit démolir la forteresse des Allinges, et les matériaux furent vendus. La chapelle, on ne sait comment, demeura debout, environnée et couverte de décombres et exposée à toutes les injures du temps. Un siècle plus tard, à l'époque de la Révolution française, quelques vandales du philosophisme et de l'impiété l'aperçoivent et frémissent de rage. L'ordre est donné de la raser entièrement. Les hommes chargés de cette inique mission arrivent sur la colline. A l'aspect de ce monument religieux auquel se rattachent de si doux souvenirs, une force surnaturelle semble enchaîner leurs bras ; ils s'en vont sans avoir osé toucher cet édifice. Mais effrayés par les menaces de ceux qui les avaient envoyés, ils reviennent à la charge et se disposent à renverser la chapelle, quand tout à coup un orage des plus terribles les disperse et les force de renoncer à cette entreprise. Dès lors ce projet odieux fut oublié, et la chapelle demeura, comme auparavant, en butte aux intempéries des saisons. Sa voûte était surchargée, dans toute son étendue, d'un tas de décombres qui avait quinze pieds d'épaisseur. On a peine à comprendre comment elle n'a pas été écrasée sous ce fardeau. ".
Enfin l'oratoire fut réparé et rendu au culte eu 1836. On y célèbre chaque année un tedeum avec indulgence plénière, les 14, 15 et 16 septembre.
Ce fut à celui de 1843 que prit part l'ermite de Bange. L'évêque d'Annecy s'y rendit, et on lui fit une réception pompeuse avec cavalcade de gens portant des lances de bois, détonations de boîtes, grand branle de cloches, gardes d'honneur, etc.
- site haute-savoie.ialpes.com
- Plan fourni par Nano.M d'après: Châteaux, et maisons fortes Savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, Editions Horwath.
Posté le 22-03-2023 17:01 par Jimre
Les Allinges
Les Allinges-Château-neuf
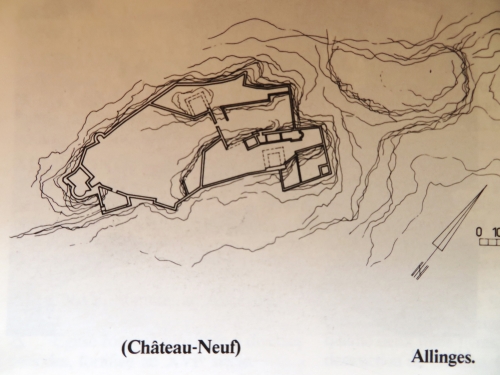
A 10 Km au Sud-Ouest de Thonon par la D903, situées sur la colline des Allinges, deux ruines de châteaux distincts qui dans leurs enceintes englobait chacun un village. A droite Château-Vieux, qui appartenait aux Barons du Faucigny, dominait Chateau-Neuf, le plus vaste, propriété des Comtes de Savoie (XII ème siècle ).
Espacés de 100m par deux fossés, ils se livrèrent durant trois siècles à des bagarres perpétuelles.
Chapelle romane du XIème siècle qui possède la plus ancienne fresque de Savoie.
Le site est ouvert toute l' année de 7H30 à 21H - Entrée gratuite
Infos & Contact
Adresse: Mairie d'Allinges
53, rue Crêt-Baron
74200 - Allinges
Téléphone : +33 450 742 118
Pour accéder au site des Châteaux des Allinges, vous pouvez vous rendre en voiture jusqu’à l’entrée du site. Un parking gratuit permet le stationnement d’une douzaine de voitures. Mais vous pouvez y accéder à pied par trois itinéraires de randonnée différents depuis Allinges : Chemin Rural d’Allinges à Châteauvieux, la Rue d’en Haut, le chemin du Pré de la Mare qui rejoint la Rue d'en Haut.
----------------------------------
Châteauneuf est situé à l'extrème nord du même coteau que Châteauvieux, séparé d'une distance de 150 mètres.
Il sera édifié au Xe siècle par Rodolphe II, roi de Bourgogne et son successeur Rodolphe III:
Il passera ensuite aux maisons de la maison de Savoie et sera le centre d'une importante châtellenie.
Les grandes dates de Châteauneuf:
- Guillaume de Solier, châtelain d'Alinge-neuf (1249). Hommage en en 1293 par Béatrix au comte de Savoie.
- Aymon de Sétenay, châtel, en 1296.
- Inspection du château en 1303 par le bailli de Savoie.
- Hugues de Faucigny engage en 1307 Alinge-le-vieux aux citoyens de Genève.
- Fief de Savoie en 1308.
S'en suivront de nombreux conflits entre les deux châteaux, opposant la Maison de Savoie, qui possède Allinges-Neuf, et les dauphins de Viennois, héritiers des seigneurs de Faucigny, détenteurs de Château-Vieux jusqu'en 1355, jusqu'à la signature du Traité de Paris mettant fin au conflit entre le comte de Savoie, Amédée VI, le roi de France, Jean le Bon et son fils Charles, Dauphin de France.
Lors de la campagne de Savoie, la guerre est déclarée par Henri IV au duc de Savoie le 11 août 1600, et Châteauneuf, assiégé, se rend le 11 décembre 1600 et est ocupé.
Châteauneuf est de nouveau occupé par les français de 1690 à 1696. En 1703, pendant la guerre de succession d'Espagne, menacé par les troupes de Louis XIV, Victor-Amédée II, fait démanteler la forteresse.
ALLINGES Château Chapelle : classé par arrêté du 13 juillet 1907
Sources:
- site haute-savoie.ialpes.com.
- Plan fourni par Nano.M d'après: Châteaux, et maisons fortes Savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, Editions Horwath.
Posté le 22-03-2023 16:32 par Jimre
Châtelet St Gervais
La maison forte du Châtelet
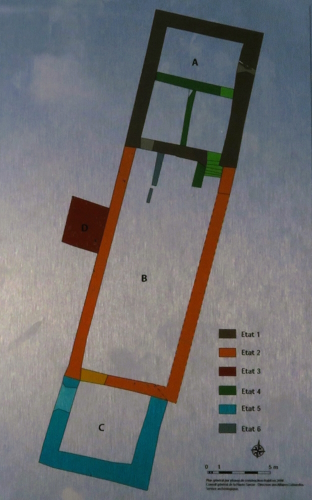
Idéalement placé à l'extrémité nord de ce relief naturel, le
bâtiment initial (A) a été construit au XIIIe siècle et n'a été déserté qu'à la
fin du XIXe siècle.
Cette probable tour, couvrant une surface au sol de 100 m2,
servait d'appui à un bâtiment allongé (B) dont les murs périmétriques furent réutilisés
après sa destruction pour former une enceinte.
Contre celle-ci, au. sud, fut érigée une seconde tour (C)
d'environ 70 m2, dominant l'accès au site qui était protégé par un fossé creusé
à la base de l'éperon.
A l'ouest, une tourelle de 3,20 m x 2,90 m complète le
dispositif (D).
Aux XVe et XVIe siècles, d'importants remaniements ont été
notés dont le creusement de caves dans la tour nord, venant pallier au manque
de surface constructible, alors que l'installation d'un poêle, dans la tour sud
(?), apporte le témoignage d'un certain luxe.
Successivement détenue par les familles De La Croix et Du
Fresney, la maison forte du Châtelet apparaît au XIIIe siècle selon l'étude
archéologique réalisée en 2008.
Elle s'élève sur un étroit crêt morainique surplombant la
rive gauche du Bon Nant, lui conférant un réel intérêt stratégique dans le Faucigny
médiéval par sa position , dominante sur la vallée de l'Arve et son contrôle
des axes secondaires menant de Domancy et Megève vers le Val Montjoie.
En 1730, isolée des zones habitées, elle semble déjà
passablement délabrée et seul le bâtiment nord semble encore habitable.
L'occupation du site cesse à la fin du XIXe siècle, laissant les bâtiments à la ruine. Les interventions archéologiques ont permis de reconnaître le plan de cette construction fortifiée, couvrant une surface de 325 m2 et comprenant quatre espaces élevés entre les XIIIe et XVIe siècles.
Extrait de Passage du Bon Nant (vallée de Saint-Gervais) ; de Bacler d'Abe, 1790. Collection Payot. Conseil général de la Haute-Savoie.
La conservation des vestiges dans ce rigoureux contexte montagnard a entraîné leur consolidation et la pose d'une couvertine en écailles d'ardoises sur les arases de murs, le remblaiement partiel des caves (des éléments métalliques restituent les niveaux d'un plancher et d'une voûte) et de la cour, seule une calade étant préservée alors que quelques alignements de pierres dans le gazon marquent l'emplacement de petits bâtiments disparus.
Analyse et fouilles archéologiques : Conseil général de la Haute-Savoie, Direction des Affaires Culturelles, Service archéologique
Projet de valorisation : Guy Desgrandchamps, architecte DPLG
Travaux de restauration et de valorisation : Entreprise Comte
Source fournie par Nano.M:
- Panneaux présents lors de la visite
Posté le 07-03-2023 15:52 par Jimre
Mussel
On peut apercevoir les ruines de Mussel sur un roc isolé aux environs de Cluses et Scionzier.
Photos:
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:46 par Jimre
Loche
Maison forte de Loche à Magland
La maison forte s'élève au centre du village de Magland, près de l'église.
Une troisième famille de Magland, où l'on constate son existence très anciennement, « bien qu'il soit difficile de fixer le moment où elle a passé de la notabilité à la noblesse » (A. de Foras), est la famille de Loche (De Ochia). C'est devant la maison, proche du cimetière, de Pierre de Loche qu'est ratifié, en 1372, l'albergement passé entre la chartreuse du Reposoir et les communiers de Magland. Elle a une tour et est entourée de vergers.
Un des notables représentants de cette famille, Jean de Loche, fut coseigneur de Servoz et bailli de Faucigny à la fin du XVe siècle. Le 4 septembre 1476, il achète des nobles de Thoire « un chosal de tour appele la Tour Noire, située ès champs de Maglans, plus tous les hommes, hommages, censes, rentes, dîmes, laods, ventes et tous droits féodaux quelconques des vendeurs rière Maglans et Arâche... plus les eaux et rivages des nants traversiers descendant en l'eau d'Arve...et aussi d'Arve et son rivage tel qu'il est depuis la ville de Cluses jusqu'au Pont- Saint-Martin…plus…la montagne d'Anjon avec les bois et autres droits seigneuriaux de ladite montagne, pour le prix de 550 écus d'or».
L'acte est passé à Magland dans la maison forte dudit seigneur de Loche. Son fils, Pierre de Loche, fut également "grand bailli de Faucigny", mourut à Cluses en 1616 et fut enterré à Magland.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:43 par Jimre
La Motte Ayse ou Ayze
Château de la Motte à Ayse
Une page de l'histoire locale
Tout près du chef-lieu, à 100 mètres de la mairie et de l'ancienne voie romaine, se trouve une ruine imposante de château très bien conservée.
D'après certains spécialistes, ce sont même les plus belles ruines du département.
Les cheminées se sont effondrées, mais il reste, à l'intérieur, de très belle choses à voir.
Ce château date du XVe siècle. Il aurait remplacé une ancienne forteresse bâtie sur un monticule, qui lui a donné son nom, "La Motte".
Il possédait à l'origine une grande cour, deux étages et une chapelle dédiée à la sainte Trinité.
En 1754, c'est le révérend père François Vauthier qui en était le recteur. Récemment, deux des propriétajres ont donné mission à une entreprise ayzoise de couper arbres et broussailles sur les parties ouest et sud de la ruine. Du coup, de nombreuses personnes ont découvert ce château, qui était complètement caché par la végétation, depuis de nombreuses décennies.
Sur la clé de voûte de l'entrée côté cour, on trouve sculpté un macaron très bien conservé, représentant une téte grimaçante, symbole des seigneurs de La Motte, les De Quinerit, en latin "qui non ridet" (quine rit jamais).
Un peu d'histoire...
Originaire de Sallanches, cette famille a été anoblie au début du XVe siècle.
On retrouve dans les archives un certain Geoffroy Quinerit, prenant pour épouse Jacquemette, fille de Pierre de "sur la route d'Ayse". Leur fils Nicod, compagnon d'armes du Duc Amédée VIII de Savoie, meurt en 1477 et se fait enterrer dans l'église d'Ayse.
Lors de la fameuse Gabelle du sel en 1561, noble De Quinerit habitait le château avec sa femme Pernette et ses enfants Nicolas, Jehan et Pierre.
La famille conservera le château jusqu'au début du XVIIIe siècle, avec notamment Baltazar de Quinerit, premier Sindic de Bonneville avant 1729.
À l'extinction de la famille, le château passe aux De Menthon-Lornay. Leur fils Guillaume vend en 1748 à Pierre Joseph De Planchamp, marquis de Cluses, qui devient seigneur de La Motte, puis sa petite-fille Eugénie Françoise épouse Jean-François Colomb d'Arcine, qui vend le château en 1852 à un non noble : Ferdinand Broisin, cultivateur à Ayse.
Les trois enfants de Ferdinand, Jean, Julien et Josette, héritent. Cette dernière deviendra veuve de M. Cornut, et elle vendra sa part à François Gantin.
Un procès va opposer les consorts Broisin à Gantin, car à la suite du partage, aucun des trois héritiers n'était en possession de son lot respectif, aucun n'ayant compris les termes d'orientations désignés dans l’acte du partage.
Le procès durera plusieurs années, puis plus tard, le bâtiment fut loué à des réfugiés italiens, venus travailler à Ayze, à la carrière Pérodi de chez Chardon. Un soir de foire de la Saint-Martin trop arrosée, et après une dispute entre locataires, l'un d'entre eux mettra le feu au château, le 11 novembre 1893 selon un témoignage, et depuis, tout est resté en l'état, sauf l'entrée, qui a été restaurée par M. Bailly.
A présent, La Motte est une indivision imposante appartenant à quatre familles, qui résiste plutôt bien aux morsures du temps.
Repères
Cette ruine de château est du domaine privé, et ne se visite pas.
Les Seigneurs de la Motte étaient issus d'une petite noblesse de Sallanches. Ils ont habité également à Taninges, où ils possédaient une maison forte. Cette famille a été anoblie. Elle resta malgré tout très discrète.
La famille De Quinerit portait les armoiries suivantes :
Échiqueté d'or et de sable au chef d'argent et au lion issant de gueule (ces armoiries figurent dans l'Armorial).
Toujours sur le côteau d'Ayze, où l'on cultivait et on cultive toujours un bon vin blanc pétillant, au lieu-dit "La Motte", on peut encore apercevoir, lorsque les arbres sont dégarnis de feuilles, la carcasse du château de La Motte.
L'appartenance à la famille de Quinerit de Sallanches est attestée dès le XVe siècle dans les actes.
Il est constitué d'un bâtiment carré flanqué d'une grande tour carrée à l'entrée et d'une plus petite sur le côté
Source fournie par Nano.M:
- Article de Gilbert PELUER vu dans le Dauphiné Libéré
Posté le 07-03-2023 11:39 par Jimre
La Motte Ayze
Château de La Motte
Ayze ou Ayse
Haute-Savoie — Arr. : Bonneville
Canton : Bonneville
Château de La Motte
A la sortie de Bonneville, prendre la direction de Cluses.
Le château se situe sur une hauteur, en-dessous du village et de l'église
paroissiale.
Propriété privée. On ne visite pas.
Histoire
L'existence d'une maison forte de La Motte, appartenant à la
famille de Quinerit de Sallanches, est attestée dès le XVe siècle. D'après son
toponyme, ce site a vraisemblablement abrité un édifice plus ancien.
Description
Actuellement, des ruines se dressent sur une motte de terre artificielle très endommagée, mais dont on reconnaît bien la structure. Le château de pierre dominant la route de Cluses est encore visible, mais très masqué par la végétation ; il s'agit d'un bâtiment rectangulaire divisé en plusieurs pièces et flanqué d'une grande tour carrée à l'entrée et d'une plus petite sur le côté.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:35 par Jimre
Hautetour
Hautetour
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : Saint-Gervais
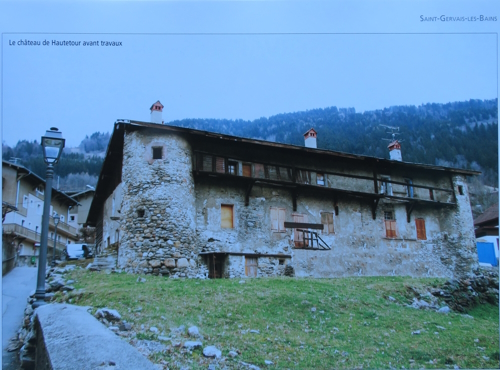
Aux nobles d'Allinges, qui ne résidèrent pas à Saint-Gervais, succéda dans la charge de châtelain la famille du Fresney, dont trois branches vont s'y fixer. Bien que prétendant descendre de la dynastie princière des Faucigny, elle fait partie de cette «noblesse douteuse qui pullulait per fas et nefas aux mandements de Sallanches et de Montjoie » (A. de Foras).
Plusieurs membres sont châtelains à la fin du XVIe siècle. La branche aînée acquiert alors le château de la Comtesse. Au début du XVIIe siècle, Jean-Baptiste est à la fois seigneur de la Comtesse et du Châtelet, de même son fils Claude-Melchior. Par la suite, le titre et la maison forte du Châtelet reviendront à une branche cadette. Louis-Charles, seigneur du Châtelet, va épouser Marguerite de Riddes, d'une famille sans doute originaire du Valais, qui s'est fixée à Flumet d'où elle essaimera dans tout le Faucigny. Leur petit-fils, François-Nicolas, réunira à nouveau les deux titres de la Comtesse et du Châtelet comme héritier universel de Claude-Melchior.
Quelques ruines signalent encore aujourd'hui la maison forte du Châtelet située sur un mamelon dominant la gorge profondément encaissée du Bonnant.
Une autre branche des du Fresney est seigneur de Haute-Tour, maison forte qui domine le chef-lieu. Elle s'illustrera au XVIIe siècle par Ne Sébastien qui, en 1635, sera premier président de la Chambre des Comptes.
Enfin, une troisième branche conserve les biens situés au hameau du Fresney. Un Nicod du Fresney, notaire, y possède à la fin du XVe siècle, une maison qualifiée de « maison neuve probablement maison forte.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos:
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:30 par Jimre
Crédoz
Les ruines du châtelet du Crédoz à
Au milieu de la plaine des Rocailles, sur un rocher, s'élèvent les ruines d'un petit château appelé le châtelet du Crédoz ou Crédo.
Sa construction date probablement du XIIIe siècle. À l'origine propriété des sires du Faucigny, il est cédé en 1293 au comte de Savoie Amédée V.
Au XIVe siècle, on y fabrique des projectiles pour les
machines de guerre qui sont entreposées dans ses murs.
Ils serviront dans la guerre contre les Genevois. En 1355,
avec l'annexion du Faucigny par l'État savoyard, il tombera en désuétude.
Les seigneurs de Mesmes ont été avec les de Thoire et les de
Rossillon les principaux titulaires des fiefs de la paroisse.
Les autres titulaires, du XIIIe au XVe siècle, étaient les
familles de Sauthier que l'on retrouve à La Roche, de Moussy, Déage,
Constantin, Brasier, Floquet, de Porte, Pugin, de Alamandis, Tissot, de Sales,
Troctet ou Mugneri.
En 1700, Victor Amédée II de Savoie l'érige en marquisat
pour le sénateur Maurice Graneri qui est aussi conseiller d'État et ambassadeur
de Savoie à Rome.
Le dernier possesseur du châtelet du Crédoz a été
Charles-Albert de Gerbaix de Sonnaz.
Il n'est plus aujourd'hui qu'une ruine.
Source fournies par Nano.M:
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du Moyen-Age en France, CL Salch, éditions Publitotal
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:26 par Jimre
Crédoz
Le Châtelet du Crédoz
CORNIER
Haute-Savoie - Arr. : Saint-Julien-en-Genevois
Canton : La Roche
Les ruines du château occupent un des rochers situés dans la
plaine aux Rocailles, qui s'étend entre Reignier et La Roche, à 509 m
d'altitude.
Histoire
Le site du Châtelet entre dans l'histoire en 1255, date à
laquelle il est mentionné dans une sentence arbitrale entre le comte de Genève
et Aimon de Faucigny. En 1263, Agnès de Faucigny précise que celui-ci a été
fortifié à grands frais par son mari, Pierre de Savoie. En 1293, le Châtelet
est cédé par Béatrice, dauphine de Viennois et dame de Faucigny à Amédée, comte
de Savoie. A partir de 1308, les comtes de Savoie acquièrent définitivement la
supériorité féodale sur la châtellenie. Le Châtelet du Crédoz est vendu à Philippe
de Savoie, comte de Genevois, en 1441.
Le château et son bourg fortifié furent abandonnés dès le
XVIe siècle. Au XIXe siècle, la fortification sert de carrière aux habitants de
la région et de nombreuses pierres sont pillées.
Description
Le château et le bourg, dont il commandait l'accès, étaient
cernés par une enceinte polygonale, limitée par un fossé et accessible par deux
portes.
Le ruisseau du Bornis et un étang alimentaient les fossés en
eau. Le donjon circulaire ou " grande tour est édifié sur un rocher isolé
par un fossé creusé dans le roc ; sa situation à l'extrémité de l'enceinte
castrale le rendait particulièrement inaccessible.
Malgré un état de ruine avancé, ce donjon offre encore une allure imposante.
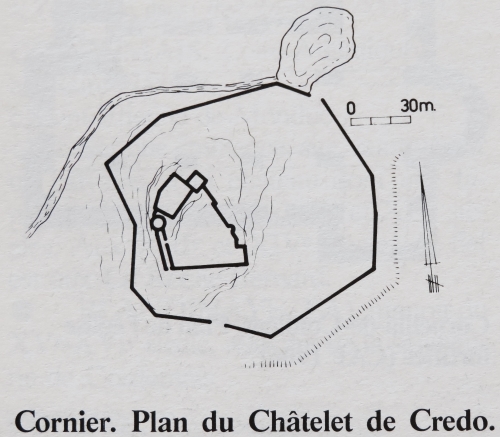
On entrait dans la tour par une porte située à 6 m du sol et
voûtée en plein cintre. L'élévation intérieure, réduite par l'épaisseur des
murs, comprenait plusieurs étages : au rez-de-chaussée une pièce voûtée en
coupole, sans doute une cave et au-dessus, une salle qui peut être assimilée à "l'aula
turris " et qui prend jour par une ouverture en plein cintre. La tour a
été dérasée et son couronnement a disparu. Les comptes de châtellenie font état
cependant de hourds assurant la défense verticale des murs.
Au nord-est, s'étendaient les bâtiments d'habitation
comprenant également une tour carrée située du côté de Reignier et commandant
un des accès du bourg. Cette tour est citée en tant que "turris quadrate
", elle abritait une pièce d'habitation qualifiée de " turris camere
arnesiorum ".
L'ensemble fortifié comprenait également un four, une
étable, une citerne et sans doute d'autres constructions en bois. Les comptes
précisent, en 1308-1309, la fabrication de sept " bocettes ",
projectiles destinés à détruire les murs de Genève.
Les ruines du Châtelet du Crédoz offrent encore des
dispositions très intéressantes pour la connaissance de l'architecture
militaire régionale.
La construction du donjon et d'une grande partie des courtines peut être attribuée au milieu du XIIIe siècle, période durant laquelle le plan est circulaire, est largement adopté dans la région.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:24 par Jimre
Cornillon St Laurent
Château de Cornillon
SAINT-LAURENT
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : La Roche-sur-Foron
Histoire et description
Le château de Cornillon, aujourd'hui à l'état de ruines,
dominait l'ancienne limite entre le Faucigny et le Genevois.
Il est cité dès le milieu du XIIIe siècle, dans un acte où
Alix, comtesse de Genève, cède Cornillon à son fils, Rodolphe.
En 1260, Pierre II, comte de Savoie, le réclame au comte
Rodolphe, comme part assignée en dot à sa mère.
Le plan de la fortification affecte la forme d'un trapèze
flanqué d'une tour circulaire, bien caractéristique des constructions de Pierre
II. Celle-ci ne possède plus que l'étage inférieur, mais la calotte sphérique
qui le couvre subsiste encore en partie. La liaison avec les structures
quadrangulaires pose des problèmes qui ne nous permettent pas de formuler des
hypothèses quant à l'antériorité de ce bâtiment par rapport à la tour
circulaire. Un décapage des murs serait nécessaire pour parvenir â dégager les
points de jonction entre les deux structures.
La tour, constitue un témoignage des premiers donjons circulaires de l'architecture militaire du XIIIe siècle, où les murs étaient très épais, réduisant ainsi beaucoup l'espace intérieur, et où la partie inférieure était voûté d'une calotte. On peut rapprocher cette tour de celle de Langin ou de celle du Châtelet du Crédoz.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos:
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:20 par Jimre
Chatelet St Gervais
Châtelet
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : Saint-Gervais
Aux nobles d'Allinges, qui ne résidèrent pas à Saint-Gervais, succéda dans la charge de châtelain la famille du Fresney, dont trois branches vont s'y fixer. Bien que prétendant descendre de la dynastie princière des Faucigny, elle fait partie de cette «noblesse douteuse qui pullulait per fas et nefas aux mandements de Sallanches et de Montjoie » (A. de Foras). Plusieurs membres sont châtelains à la fin du XVIe siècle. La branche aînée acquiert alors le château de la Comtesse. Au début du XVIIe siècle, Jean-Baptiste est à la fois seigneur de la Comtesse et du Châtelet, de même son fils Claude-Melchior. Par la suite, le titre et la maison forte du Châtelet reviendront à une branche cadette. Louis-Charles, seigneur du Châtelet, va épouser Marguerite de Riddes, d'une famille sans doute originaire du Valais, qui s'est fixée à Flumet d'où elle essaimera dans tout le Faucigny. Leur petit-fils, François-Nicolas, réunira à nouveau les deux titres de la Comtesse et du Châtelet comme héritier universel de Claude-Melchior.
Quelques ruines signalent encore aujourd'hui la maison forte
du Châtelet située sur un mamelon dominant la gorge profondément encaissée du
Bonnant.
Une autre branche des du Fresney est seigneur de Haute-Tour,
maison forte qui domine le chef-lieu. Elle s'illustrera au XVIIe siècle par Ne
Sébastien qui, en 1635, sera premier président de la Chambre des Comptes.
Enfin, une troisième branche conserve les biens situés au hameau du Fresney. Un Nicod du Fresney, notaire, y possède à la fin du XVe siècle, une maison qualifiée de « maison neuve probablement maison forte.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:16 par Jimre
Bonneville
Château de Bonneville
Le Faucigny s'étend sur les bassins de l'Arve et du Giffre. Ce territoire a été dominé par la famille de Faucigny pendant plus de deux siècles. C'est Beatrix de Faucigny qui a baptisé la ville bâtie en contrebas du château « Bona Villa » le 25 novembre 1283 et la ville est devenue capitale du Faucigny en 1310. En 1355, le Faucigny est devenu savoyard et sera à partir du XVIIe siècle l’une des six provinces de la Savoie historique.
Le château est édifié dans la seconde moitié du XIIIe siècle sur une position stratégique, un promontoire rocheux proche de l'un des rares passages possibles de l'Arve, à la frontière avec le Genevois. C’est un château militaire rattaché par certains au type de constructions appelées «carrés savoyards» dont d'autres exemples subsistent encore en Suisse romande : un quadrilatère flanqué de tours rondes.
Une fois intégré aux Etats de Savoie, le château perd peu à peu son rôle stratégique et militaire car il se retrouve au centre du territoire. Il reste un pôle économique actif grâce aux franchises dont est dotée Bonneville. C’est aussi un pôle administratif : c'est le siège de la châtellenie, le châtelain gérant les affaires du comte.
A partir du XVIe siècle et jusqu'en 1933, le château sert principalement de prison. Les prisons sont également utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette dernière fonction qui lui a permis d'être préservé de la ruine, contrairement à bien d'autres châteaux et c'est ce qui en fait aujourd’hui un site unique en Savoie et Haute-Savoie.
Le château appartient successivement à l’État, au Département et enfin à la ville de Bonneville depuis 1953. En 1987, il est inscrit l'inventaire des Monuments Historiques.
En raison des risques d'effondrement, le château et ses abords restent fermés au public pendant une vingtaine d'années. Depuis 2013, des travaux d'envergure sont menés par la ville de Bonneville et la Communauté de Communes Faucigny-Glières avec l'appui de l'association des Amis du Château, de la Fondation du patrimoine, du Département, de la Région, de l'État et de l'Europe afin de rendre accessible la cour seigneuriale, dans un premier temps et la partie « prison » dans un second temps.
Posté le 07-03-2023 11:09 par Jimre
Bonneville
Château de Bonneville
Haute-Savoie — Arr. : Bonneville
Canton : Bonneville
Histoire
L'histoire de ce château est liée à celle de la ville-neuve qui l'entoure. L'ancienne Toisinge ou Tucinge dont l'emplacement n'est pas défini exactement, est à l'origine de Bonneville, ville fortifiée comprenant un bourg et un château édifiés par Pierre de Savoie en 1262.
La grande dauphine Béatrice, fille de ce dernier, fit renforcer les fortifications et contribua beaucoup à l'essor de la ville. Le 25 novembre 1283, jour de la sainte Catherine, la dame de Faucigny fit baptiser la nouvelle ville, citée désormais sous le nom de Bonneville.
En 1293, Béatrice fait don du château à son cousin Amédée de Savoie.
L'importance de la ville fortifiée qui reçoit ses chartes de franchises en 1289, ira en s'accentuant et celle-ci se développera au détriment de Cluses, ancienne capitale du Faucigny. Les habitants de cette dernière ville réagiront d'ailleurs en envahissant Bonneville en 1397, pénétrant dans la cité par la porte du Pertuiset.
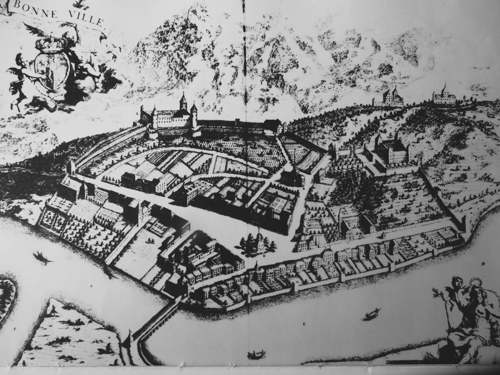
La ville est incendiée et le château subit de graves dommages ; les corps de logis sont détruits.
En 1583, d'importants travaux de réparations sont mentionnés et le « Theatrum Sabaudiae » nous offre encore l'image d'une belle construction régulière, cantonnée de quatre tours.
Description
Installé sur une bande rocheuse, le château constituait la défense du bourg dont il commandait l'accès en direction de Genève. Les murs d'enceinte de la ville longeaient l'Arve, passaient par la porte de Genève percée dans une tour et se rattachaient aux murs du château. La première porte du château mentionnée dans les comptes devait s'ouvrir près de celle du bourg. La forteresse proprement dite forme un quadrilatère de 85 mètres de longueur sur 18 mètres de largeur.
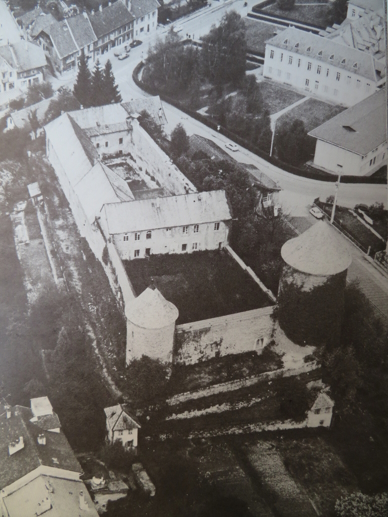
De cette imposante construction il ne subsiste que deux tours circulaires coiffées d'un toit conique et deux courtines fermant la cour intérieure.
L'espace intérieur est divisé en trois étages par des planchers reposant sur des retraits intérieurs.
Au rez-de-chaussée, on repère le départ d’une voûte destinée à couvrir la salle inférieure.
L'entrée se faisait au premier étage par une porte en plein cintre suivie d'un petit couloir ménagé dans l'épaisseur du mur.
On peut reconnaître deux archères voûtées munies d'un seul banc d'embrasure.
Les étages ont été remaniés, cependant Blondel mentionne dans sa description la présence d'un couloir menant à des latrines posées sur des madriers en encorbellement et d'une cheminée.
L'appareil extérieur est composé de cailloux roulés de l'Arve, et de blocs de molasse.
L'intérieur offre un parement de petits blocs de schiste allongés, bien assisés avec très peu de mortier. Les deux murs de courtines, bien que percés d'ouvertures modernes sont encore en bon état.
L'analyse de la fortification confirme les données historiques et permet d'affirmer que la construction remonte à la deuxième moitié du XIIIe siècle.
Il s'agit d'un type de château au plan régulier, cantonné de tours circulaires, à l'imitation des constructions royales de Philippe-Auguste.
Une restauration heureuse est en cours actuellement grâce aux efforts de la municipalité et d'une association qui s'acharne à la sauvegarde du château.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 07-03-2023 11:07 par Jimre
Bellegarde
Château de Bellegarde
Haute-Savoie - Arr. : Bonneville
Canton : Cluses
La tour s'élève après la sortie du village de Magland, en direction de Sallanches, côté gauche de la route.
Histoire et description
Cette fortification semble être le berceau d'une des plus importantes familles nobles du Faucigny, celle des Bellegarde. Ceux-ci qui portant « p. d'argent à 3 pals de sable à la fasce de gueules, brochant sur le tout, chargé de 3 heaumes d'argent » sont divisés en plusieurs branches réparties à la fois en Chablais et en Genevois.
Les Seigneurs de Bellegarde sont aussi seigneurs du Praz, de Bougé, de Pontior, de Brens, de Buffavent, de Saint-Cergues, de Vongy, de Saint-Disdille, de Thorens, de Veigy-Foncenex, de Vigny, etc.
En 1367, Jacquemet de Bellegarde, fait don d'une dîme à l'église de Magland. Le XVIIIe siècle voit l'extinction de cette famille déchue de sa noblesse.
Aujourd'hui, seule une grosse tour carrée coiffée d'un toit à quatre pans conserve le souvenir de la fortification ancienne ; elle abrite des logements.
Posté le 07-03-2023 11:02 par Jimre
Tour de Draillant
La tour se situe en Haute-Savoie, sur la commune de Draillant, non loin de Perrignier et de Cursinges, de la Rochette, Avully et des Allinges .
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 20-10-2022 08:28 par Jimre
Disonche
Tour de Disonche
Une nouvelle vie pour la tour de Disonche
La construction de la tour date du XIIIe siècle mais le
bâtiment actuel a probablement été refait au XVIe. Il conservera cet aspect.
Aux dernières nouvelles, la tour de Disonche, située
derrière l'église, était en vente sur le site intemet Le Bon Coin.
Le bâtiment et son terrain ont en fait été rachetés l'été
dernier par un Saint-gervolain ; après un Contaminard, l'ensemble reste donc entre
les mains de " gars du pays". D'ailleurs, le nouveau propriétaire
tient fréquemment l'ancien au courant de l'avancement de son projet ; on se
souvient combien ce dernier tenait à la tour (après avoir "flashé"
dessus et entrepris d'énormes travaux, il n'avait pu la garder faute de moyens.
La tour sera habitable
Olivier Hottegindre voit grand pour le site. Après une période
sans activité, il avait un projet immobilier en tête, mais pas dans la région.
C'est au cours d'une balade qu'il a été séduit par la tour et son environnement,
sa vue, le calme qui règne alentour malgré la proximité avec le centre-ville.
Et de fil en aiguille, il a décidé de la racheter.
Le bas du terrain
restera à l'état naturel. Le haut accueillera trois villas de haut standing. «
Le challenge, c'est de marier le médiéval authentique et l'ultramoderne, ce qui
respecte à la fois mon envie et la volonté de l'architecte des Bâtiments de
France explique le nouveau propriétaire, Eh oui, la tour étant située dans le
périmètre immédiat de l'église Saint-Jacques, elle-même classée, interdiction de
toucher ne serait-ce qu'une fenêtre sans l'accord de l'architecte !
La tour de 600 m2 accueillera trois appartements de 150 m2 chacun, soit un par niveau, desservis par un ascenseur privé. Le rez-de-chaussée comprendra les parties communes (cave, accès garage et spa). L'appartement du haut, sous la superbe charpente qui sera visible à travers une verrière, sera habité par le propriétaire des lieux. Les deux autres seront mis en vente.
« Je veux absolument respecter l'existant, l'intérieur sera aménagé
de façon moderne mais sans bling bling. Le maître mot sera la sobriété, et la noblesse
des matériaux. Je tiens aussi absolument à ce que tous les appartements soient
accessibles pour les personnes en fauteuil ». Les travaux d'aménagement
intérieur débuteront cet hiver.
Trois villas sur le haut du terrain
Après la tour, le propriétaire s'attaquera à son projet de
villas. Au nombre de trois, sur des surfaces de 120 à 240 m2 elles disposeront
de deux niveaux avec une toiture végétalisée. Depuis le ciel, avec le chemin
d'accès, on verra une branche de rameau.
« Ces maisons seront totalement intégrées dans le paysage.
En été, une partie de la surface sera ouverte sur l'extérieur, de sorte qu'on
ne saura plus si on est dedans ou dehors. Toutes les façades Est seront vitrées
pour profiter du panorama» explique Olivier Hottegindre, Elles devraient être
terminées d'ici Noël 2016.
Source fournie par Nano.M:
- Un article (de 2016?) de Pauline Moisy vu dans le Dauphiné Libéré.
Posté le 19-10-2022 20:24 par Jimre
Disonche
La Tour de Disonche (route de Doran)
Située à deux minutes à pied de l'église, en position dominante, la Tour de Disonche, grosse bâtisse carrée possédant des vestiges de mâchicoulis au-dessus de la porte, fut érigée au Moyen Âge.
A l'origine possession des Seigneurs de Menthon, elle revint en 1521 à Antoine de Bellegarde de Montagny (d'une très ancienne famille de la région) qui la restaura et en modifia l'aspect primitif. C'était la résidence du juge-mage* du Faucigny. Passa ensuite aux Miribel, puis à François de Regard (en 1732). Possédait un souterrain (taillé dans le tuf) qui débouchait juste derrière l'église, se raccordant au passage à un second boyau venant du château des Rubins. Il fut obstrué en 1940 à cause du danger d'écroulement.
La tour, qui n'a pas été touchée par l'incendie de 1840, s'est policée avec le temps, s'est coiffée d'une toiture au XVIIIe siècle à pans cassés, et s'est habillée d'un enduit clair. Elle a plus l'allure d'une grosse demeure que d'une tour.
Un souterrain l'aurait reliée à l'église et au château des Rubins.
Sources fournies par Nano.M:
- Patrimoine des vallées du Mont Blanc, Carnets d'un voyageur attentif, de Patrick Olivier Eliott, Edisud
- panneau présent sur le site
Photos :
- Nano.M (2012)
Posté le 19-10-2022 20:20 par Jimre
Dingy
La Maison-Forte de Dingy ou Tour de Dingy
La plus spectaculaire. Elle se discerne bien depuis la vallée, et conserve sa forme de solide bâtisse défensive, à trois niveaux desservis par un escalier à vis.
Elle était citée dès 1542, mais ses baies géminées montrent qu'elle fut de construction médiévale ; ses baies à meneaux indiquent qu'elle fut ensuite adoucie, dans l'esprit Renaissance. Sa porte affiche les armoiries des Bottelier. Comme Lucinges, Dingy conserverait des fresques en décor intérieur.
- Les châteaux de Savoie, Michèle Brocard, Cabédita, Collection sites et Villages.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 19-10-2022 14:33 par Jimre
Charousse
Ruines de Charousse
Les vestiges dominent le cours de l’Arve, à 1000m d'altitude, au-dessus de Passy. Ils sont la propriété de la commune.
La position dominante de la fortification lui conférait une importance stratégique certaine, permettant de contrôler la vallée de Sallanches et la vallée de Montjoie.
Ce territoire montagneux est occupé dès l’époque gallo-romaine et durant le haut Moyen Age, comme le prouve la découverte de sépultures à dalles attestant la continuité de l'occupation humaine.
Au Moyen Age, la situation géographique de cette châtellenie est à l'origine de nombreux conflits puisque celle-ci constituait une possession des comtes de Genève dans les terres des sires de Faucigny. Des rivalités constantes s'exercent entre les comtes de Genève et les seigneurs de Faucigny, ajoutées aux revendications des comtes de Savoie qui possédaient des droits sur ce fief.
En 1225, un certain Guillaume de Charousse est présent à une sentence arbitrale. En 1250, un compromis entre Pierre de Savoie et Guillaume de Genève, a lieu. Le 19 juin 1250, Guillaume et son fils Rodolphe ordonnent à tous leurs vassaux de rendre leurs hommages, excepté celui de Charousse. Le 19 mai 1260, Pierre de Savoie réclame à Rodolphe, comte de Genève, les dépenses qu'il a faites en recouvrant le " Chastel de Charosse ". Le comte de Savoie avait, en effet, obtenu une part de la propriété du château.
En 1268, dans son testament, Pierre de Savoie lègue à son épouse le château de Charousse toute sa vie durant. A la fin du XIIIe siècle, la châtellenie est le siège des querelles entre les seigneurs de Faucigny et les comtes de Genève au sujet de la vallée de Chamonix. En 1291, des hommes de Chamonix se réfugient au château de Charousse.
Au traité de Saint-Georges-d'Espéranches, en 1308, le comte de Genève se reconnaît vassal du comte de Savoie. Au XVII e siècle, le château perd de son importance ; au XVIIIe siècle, il tombe en ruine. Au XIXe, on élève à son emplacement une sorte de petit belvédère.
Description
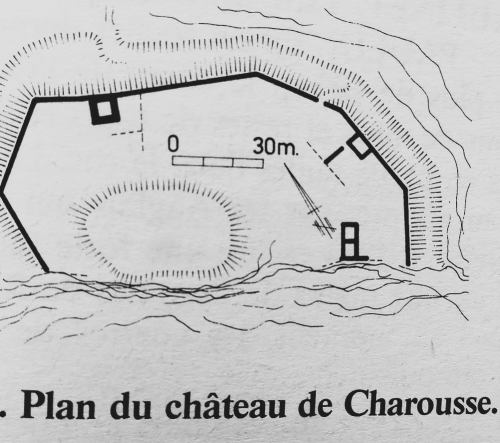
Le château présente un plan polygonal à huit pans irréguliers, défendu par une pente naturelle très vive. Cet enclos, fermé par des murs de 2,50 m d'épaisseur, n'était accessible que par une porte munie d'échauguette et aboutissant au donjon quadrangulaire d'environ 10 m x 10 m.
Dans la cour intérieure, adossés au mur d'enceinte, se situaient les logements du châtelain, abritant deux chambres dont une chauffée.
Cet ensemble fortifié est très isolé et peu accessible, il a dû constituer au Moyen Age une véritable forteresse inexpugnable.
Sources fournies par Nano.M:
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard - Elisabeth Sirot, Editions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 18-10-2022 13:33 par Jimre
Saint Michel du Lac
Entre Servoz et Les Houches on trouve la tour Saint Michel du Lac.
Béatrice , dame de Faucigny, fit ériger ce fort sur ce promontoire ou « mollard » à la fin du XIIIe siècle. Il défendait l’entrée de la vallée de Chamonix. Il comprenait un corps de logis quadrangulaire de 30m sur 13m, terminé au sud par une tour circulaire qui avait 9m de diamètre et dit-on une hauteur de 17,50m. Il servait d'habitation au châtelain, administrateur représentant le pouvoir seigneurial sur place.
Plus tard, au XVe siècle, il eut la réputation d’abriter des démons ou des trésors, d’être un repère pour des adeptes des "sabbats" soupçonnés de pactiser avec Satan...
Il a été célébré par tous tes illustres visiteurs de la vallée au XVIIIème et XIXe siècle : de Saussure, Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo...
"Le redoutable palais, l’ancienne citadelle...est là, solitaire et lugubre comme le corbeau qui croasse joyeusement sur sa ruine."(Victor Hugo)
Sources fournies par Nano.M:
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard - Elisabeth Sirot, Editions Horvath.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 17-10-2022 20:35 par Jimre
Cursinges
Le Château de Cursinges ou Cursinge
Situation
DRAILLANT
Haute-Savoie - Arr. : Thonon-les-Bains
Canton : Thonon-les-Bains
Les ruines se situent au hameau de Cursinges. Prendre la D
903 se dirigeant vers Thonon, tourner à droite à Perrignier et continuer un
kilomètre.
Histoire et description
Dès l'origine semble-t-il, la seigneurie relève des
seigneurs de Rovorée qui sont membres d'une des familles les plus puissantes et
les plus illustres du Chablais.
Au XVIe siècle, la propriété revient aux Genève-Lullin, par
le mariage de Marguerite de Rovorée, puis à Marie de Genève qui la lèguera au duc
Victor-Amédée II.
La Seigneurie est rachetée en 1694 par Jean Noyel de Bellegarde qui la possédait encore au XVIlle siècle. A cette époque, le château était déjà en ruine car il avait beaucoup souffert des guerres du XVI e siècle. Une description de 1625, rapportée par A. de Foras exprime déjà l'état d'abandon du château :
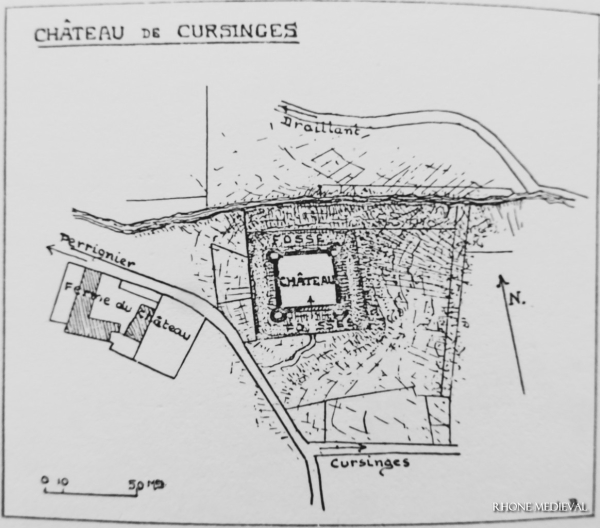
Le château de Cursinges consistait en deux corps de logis réunis par des courtines à créneaux aux quatre tours rondes aux extrémités, une grande et une petite tour carrées avec deux cours, tout entouré de fossés, était en piteux état et en partie ruiné, le Redon ayant abattu une tour et comblé lesfossés. Il y avait deux ponts levis alors ruinés, les frontispices des portes en pierre de roche travaillée, etc.
Actuellement, on peut reconnaître l'emplacement du château
qui mesure environ 35 mètres de côté. La mappe sarde permet de bien retracer le
plan de la fortification et des fossés alimentés par le Redon. Elle y est
mentionnée de la façon suivante :
Château ruiné, fossés, terre et mas au noble marquis de Bellegarde.
La disposition précise des logis, les accès et les ouvertures du château ne
sont pas identifiables aujourd'hui.
Une ferme voisine conserve des pierres provenant de la démolition du château. Ces éléments architecturaux qui sont des linteaux à accolades et des jambages de fenêtres sont plutôt attribuables au XVe ou XVI siècle.
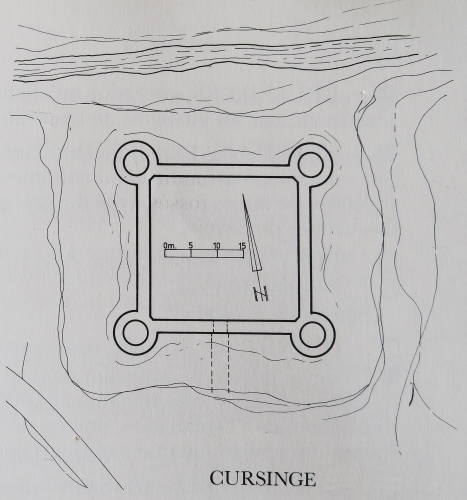
Le château de Cursinges offre le type même du plan régulier, flanqué de quatre tours d'angle et cerné par un fossé alimenté en eau par une petite rivière, le Redon, qui se jette dans le golfe de Coudrée.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard - Elisabeth Sirot, Editions Horvath.
- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.
Photos :
- Nano.M (2022)
Posté le 14-10-2022 10:44 par Jimre
Sallenoves
Château de Sallenôve ou Sallenôves

Situation :
Situé à la limite des deux communes de Sallenôves et de Marlioz, mais sur le territoire de cette dernière, sur un éperon rocheux qui domine le confluent des Grandes et des Petites-Usses, le château de Sallenôve occupe une position stratégique remarquable. Il contrôlait un gué où convergeaient deux axes de circulation importants : la route venant d'Annecy y rejoignait la route venant de Genève par le Mont-Sion pour continuer vers le port de Seyssel sur le Rhône.
Histoire :
Les seigneurs de Sallenôve, apparentés aux Cossonay et aux Grandson du pays de Vaud, sont l'une des plus anciennes et des plus importantes familles vassales des comtes de Genève. C’est une branche cadette de la famille de Chaumont. On les connait dès le milieu du XIIe siècle, époque où ils sont les fondateurs de l'abbaye cistercienne de Bonlieu, non loin de leur château, dans laquelle ils établiront leur nécropole. Au XIIIe siècle, la Maison de Sallenôve donne naissance à la Maison de Viry, qui en est une branche cadette et qui s'implante au château de Marlioz.
En juin 1365, le château de Sallenôve accueille l'empereur Charles IV de Luxembourg qui rentre à Prague après son couronnement comme roi de Pologne en Arles.
Guigues de Sallenove, mort vers 1447, fut compagnon d'armes de Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
En 1534, les Sallenôve entreprennent de moderniser leur château pour lui donner l'aspect qu'il a encore au-jourd'hui.
En 1536, lors de l'invasion du duché de Savoie par la France et par Berne, Alexandre de Sallenôve arrête les Français juste au pied de son château, au passage des Usses.
Le dernier de la lignée, Charles de Sallenôve, est gentilhomme ordinaire de Charles-Quint. Il s'établit aux Pays-Bas, où il meurt après avoir légué le château de ses ancêtres, ainsi que le château de Marlioz, à Pierre de Montluel, en 1563.
En 1579, la veuve de celui-ci cède Sallenôve et Marlioz au duc Emmanuel-Philibert qui les inféode, en 1584, à un seigneur bourguignon, Simon Marmier, sire de Moissy qui sera tué par les Genevois à la bataille de Plan-les-Ouates, le 3 Juin 1589. Le 19 Juin suivant, une conférence se tient au château de Sallenôve pour tenter d'éta-blir la paix entre la Savoie et les Suisses. Les députés de la République de Berne y rencontrent le comte de Challant, représentant le duc de Savoie.
En 1602, Charles de Gontaut, duc de Biron, gouverneur de Bourgogne et maréchal de France, est au château de Sallenôve. Il y rencontre, dans le plus grand secret, des agents du duc de Savoie et du roi d’Espagne par lesquels il se laisse convaincre de trahir Henri IV. C’est encore au château de Sallenôve que les Espagnols lui apportent les 500 000 écus convenus comme prix de sa trahison. Le complot sera découvert et Biron sera exécuté à Paris.
La nièce de Simon Marmier ayant épousé Gaspard de Livron, les châteaux de Sallenôve et de Marlioz finissent par échoir à la Maison de Livron en 1651. Leur sort ne cessera d'être commun jusqu'au début du XXe siècle, mais leurs propriétaires successifs résideront de préférence à Marlioz, entièrement rénové par les Livron en 1673.
En 1753, Jeanne-Reine de Livron épouse François Malivers à qui elle apporte Sallenôve et Marlioz. Louise-Catherine Malivers ayant épousé un Pingon, son fils, Amédée-Gaspard de Pingon hérite des deux châteaux en 1773. Officier dans l'armée sarde, chevalier de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, il sera incarcéré à Cham-béry, puis à Paris, durant la Révolution française. A sa mort, en 1823, il lègue Sallenôve et Marlioz au comte Eugène de La Prunarède, son beau-frère.
Celui-ci se sert du vieux donjon de Sallenôve comme d'une carrière de pierres pour construire l'église paroissiale de Marlioz. Son épouse, Adèle Quarré de Chellers, duchesse de Fleury, donne au château de Sallenôve la gloire d'accueillir Franz Liszt. Ruiné par la construction de l'église de Marlioz le comte de La Prunarède est exproprié en 1850. Sallenôve et Marlioz reviennent à un prêtre du Pas-de-Calais, l'abbé Edouard Scott.
En 1873, les deux châteaux sont mis en vente aux enchères et sont achetés par Jean Daudens de Frangy. Le château de Sallenôve sera revendu à Monsieur Emile Schurch qui entreprend de le restaurer soigneusement à partir de 1930. Sa fille, Madame Eardley-Schurch, propriétaire actuelle, a poursuivi ces travaux en consolidant le mur d'enceinte et en refaisant les toitures.
Description
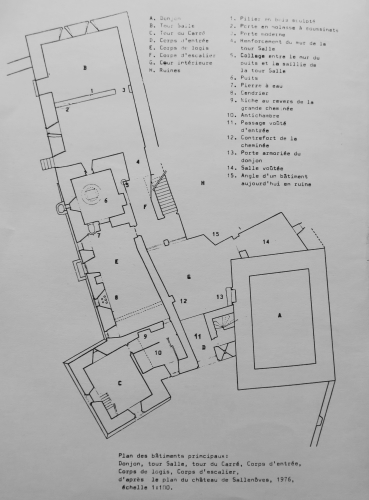
Le gros donjon carré, remontant au XIIe siècle, porte le nom de Tour de César.
Il est en ruine depuis la Révolution. Au XIXe siècle, le comte de la Prunarède s'en est servi de carrière pour construire l'église de Marlioz.
La façade d'entrée, où l'on voit une belle fenêtre Renaissance, était surmontée d'une bretêche dont subsistent les mâchicoulis. Elle est encadrée par la Tour de César et une grosse tour carrée comportant une curieuse fenêtre à meneaux, disposée en angle.
Sur la petite cour intérieure donne la cuisine dont le puits est situé dans une cave attenante. L'escalier et la chapelle en étage sont voûtés d'ogives. On accède à la chapelle par une galerie à loggias du XVIe siècle.
Le gros corps de logis situé à l'extrémité nord du château est également du XVIe siècle et possède de belles salles. Le château de Sallenôve est précédé par une vaste basse-cour fermée par un mur d'enceinte contre lequel prenaient appui le four et des communs, aujourd'hui démolis. L'angle occidental de ce mur d’enceinte était occupé jadis par une tour à deux étages sur rez-de-chaussée, dont les ogives rayonnaient d'un pilier central.

Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
- Panneau trouvé sur le site
Photos:
- Jimre (2010)
- Nano.M (2023)
Posté le 15-12-2021 11:02 par Jimre
Mons
La tour de Mons
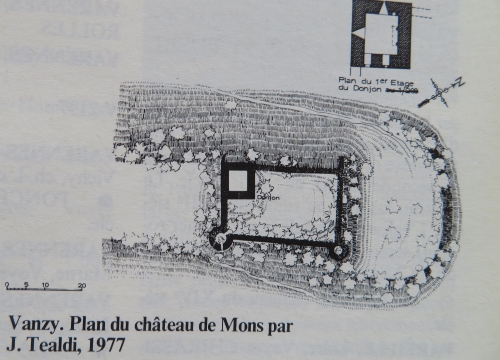
Mons se trouve à 1.5 km au sud de Vanzy, par la D 1508, on aperçoit une enceinte rectangulaire ; Au centre de Mons, la tour s'élève sur un tertre dominant le village au milieu des ronces et de la végétation.
Ces vestiges médiévaux sont les plus anciens et les mieux conservés de la Semine.
Construite en 1290, la tour de Mons appartenait à l'origine aux seigneurs de Mons.
Par la suite, cette place forte se trouvera sous le giron des comtes de Genève jusqu'en 1281.
À cette date, Guillaume d'Arlod prêtera hommage aux puissants Genevois.
Cette famille acquiert en 1395 des terres et des revenus liés à ces lieux.
De forme carrée, elle s'élève à une hauteur d'environ 8 mètres et on peut apercevoir une belle archère. Les angles du grand côté opposé sont flanqués de tours rondes. A l’intérieur de la tour de Mons, on peut apercevoir encore de belles meurtrières.
Sur une photo de Nano.M, on peut apercevoir une cale en chêne âgée de 900 ans, placée par les maçons lors de la construction du donjon roman!
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
- Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal.
- Photos anciennes N&B de Jacques Tealdi, 1977.
Photos:
- Jimre (2009)
- Nano.M (2023)
Posté le 15-12-2021 11:00 par Jimre
Mionnaz

On trouve facilement le château de Mionnaz au bord de la D 19 allant de Rumilly à Clermont.
Si la date précise de la construction de ce bâtiment n'est pas connue, on sait que la famille de Mionnaz y réside jusqu'à la fin du XVIe siècle.
Il était composé de trois corps de bâtis formant une cour intérieure. L'aile bordant la route est constituée de deux tours rondes percées d'archères et reliées entre elles par une courtine.
Une de ces tours a été aménagée en colombier et conserve encore une grille d'envol et des boulins. Le château abrite aujourd'hui une exploitation agricole.
Source fournie par Nano.M:
-Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath
Photos:
- Jimre (2010)
- Nano.M (2022)
Posté le 15-12-2021 10:59 par Jimre
D'Héré
Photos:
- Jimre (2012, 2024)
Posté le 15-12-2021 10:57 par Jimre
Chatillon sur Cluses
Château de Châtillon-sur-Cluses

Dominant la ville de Cluses, le château de Châtillon, en ruine aujourd'hui, appartenait au XIIE siècle à la famille de Châtillon. Cette famille, branche cadette des Faucigny, recevait à cette époque, dans ce château, beaucoup de visites, car c'était la résidence des sires de Faucigny. On y célébra les fiançailles d'Agnès, fille d'Aimon II, avec Pierre de Savoie en 1234 et celles de Béatrice de Faucigny avec le dauphin du Viennois en 1241.
Pierre de Savoie y fit d'énormes dépenses pour le transformer en forteresse.
Mais, peu à peu, la famille de Faucigny cessa de fréquenter le bâtiment. Au XIV siècle, il fut habité par G. de Béarn. En 1406, Amédée de Savoie en devient propriétaire, et le château, comme celui de Bonneville, deviendra une prison.
En 1492, les paysans, menés par Jean Gay de Megève, vêtus de robes rouges, s'empareront du bâtiment et ne seront repoussés que difficilement par le duc de Savoie.
En 1530, le duc Charles Ill de Savoie l'inféode aux de La Palud, puis son successeur, Victor-Amédée Il, l'inféode au marquis Martin du Fresnoy.
En 1589, il aurait brûlé. Au XVIe siècle, n'étant plus entretenue, cette forteresse tombera en ruine.
C'est son neveu Joseph Planchamp, en 1769, qui hérite de la succession et des ruines de Châtillon.
Christian Regat le décrit très bien dans son livre " Châteaux de Haute-Savoie".
Aujourd'hui, les vestiges sont plus dangereux que touristiques.
Source fournie par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva.
Photos:
- Jimre (2015)
- Nano.M (2023)
Posté le 15-12-2021 10:54 par Jimre
Beauvivier
Photos:
- Jimre (2014, 2024)
Posté le 15-12-2021 10:53 par Jimre
Duingt
Le château comtal de Duingt
La famille de Duin possédait deux châteaux à Duingt, l'un au bord du lac : Châteauvieux, l'autre édifié sur le mont de Taillefer appelé château comtal de Duingt.
Situation
La tour domine le village, elle est visible en hiver, en empruntant la nationale 508.
Complétant le dispositif de surveillance de Châteauvieux, ce château est bâti sur un roc à l'extrémité septentrionale du Taillefer. Il domine Châteauvieux et contrôle les deux bassins du lac d'Annecy.
Le site est séparé du Taillefer par une étroite dépression dans laquelle passait la route de l'Italie à Genève et où se blottit le vieux village de Duingt, jadis clos de murailles. C'est une position stratégique de première importance qui ne devait pas échapper longtemps à la convoitise des comtes de Genève.
Histoire
Le château comtal de Duingt date du XIe siècle et appartenait à la famille des Duingt de Conflans. Il ne reste qu'une petite partie des ruines, et celles-ci ont été restaurées sous la forme d'une tour hexagonale. Il a été construit quelques décennies après Châteauvieux. Il domine et surveille le lac.
En 1296, Rodolphe de Duin vendit le château à Amédée II, comte de Genève, soucieux d'affirmer sa présence dans ce lieu qui contrôle le trafic entre l'Italie et Genève. Devenu ainsi château comtal, à son rôle militaire, il ajoute un rôle administratif en accueillant le siège d'une importante châtellenie.
Par un accord conclu avec Pierre de Duin en 1311, le comte Guillaume délimita les propriétés ainsi :
Les Duin conservaient la Provenche : le sud de Saint-Jorioz, Leschaux et Saint-Eustache avec Entrevernes et Duin.
Au comte de Genève, revenaient toutes les possessions de la rive droite du lac, de Duingt à Doussard, Chevaline, Lathuile, la garde du prieuré de Saint-Jorioz et la pêche à Beauvivier.
Lors de l'incorporation du Genevois à l'Etat savoyard en 1401, le château comtal de Duingt passe de la Maison de Genève à la Maison de Savoie qui l'inféode, en 1455, à Perrin d'Antioche. En 1460, le duc Louis de Savoie donne le Genevois en apanage à son fils cadet Janus. Dès 1463, celui-ci récupère l'ancien château comtal et la seigneurie qui en dépend. En 1481 il les offrira à son épouse Hélène de Luxembourg.
Leur fille unique, Louise, ayant épousé son cousin François de Luxembourg-Martigues, le vieux château comtal passe à la Maison de Luxembourg qui le conserve jusqu'en 1606. Elle l'échange alors avec le duc Henri de Genevois-Nemours contre la seigneurie de Seure que celui-ci possédait en Bourgogne. Dès cette époque, le château n'est déjà plus que ruine.
Description
Les murs des terrasses sont des vestiges des murs d'enceinte de l'ancien château comtal dont il ne subsiste plus que le donjon.
Celui-ci, de plan circulaire à l'intérieur, présente extérieurement un plan hexagonal. Les murs ont une épaisseur de 3 mètres environ, le parement extérieur est composé de belles pierres de taille, assemblées avec un soin tout particulier.
Une ouverture en plein cintre est pratiquée au premier étage, correspondant sans doute à l'entrée primitive. L'édifice a été découronné.
Il est difficile d'assigner une date à la construction de cette œuvre originale pour la région, mais la régularité des parements extérieurs et la forme elle-même laissent présager une construction plutôt tardive.
Il n'a pas encore été possible d'évaluer la part respective des Duingt et des comtes de Genève dans cette construction qui doit beaucoup à un « large » XIIIe siècle.
Sources fournies par Nano.M:
- Châteaux, vieilles pierres et blasons de Haute-Savoie, Jacques Grombert, éditions Neva,
- Châteaux de Haute-Savoie, Christian Regat, François Aubert, éditions Cabédita.
- Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, éditions Horvath.
Photos:
-Jimre (2012, 2021, 2024)
- Nano.M (2023)
Posté le 15-12-2021 10:48 par Jimre
Yvoire
Cité médiévale située sur les bords du Lac Léman, Yvoire est déjà une seigneurie lorsqu’Amédée V, comte de Savoie, décide au début du XIVe siècle d’en faire une forteresse imprenable. Il subsiste de cette époque des vestiges essentiels: château, portes, remparts…
Le village va ensuite peu à peu s’endormir et on le retrouve modeste village de pêcheurs au début du XXe siècle. Le bourg est aujourd’hui un site touristique renommé et très fréquenté, lauréat national du fleurissement et membre de l’association des Plus Beaux Villages de France.
Source:
- Livret touristique sur le Chablais
Photos:
- Jimre (2015)
Posté le 13-07-2018 21:00 par Jimre
Faucigny
Histoire

Le site du château de Faucigny est le berceau de la famille du même nom, l’une des plus anciennes familles nobles de Savoie, qui apparait dans les textes à la fin du XIe siècle et qui a essayé de contrebalancer l’influence de la maison de Savoie dans la région en s’alliant aux Dauphinois.
Le château, mentionné en 1119, connait son âge d’or dans les décennies qui suivent. Délaissé au cours du XIIIe siècle, par les Sires de Faucigny au profit des châteaux de Chatillon sur Cluses, Sallanches et plus tard Bonneville, il conserve néanmoins son rôle militaire et administratif.
Les bâtiments qui le composent nous sont connus grâce aux enquêtes de 1339, précédent l’acquisition de Faucigny par le comte de Savoie, longtemps un adversaire, en 1355.
Ces enquêtes ont été menées par Humbert II, Dauphin du Viennois, héritier du Faucigny par son arrière-grand-mère Béatrice de Faucigny. Sans descendance et endetté, il cherche à revendre au Pape Benoit XII plusieurs de ces seigneuries dont le Faucigny.
Ces deux enquêtes, menées conjointement par les représentants du Pape et du Dauphin, visent à dresser un état démographique, économique et militaire du Faucigny en vue de son estimation. Les tractations échouent et le Faucigny passe aux mains du Roi de France Jean II le Bon qui est contraint militairement de le céder, par échanges, au comte de Savoie Amédée VI en 1355.
Le château
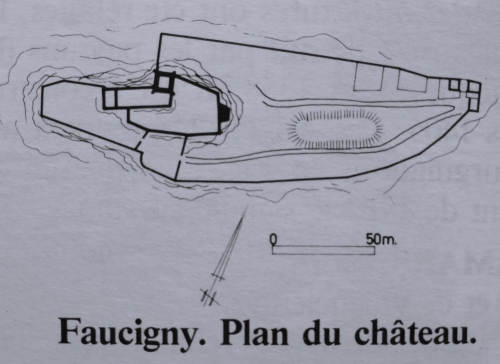
La tour porte
Les vestiges de cette tour sont ceux de l’unique porte permettant de franchir l’enceinte, haute d’environ 6m, qui protégeait le château de Faucigny et son bourg. Cette porte était surmontée en 1339 d’une tour haute de 10 toises soit environ 21 mètres. Construite en moellons de molasse soigneusement équarris, elle était fermée par une herse et par un vantail en bois « muni de ses chaînes et de ses pentures en fer ». La porte et l’enceinte ont pu être précédées d’un fossé franchi par un pont-levis
La tour carrée
Les vestiges, traditionnellement appelés « Tour de la reine » possèdent les caractéristiques de la tour carrée citée en 1339. D’un périmètre de 15 toises soit plus de 32 mètres, soit 9x7 mètres de côté, cette tour s’élevait alors à une hauteur de 11 toises soit 23 mètres et abritait quatre étages d’une surface d’environ 15 m2. Ancrée sur ce promontoire, dominant la vallée de l’Arve et visible de loin, elle incarnait la puissance et l’ambition de la famille de Faucigny.
Le Corps de Logis
Le corps de logis, dont la construction est datée au carbone radioactif entre le milieu du XIIe et la fin du XIIe siècle, abritait en 1339 une grande salle d’apparat ou Aula d’environ 140 m2 et haute de plus de 10 mètres. Elle était chauffée par un fourneau. De cette salle, on accédait aux espaces privés du seigneur, formés de chambres avec leurs fourneaux, garde-robes et latrines mais aussi à la boulangerie ou panateria et à la chapelle seigneuriale dont on ignore l’emplacement.
La Cour
Cette cour, ceinte d’une courtine haute en 1339 de 7 toises soit plus de 14 mètres, était occupé par des bâtiments de service, de stockage ou domestiques. Deux celliers, deux étables, une citerne, un bâtiment regroupant la cuisine, son four et son cellier et un autre abritant deux chambres superposées et le four du château, l’ensemble couvrant en majeure partie la cour sur une surface supérieure à 450 m2. A l’est, elle était dominée par une haute tour circulaire.
La Tour Orientale
Cette tour qui dominait le bourg est idéalement située pour surveiller la rampe d’accès au château. De plan circulaire et haute en 1339 de 11 toises soit 23 m, elle comportait trois niveaux de plancher d’environ 7 m2 chacun. Au niveau inférieur on distingue un espace voûté d’un diamètre de 2.70 mètres, construit en moellons de tuf. Ce cul-de-basse-fosse, accessible par une trémie percée dans la voûte, a pu servir exceptionnellement de dépôt de vivres mais plus vraisemblablement de cachot, comme l’attestent les enquêtes du milieu du XVIe siècle.
La conservation et les travaux de restauration

Les ruines et leurs abords ont été protégés par l’Etat au titre des sites en 1942. Majestueux et visible de loin, le château constitue de nouveau, grâce à des investissements importants, un point fort du patrimoine médiéval du département.
Les travaux d’aménagement et de restauration ont été menés sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de Communes des Quatre rivières et la mairie de Faucigny de 2007 à 2009. Les maçonneries du château ont été consolidées et assainies mais non remontées selon le principe de laisser visible les parties consolidées en ménageant un retrait par rapport aux parements d’origine encore conservés.
Les aires découvertes ont été traitées par la pose d’un granulat extrait du mont Salève alors que les espaces bâtis sont signalés par la mise en place d’un platelage en mélèze.
Sources:
- Panneaux situés sur le site
- Sources fournies par Nano.M d'après:
* Châteaux, blasons et vieilles pierres de Haute-Savoie, Jacques Grombert, Editions Neva,
* Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, editions Horwath.
Photos:
-Jimre(2015)
Posté le 29-11-2015 19:44 par Jimre
Bellecombe
Située sur la Commune de Reignier, la tour de Bellecombe est fondée sur un promontoire rocheux, dominant la route départementale et l’actuel pont de l’Arve. Elle représente le reste le plus visible de l'ancien château édifié le long de l'Arve, comme de nombreux autres châteaux.
Le château a été la propriété des Sires de Faucigny puis de Thoire jusqu’à la Révolution. Durant la période féodale, Bellecombe était une place forte majeure et un lieu de péage.
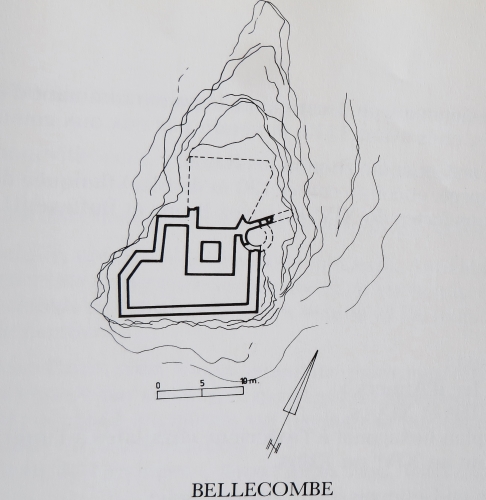
Du troisième étage de la tour, l’on pouvait voir Genève permettant ainsi de prévoir les dangers d’une attaque. La tour ne comportait pas de porte, seule une échelle de corde à l’extérieur permettait d’accéder à l’intérieur. Il fallait auparavant escalader le rocher à découvert. La configuration des lieux rendait la petite forteresse imprenable. Les murs d’enceinte n’offrant aucun angle mort en font une remarquable construction tirée de l’expérience des guerres de croisade.
De construction romane à la base, datant du XIIe ou début du XIIIe, elle a sans doute été remaniée au cours de siècles, comme en témoignent les maçonneries.
En 1591, lors des guerres qui précédèrent l’Escalade de Genève, les genevois, aidés des troupes françaises d’Henri IV, assiégèrent et brûlèrent plusieurs châteaux dont celui de Bellecombe, annonçant la défaite des Sires de Faucigny et de la maison de Savoie.
La Révolution acheva la dégradation de cet édifice qui ne fut ensuite jamais restauré.
La Communauté des Communes « Arve et Salève », devenue propriétaire, a fait entreprendre dès 1997 des travaux de confortement, afin de préserver ce patrimoine et d’assurer la sécurité publique des lieux.
Posté le 29-11-2015 16:20 par Jimre
Chaumont
Histoire
Déjà du temps des Celtes et des Romains, la valeur du site est attestée par les deux grands axes de communication, d’est en ouest reliant Genève à Lyon et du nord au sud allant de Bourgogne au Piémont. De l’an mil à la fin du XVIIIe siècle, Chaumont essayera de tirer parti de sa position stratégique.
C’est en 1124 que les comtes de Genève édifient le château fort de Chaumont. Cette protection attire une population importante. Rapidement, foires et marchés se développent sous la protection des nouveaux seigneurs, avec notamment un important commerce de grain.
Après le rachat du comté de Genève en 1401, le château passe dans la famille de Savoie qui continue de l’entretenir, bien qu’il ne soit plus sur les frontières du comté.
Sous le règne de François Ier (1515-1547), la Savoie est rattachée à la France et Chaumont prospère. Mais en 1601, la construction sur la rive droite du Rhône d’une nouvelle route commerçante, reliant Genève à Bellegarde, marque le début du déclin de Chaumont.
C’est à cette époque que le Duc Henri Ier de Genevois-Nemours, neveu du Duc de Savoie, tente de s’emparer du duché de Savoie en rassemblant ses troupes à Chaumont. Le complot échoue et le Duc de Savoie donne l’ordre le 25 Septembre 1616 au commissaire Député Dioniso Berti, de démanteler le château.
Enfin, en 1760, lorsque la France s’approprie la vallée de la Valserine(Ain), les foires à grain cessent définitivement à Chaumont, anéantissant ainsi toute son économie et son importance.
Le château
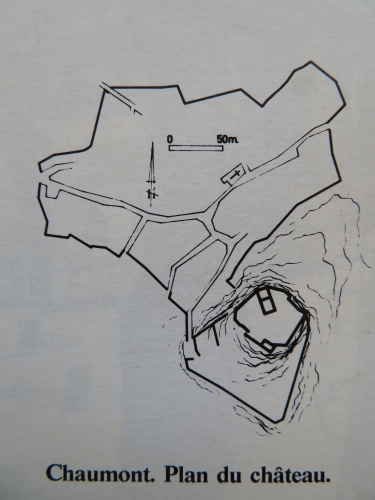
Ce château féodal bâti en petit appareil est caractéristique des XIIe et XIIIe siècles. Cet édifice a du être remanié au gré des besoins défensifs jusqu’au XVIIe siècle.
L’enceinte du plain château est encore repérable sur le site et quelques pans de tour maîtresse (donjon) subsistent dans la partie nord.
Les particularités du site, escarpement et orientation, sont parfaitement exploitées par le dispositif défensif.
Les ruines dominent en effet le bourg de Chaumont et couronnent le promontoire rocheux de la partie méridionanle de la Vuache. Dans le prolongement se trouve le rocher Bataillard, surplombant l’ancienne voie romaine, avec en contrebas le défilé de Malpas séparant le Vuache du mont de Musièges.
Le bourg, blotti au pied du château était entouré d’une muraille et de palissades de bois avec deux ou trois portes gardées qui garantissaient une bonne sécurité aux villageois.
Sources:
- Panneaux situés dans le village
Plan fourni par Nano.M d'après le livre Dictionnaire des châteaux et fortifications du moyen âge en France, Charles-Laurent Salch, éditions Publitotal,
Photos:
- Jimre (2015)
-Nano.M (2022)
Posté le 29-11-2015 09:25 par Jimre
Faverges
Mentionné en 1112 comme étant le fief de la famille de Faverges, le château, dominant un carrefour routier important, est acquis en 1317 par le comte Amédée V de Savoie. Vendu en 1506 par le duc de Savoie, le château est reconstruit en 1644, à l’exception du donjon circulaire, par le marquis de Faverges. Usine de soierie de 1810 à 1914, puis tour à tour hôpital militaire, « château-ouvrier » et colonie de vacances, le château est aujourd’hui un centre touristique et de vacances suite à son acquisition en 1980 par la commune. Le donjon, protégé au titre des Monuments Historiques en 1991, a été doté en 2008 d’un magnifique hourd en bois, galerie en surplomb permettant la défense au pied de la tour.
Posté le 25-08-2013 09:27 par Jimre
Avully
Article trouvé sur le site du château avec une mine d'informations sur la région et, fait remarquable, des livrets édités pour différents publics, dont le livret de visite pour les particuliers, sont à la disposition des internautes. Dans ce livret, il y a une superbe description du château que je joins ici. Un grand Bravo à ce site car on aimerait voir ça plus souvent!!!
Ne manquez pas d'aller y surfer...8;-))
"CHÂTEAU D’AVULLY (Brenthonne) Histoire d’un château en
Chablais
Au centre du village de Brenthonne, une route nous conduit
au vieux Château d’Avully, tout enfoui dans les arbres. Situé au bas des pentes
des Monts des Voirons, cet antique manoir est bâti sur les restes d’une villa «
gallo-romaine » du Ier siècle, comme l’attestent de nombreux tessons retrouvés
dans le sol lors de sa restauration.
La famille d’Avully est mentionnée dès 1172. Elle dépendait
alors des Sires de Faucigny et, dans les actes les plus anciens, elle est
désignée sous le nom « Avullier », « De Vullie », « De Wullie » ou encore «
Davyllie » qui signifie « le rucher ».
Au cours des XIIe et XIIIe siècles, le Chablais avait son territoire partagé entre quelques familles féodales. Le Prince évêque de Genève exerçait son épiscopat sur toute la rive gauche du Lac Léman. Son autorité administrative s’étendait de Genève au Bouveret et son diocèse était partagé en 8 décanats, dont celui des Allinges où se trouvait naturellement le château des Allinges, mais aussi ceux d’Avully, de la Rochette, Buffavent et Coudrée. Le Chablais était aussi placé sous l’autorité de nombreux seigneurs : les comtes de Genève, les Sires de Faucigny et les Comtes de Savoie.
En 1257, on cite Namtelme, fils du Chevalier Guichard
d’Avully, famille vassale du Seigneur de Langin dont la maison forte se situe
au pied des Voirons , au sommet de la colline dont il reste une tour restaurée
et quelques remparts. C’est en 1335 que le Comte de Savoie ordonne au Seigneur
d’Avully de fortifier sa maison, qui, construite en plaine, est mal défendable.
En 1362-63, le Seigneur d’Avully participe à la croisade savoyarde. Ne lit-on
pas que Jean d’Avully prendra part à l’expédition du Comte Vert de Savoie, en
direction de Gallipoli, verrou des Dardanelles, pour défendre son cousin
l’Empereur de Byzance.
Au début du XVe siècle, Jeanne d’Avully est citée avec son
frère Humbert, comme faisant partie des personnages reçus à la Maison de Savoie
à Ripaille. Humbert d’Avully était en 1391, homme lige du Comte Rouge, Amédée
VII. La vie alors menée par la noblesse de cour, ainsi que ses visées
ambitieuses, n’allait pas sans luxe, ni sans nécessiter de grands besoins
d’argent.
Avec Humbert d’Avully, la famille de Boëge entre dans
l’histoire d’Avully ; il épouse en effet Françoise, fille de Pierre de Boëge
et, en 1412, il nomme sa fille héritière universelle. Dans les exécuteurs testamentaires,
figurent Pierre de Balleyson, Guigon de Rovorée. La fille de Jean de Rovorée –
Avully, Philiberte, épousa Noble Georges d’Antioche, Seigneur d’Yvoire,
co-Seigneur de Nernier. C’est elle qui, le 11 mars 1499, vendit le château
ainsi que ses terres et dépendances pour 8000 florins à Boniface de St Michel,
originaire de Genève. L’acte fut signé au château d’Yvoire dont les Rovorée
avaient la seigneurie.
Ce sont les de St Michel qui, en faisant de grands travaux,
donneront l’aspect actuel et définitif du château puisque celui-ci ne subit
plus de modifications après leur disparition au début du XVIIIe siècle. C’est
également la famille de St Michel qui marque le plus l’histoire du château, en
raison notamment de la personnalité d’Antoine de St Michel, de ses relations
avec les bernois, Genève, Théodore de Bèze, François de Sales, le pape et
Marguerite d’Autriche.
Selon Galiffe, historien genevois, les de St Michel étaient
une vieille famille genevoise. C’est en 1386 que Michel de St Michel fut reçu
Bourgeois de Genève.
On pense qu’ils étaient banquiers et finançaient des
expéditions maritimes allant chercher des épices au Moyen-Orient, le sucre à
Chypre. Les gains étaient proportionnels aux risques, c’est-à-dire énormes.
De Foras, dans son armorial, écrit que les de St Michel devinrent protestants au début de la réforme, probablement par mariage avec une riche héritière bernoise, de la famille de Watteville. François de St Michel, dit l’Espagnol, fut conseiller de Genève en 1519. Sa femme, Marguerite, était selon une chronique de Bonivard, espagnole ou portuguaise. Elle fut « capitaine » des amazones, toutes filles de nobles familles qui reçurent à Genève, le 4 août 1523, la Princesse Béatrice du Portugal, épouse de Charles III, Duc de Savoie.
Ces amazones se rendirent, selon la chronique de l’époque,
au nombre de 300, armées de dards et de boucliers d’argent, au château d’Avully
où eurent lieu de grandes fêtes. Le personnage le plus intéressant et marquant
fut Antoine de St Michel. Protestant et Président du Consistoire de Thonon, il
se convertit au catholicisme après quatre années de discussion avec François de
Sales ; il tenta l’impossible pour que cessent les luttes fratricides et que
revienne la paix religieuse.
Ce haut personnage original, intelligent, ambitieux et
turbulent s’attira les colères des Genevois et sa tête fut mise à prix dès sa
conversion connue.
Pour se faire une idée de l’activité d’Antoine de St Michel,
devenu «Baron d’Hermance et d’Avully », il convient de relire quelques lignes
de l’historien Alain Duffour (Guerres de Genève 1589-1593 – Edition Julien
1958) :
« Genevois et Bernois avaient entrepris ces guerres pour
arracher au Duc de Savoie quelques territoires, gage d’une « bonne paix »
(...).Antoine de St Michel entre en scène. Il se montre digne de capter la
confiance des Bernois et des Genevois. Il était protestant (provisoirement !!)
et apparenté par sa mère aux De Watteville, grande famille bernoise. Déjà en
1580, il avait servi d’intermédiaire entre le Duc de Savoie, son maître, et
Genève. Le Baron d’Avully propose au Duc de Savoie l’arbitrage des Suisses ; il
intrigue à Fribourg, Berne, en mai 1589. A Zurich et à Lucerne, on refuse de le
recevoir. Il propose donc au Duc de Savoie de s’entendre avec les Bernois et les
Français qui soutiennent Genève contre la Savoie.
On constate que le personnage est bivalent et qu’il ne se
gêne pas beaucoup pour placer ses pions dans un camp comme dans l’autre,
l’essentiel étant pour lui de vendre sa récolte, son vin et son blé, car il
était grand propriétaire terrien. « Quel comédien ! » s’écrie Duffour et « il
savait bluffer ». Français, Bernois et Genevois, qui depuis 25 ans pillaient et
brûlaient tous les châteaux savoyards, avaient toujours épargné Avully. Dès
qu’il fût devenu catholique, leur attitude changea et le château fut attaqué
pendant trois jours en mai 1603. Résistant victorieusement aux assauts répétés,
les assaillants durent se retirer avec leurs morts et leurs blessés, et d’après
le registre genevois, 14 vaches et 40 moutons.
Revenons à la conversion au catholicisme du Baron d’Avully.
Cette conversion qui entraînera celle des nobles du Chablais, fut l’œuvre de
François de Sales, autre personnalité qui s’employait dès 1594 à ramener le
Chablais au catholicisme. Influencé par ses paroles, mais aussi en raison de
ses intérêts, Antoine de St Michel adjura le protestantisme à Turin, le 26 août
1596, devant le nonce apostolique.
Théodore de Bèze, calviniste et ami jusque là du Baron
d’Avully, devint furieux à l’annonce de sa conversion et lui adressa les plus
vifs reproches.
En réponse, le seigneur publia à Lyon en 1602, une lettre
intitulée : « Armes offensives et défensives contre les calvinistes ». Antoine
de St Michel s’éteignit en 1610. L’échec de l’"Escalade de Genève" repoussa
au-delà des Alpes les ambitions et les intérêts de la Maison de Savoie.
Les seigneurs d’Avully n’occupèrent leur demeure que pendant
la belle saison, le reste du temps étant passé à la cour de Turin où richesses,
honneurs et postes importants leur furent octroyés. Antoine de St Michel saura
garder à sa maison son rang de somptueuse résidence, servie et entretenue par
de nombreux serviteurs.
Après la famille de St Michel, le château passa en d’autres
mains, celles des Scaglia par héritage et des Ferrod de Sarres par rachat. En
mars 1756, il fut acheté par François de Sales, seigneur de Brens, dont une des
maisons fortes se situe au pied de la colline de Langin.
Il resta dans cette famille jusqu’en 1896, date à laquelle
il fut vendu aux Mouchet, de Saxel, gros marchands de bois. Pendant la
révolution, le château doit à la municipalité de Brenthonne d’avoir échappé à
une destruction totale.
En effet, grâce au peu d’empressement à exécuter les ordres
des révolutionnaires, il put conserver ses tours mais son donjon fut décapité
et les fossés comblés. Il faut signaler que le Maire Guarin Lacroix, ancêtre du
propriétaire actuel, y habitait avec sa famille en tant que fermier. Le comte
de Foras, auteur de l’Armorial de Savoie, note qu’en 1860 les archives d’Avully
étaient très complètes et magnifiquement tenues.
Malheureusement le fermier de l’époque, sommé de quitter les
lieux, les brûla intégralement. De fermiers en fermiers, sans aucun entretien,
ruiné et solitaire, malmené par les vandales, visité par les amateurs de
vieilles pierres, servant de carrière, il parvint jusqu’à nous à l’état de
ruine.
Après 30 années de travaux, le Château d’Avully retrouvera
l’aspect qu’ont admiré les gens du temps où Louis de Savoie résidait au Château
de Ripaille, où Jean de Vernay, où Guillaume d’Allinges, Baron de Coudrée,
séjournaient dans le château fort de la Rochette.
Cette réhabilitation n’aurait pas été possible sans le
soutien éclairé de nombreux amis de l’Histoire de Savoie et, en particulier :
- Conseil Général de la Haute-Savoie
- Henri Baud, Sous
Préfet
- Dr Jacques M et -
Prof. Tanner, Uni Genève
- Charles Bonnet,
Archéologue Cantonal
- M. Michaud, Architecte des Monuments Historiques
- 07 Février 2024. A la demande de son fils P. Guyon, qui nous a fait part d'un oubli dans la documentation utilisée, nous rajoutons son père Jean-Marie Guyon qui a été un piler de la restauration du château. Voici ce que nous en dit son fils:
"A la fin des années 60, les anciens propriétaires (Famille Mouchet de Thonon) ont été mis en demeure de restaurer le château par le Ministère des Affaires Culturelles et mon père a hésité pendant plusieurs mois avant de l’acquérir (puisque qu’il a été mis en vente en fin de compte) malgré les conseils prodigués par son ami de toujours : le Docteur Miguet de Douvaine ainsi que l’appui culturel et amical de l’ancien Sous-Préfet de Thonon et grand résistant : M. Henri BAUD avec le concours également de M. Michaud Architecte des Monuments Historiques à l’époque !
Seul un homme de caractère bien trempé (ancien du 27ème BCA ayant combattu à Narvik en 1940) et fabricant industriel de fours de boulangerie avec une formation de tailleur de pierres et de maçon pouvait relever le défi (puisqu’avant la seconde guerre il montait des fours en pierres maçonnées avec mon grand-père Alexandre, ancien combattant de 14-18).
Sa formation de tailleur de pierres lui a ainsi permis ce remonter ce monument puisqu’il taillait régulièrement des embrasures de fenêtres ou de cheminées avant cette acquisition !
40 années et une grosse partie de sa fortune engloutie dans cette restauration et nous continuons à le faire prospérer en organisant des mariages, des animations musicales et médiévales ainsi que beaucoup de visites d’écoles !
Une seule anecdote parlante : la visite de S. A. R. la Reine d’Italie Marie-José (dernière Reine en exercice) qui est venu inaugurer la salle des Dames en 1978 avec sa Cour Princière !
C’est le seul bâtiment historique ayant gardé son architecture et son caractère fondamentalement de type moyen-âgeux avec un fossé périmétrique qui a été remis à jour et procure ainsi une véritable machine à remonter le temps dès que vous pénétrez dans la cour intérieure étroite qui vous procure une très forte sensation de protection comme dans les temps reculés sans oublier une imagination fertile qui vous trotte dans la tête avec des scénarios divers de vie à ces époques !
Mon père est décédé en Mars 2017 et Grande Justice serait de lui rendre cet hommage et je vous en remercie par avance du fond du coeur !"
Voilà qui est fait!!
- N’oublions pas les Compagnons du Devoir : tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, ouvriers spécialisés, etc, qui, tous, dans l’esprit de leurs collègues du Moyen-Âge, eurent à cœur de réaliser de « la belle ouvrage ».
Avully, La Rochette, Buffavent, Langin, les Allinges,
Ripaille, Coudrée, Rovorée, Yvoire, le canton de Vaud, Valais, le Piémont nous
rappellent que la Savoie au XVe siècle avait un territoire plus grand que la
France.
Autrefois résidence privilégiée de quelques familles nobles,
il est maintenant à la disposition de nombreux visiteurs, venant admirer les
magnifiques jardins, le donjon, la tour en amande, les échauguettes, les
douves, etc ..."
Posté le 11-05-2013 16:09 par Jimre
Avully
Le château se situe à 500 m à l'Est du bourg.
Avant 1310, il est fait mention d'une famille d'Avully,
vassale de celle de Faucigny. Ils font vers 1323 hommage de leur maison forte
aux comtes de Savoie et en 1336 aux Dauphins. A cette occasion, on précise que
la place doit être fortifiée et son revenu s'élève à 10 livres.
Par mariage, la maison forte échoit au XVe siècle à la
famille de Boëge. Jacquemette de Boëge, fille de Jean de Boëge, en fait
reconnaissance et la donne le 23 mai 1441 au duc de Savoie Louis, qui la lui
revend le 29 mai de la même année. Elle est vendue en 1499 à un bourgeois de
Genève, Boniface de Saint-Michel. La maison forte sera fortement remaniée au XVIe
siècle.
Le château est constitué d’une enceinte quadrangulaire large
de 26 m et longue de 34 m, entouré de douves, flanquée à l'angle nord d'une
tour en amande et au sud d'une tour carrée couronnée de mâchicoulis. Des
échauguettes carrées à encorbellements munissent les angles est et ouest.
L’intérieur est agencé autour d'une étroite cour dans
laquelle on pénètre par une tour-porte de 5,50 par 10 m dont la base date du XIVe
siècle. Le corps de logis comprend, au rez-de-chaussée, la salle des gardes et
de la salle des écussons, au premier étage les salles des dames et du Cruet, et
au second la salle des messieurs et la salle de chasse.
L’extérieur comprend les jardins et la cour basse.
Sources:
Photos:
- Jimre(1999; 2013)
Vidéos:
Nous vous présentons une vidéo YouTube, tournée par Edssio dans laquelle on peut voir le château d'Avully il y a quelques années.
N'hésitez pas à aller faire un tour dans notre playlist Rhône Médiéval pour voir nos autres vidéos ainsi que sur la playlist "Les Invités de Rhône Médiéval" pour voir des vidéos réalisées par d'autres personnes sur la même thématique…
Si vous voulez voir les vidéos que nous faisons lors de nos déplacements en dehors de cette thématique, la playlist des "Videos de vacances" est également disponible.
Posté le 11-05-2013 15:51 par Jimre
La Tour de Langin

La tour se dresse à 786 m d'altitude sur un éperon rocheux contre-fort nord-ouest de la montagne des Voirons. Elle est le dernier vestige d'un puissant château qui dominait la route menant de La Roche-sur-Foron à Thonon et contrôlait l'accès au Chablais par la dépression qui s'étend entre les Voirons et le Mont de Boisy.
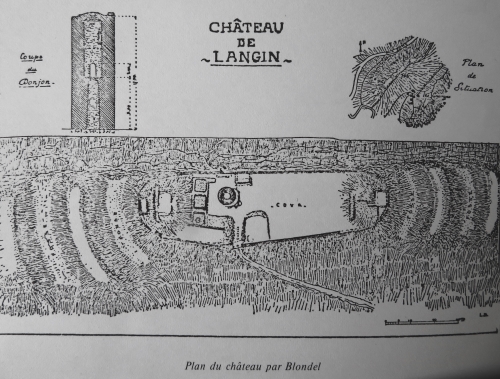
Le château qui dépendait de la châtellenie de Ballaison est
mentionné en 1225. À cette époque il est la possession de la famille de Langin, citée depuis 1113 comme vassale des comtes de Genève. Dans une charte du 14
juin 1294, Rodolphe de Langin et son frère Jean reconnaissent tenir en fief
d'Amédée II de Genève, comte de Genevois, le château de Langin. Sa position, à
la limite des possessions des sires de Faucigny et des comtes de Genève, fera
l'objet de contestations répétées en 1179, 1250 et 1282.
Par le mariage de Marie de Langin, qui épouse en 1509 Jean
d'Allinges, il passe à cette dernière famille qui le conservera jusqu'en 1840.
Il est détruit en 1591, sur ordre du Conseil du Genevois, lors des conflits entre Genève et la Savoie, et seul a subsisté le donjon.
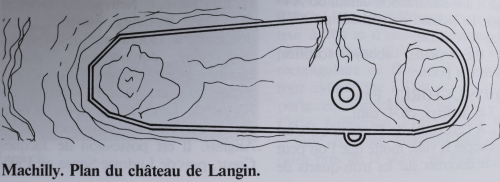
Le château occupe une large plate-forme ovale isolé par un
double fossé d'une vingtaine de mètres de largeur.
Le château de Langin se présentait sous la forme d'une enceinte polygonale longue de 42 m enchemisant un donjon restauré de forme circulaire de 6,90 m de diamètre daté du milieu du XIIIe siècle, voûté à son sommet. Il est un des premiers exemples caractéristiques des tours rondes de Savoie.
Les murs de l'enceinte datés de la fin du XIe siècle sont conservés sur plus de 40 m de long et présentent un appareil en arête-de-poisson (ou Opus spicatum) qu'encadrent des assises en plaques de grès et d'importants fossés étagés sur quatre niveaux qui remonteraient à l'époque préhistorique.
Sources:
- Plans fournis par Nano.M d'après:
* Châteaux, blasons et vieilles pierres de Huate-Savoie, Jacques Grombert, Editions Neva,
*
châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot,
Editions Horwath.
Photos:
- Jimre (2013, 2015)
- Nano.M (2022)
Posté le 11-05-2013 15:38 par Jimre
La Rochette
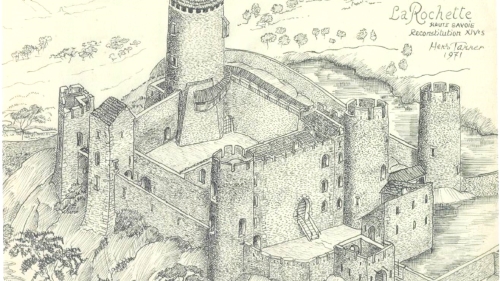
Sur la route de Thonon à Annemasse, entre le château d'Avully et les Allinges, on peut voir au lieu-dit La Rochette, sur la butte du Vernay, les ruines restaurées, du château de La Rochette. Niché dans un ecrin de verdure qui masque une partie de sa structure, il a été construit en imitant les forteresses comtales, et représente un bon exemple de l’architecture militaire du XIIIe siècle. La façade sud, précédée d'une avant-cour, est encadrée par deux tours rondes. Le donjon, cylindrique lui aussi, se dresse sur l'éperon rocheux qui s'avance dans l'angle nord-est. Les fenêtres sont munies de bancs de pierre et le crénelage est en grande partie conservé.

Le château est construit peu après 1250 par Gérald de
Cervens qui donne alors naissance à la lignée des Cervens du Vernay. Les
seigneurs de Cervens, furent entre autre les co-fondateurs de la chartreuse de Vallon. Françoise
de Cervens du Vernay, dernière de la lignée, hérite du château de la Rochette
qu'elle transmet à son mari Guillaume d'Allinges en 1473, il restera aux mains
des d'Allinges jusqu'à l'extinction de
cette famille en 1840.
C'est dans ce manoir, dont les créneaux qui en surmontent
encore les restes attestent et l'importance et l'antiquité, que vivait, vers la
fin du 15me siècle, Le sire Aymon de la Rochette, le favori du comte, puis duc
de Savoie Amédée VIII; c'est là qu'avant d'aller s'enfermer à Ripaille, ce
prince, comme témoignage d'amitié, lui fit épouser sa nièce Mathilde, bien que
le cœur de cette belle fût déjà donné au seigneur des Allinges, ce qui mit en
hostilités constantes ce fier baron et le sire de la Rochette.
En 1590, le château est brûlé par sa propre garnison pour empêcher qu'il ne tombe aux mains des Genevois. Brûlé mais pas démoli, il conservera l'intégralité de ses murailles jusqu'au XIXe siècle, époque où il servira de carrière de pierres.
En 1840, le marquis Alfieri di Sostegno, héritier des marquis d'Allinges-Coucirée, met en vente les ruines de la Rochette qui sont acquises par la famille Dénarié.
Sources:
- chateau-fort-manoir-chateau.eu
- Photos et reconstitutions fournies par Nano.M d'après: Châteaux, et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, Editions Horwath.
Photos:
- Jimre(2013)
- Nano.M (2022)
Posté le 11-05-2013 15:27 par Jimre
Les Allinges

Dominant Thonon les Bains et le lac Léman, alimenté par le Rhône, la montagne des Allinges offre une vue imprenable sur le Lac et les montagnes environnantes avec notamment la Dent d’Oche, que nous avons gravie personnellement il y a une quinzaine d’année.
L’histoire de la région et en particulier de la Savoie et du Dauphiné ou de la France et de la Suisse, s’est souvent écrite ici aussi, avec les luttes entre les comtes de Savoie et les Sires de Faucigny, alliés des Dauphinois, les Genevois, les Bernois, ou plus tard les Français, pour des prétextes de géostratégie comme on dirait aujourd’hui ou des prétextes religieux.
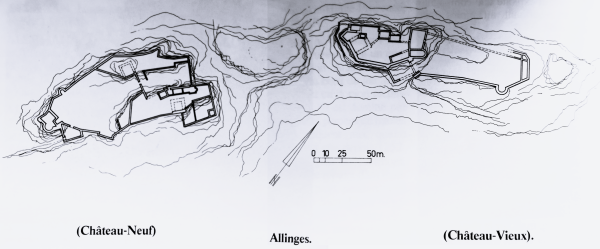
Ainsi, sur cette colline, les aléas de l’Histoire des hommes de la région y ont posé non pas un mais deux châteaux, Château-Neuf et Château-Vieux. Ici, comme souvent ailleurs, la présence des deux châteaux n'est pas dûe à une évolution liée à la nécessité de s'adapter aux différentes époques. Un château n'a pas succédé à l'autre. Les deux châteaux ont été la plupart du temps occupés en même temps.
Ce n’étaient pas que de simples bâties, mais deux puissants châteaux, presque symétriques. Il n’y manquait rien de l’art miliaire, donjon massif, plain château, Mur-bouclier,bourg castral, pont-levis, herses, échauguettes, hourds et mâchicoulis. Cela est un indice de l'intérêt stratégique qu'ils représentaient aux yeux de leurs propriétaires.
Et contrairement à beaucoup d’autres, simples manifestations de la puissance seigneuriale, ceux-ci ont servi pendant des siècles, tour à tour de refuge, havre de paix, ou foyer de guerre. Ici plus que partout ailleurs la proximité des deux châteaux, lorsqu’ils formaient une frontière entre deux factions, a exacerbé les conflits. Il n’est qu’à regarder les grosses pierres sphériques qui ont été installées en ornement sur le site du Château-Neuf et qui sont sans doute des projectiles ayant été catapultés d’un château à l’autre.
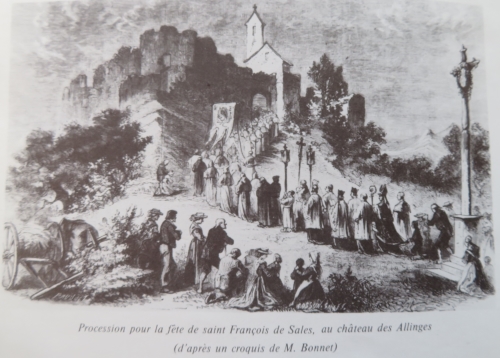
Les frontières mouvantes ayant rendus leur importance moindre, les conflits religieux s’étant apaisés, ces forteresses sont devenues des lieux de repos de l’âme avec l’arrivée notamment de François de Sales, né au château de Glières-Thorens dans une famille importante pour la région d’Annecy, prêtre à 26 ans et évêque d’Annecy à 35 ans. Missionnaire plein de zèle, il vient aux châteaux des Allinges et y célèbre la messe pendant six mois, se donnant pour mission d’évangéliser les Chablaisiens : en quatre ans, il convertit 25000 personnes dans une région hostile aux mains des Bernois protestants. Avec l’aide de Jeanne-Françoise de Chantal, qu’il a vue en vision devenir une des trois premières visitandines, il y fonde l’ordre des sœurs de la Visitation. Tous les deux seront sanctifiés.
De nos jours, les travaux de sauvegarde du site, abandonné et livré au pillage, ont été réalisés par L’ASCA, Association pour la Sauvegarde des Châteaux des Allinges, créée en 1972 sous l’impulsion de Mr LANORE, passionné d’histoire et membre de l’Académie Chablaisienne. Plus tard, les travaux ont été réalisés par des travailleurs des Chantiers d’Insertion(Le Lien et Chablais Insertion)
Le site des Châteaux est propriété de la commune depuis 2001.
Les grandes dates du site des Allinges :
- Au Ve siècle, les Burgondes, maitres de la région, édifient le Château-Vieux
- Au Xe siècle, la dynastie des Rodolphiens restaure le Château-Vieux et bâtit le Château-Neuf
- Au XIe siècle, le Château-Neuf est attribué au Comte de Savoie avec le Chablais et le Château-Vieux est donné au Sire de Faucigny qui sont alliés au Dauphinois.
- Ce partage est à l’origine des guerres entre les deux familles aux XIIIe et XIVe siècles. Une lutte s'engage en effet entre les deux partis de 1268 à 1355.
- En 1355, La Savoie contrôle toute la région et Amédée VI, le « Comte Vert », devient seul maitre des deux châteaux et la région va connaître deux siècles de paix.
- Avec l’avènement de la religion Protestante, les luttes pour des raisons religieuses occupent comme dans toute l’Europe, la région. A partir de ce moment de nombreuses périodes de guerre vont opposer la Savoie contre Berne, Genève et la France. Le Chablais devient Bernois et donc protestant en 1536. Il revient par la suite à la Savoie en 1556. En 1594-1595, les châteaux, occupés par le baron d’Hermance, donnent asile à Saint François de Sales.
- En 1703, le duc Victor-Amédé II de Savoie, en guerre contre la France, fait sauter les châteaux, faute de pouvoir les défendre ou les entretenir.
- En 1832, Monseigneur Rey, évêque d’Annecy, fait remettre en état la chapelle du Château-Neuf, abandonnée depuis 1703. La voûte a résisté sous l’amas de décombres et a permis de conserver jusqu’à nous une magnifique fresque datée d'avant 1050, "le plus ancien vestige de l’art pictural en Savoie"(R. Oursel), classée au titre des Monuments historiques. Il fait de cette chapelle un centre de pèlerinage salésien dont il confie le soin aux Missionnaires de Saint François de Sales.
- De nos jours, après la sauvegarde du site et l’aménagement de chemins de circulation, de nombreux chantiers de fouille sont organisés au niveau du Château-Vieux, afin de mieux comprendre le mode de vie au Moyen-Âge dans le bassin lémanique.
Du Château-Neuf, il ne reste que les remparts dont on franchit à pied les deux portes à mi-pente et la chapelle.
Arrivé au bout de l'esplanade, on peut prendre le chemin qui descend derrière la chapelle et qui conduit au Château-Vieux à 150 m de là. On se présente alors devant ce qu'il reste du donjon, une muraille de 46 m et 125 m de remparts.
Sources:
- Documents fournis sur les lieux et panneaux situés autour des châteaux.
- Photo et croquis fournis par Nano.M d'après: Châteaux, et maisons fortes Savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot, Editions Horwath.
Photos:
- Jimre(2013)
Posté le 09-05-2013 10:14 par Jimre
Clermont en Genevois
Clermont, en Genevois, commune dans le département de Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes, possède deux châteaux. Le premier est un ancien château fort du XIe siècle en ruine et le second, visible sur nos photos, est un château Renaissance du XVIe siècle.
À l'origine possession des seigneurs de Clermont (la famille de Clermont est mentionnée en 1064 comme vassal des comtes de Genève), il passe à l'extinction de la lignée aux Comtes, qui en font le centre d'une châtellenie, puis le siège du bailliage du Genevois. Le château leur sert de résidence aux XIIIe et XIVe siècle et ils y font des travaux.
Le château comtal du Moyen Âge se dressait au sommet d'un crêt molassique le « Molard » à 690 m d'altitude dominant l'ancien bourg de Clermont, fortifié également. Au Moyen-Âge, Clermont était une importante bourgade fortifiée. Le château, à 30 km d'Annecy et 50 de Genève, surveillait la route de Chambéry à Genève et le carrefour des routes vers Seyssel à l'ouest et vers Sallenôves à l'est.
Il ne reste pratiquement plus rien du château médiéval. On distingue encore les débris d'une enceinte et les soubassements d'un donjon cylindrique de 10,40 m de diamètre.
A l'extinction du dernier comte de Genève, Robert, l'antipape Clément VII, le duché échoit à Humbert de Thoire-Villars, neveu du comte de Genève, puis en 1400 à Odon de Thoire, qui vend ses droits à Amédée VIII de Savoie pour 45 000 francs d'or, en 1401. Ainsi Clermont deviendra propriété des comtes de Savoie.
Le père de Gallois de Regard aura la charge de châtelain pour le compte du duc de Savoie (c'est en 1416 que l'empereur Sigismond octroie à Amédée VIII le titre de duc).
Le Château Renaissance de Clermont fut érigé entre 1576 et 1580 à partir des pierres du vieux château sur le flanc sud de la colline là ou s'étendait le plain-château de l'ancienne forteresse médiévale, qui sera démantelée en 1630 lors de l’invasion par les Français.
Le Château de Clermont a été construit par Gallois de Regard (1512-1582), évêque de Bagnorea et originaire de Clermont. Après l’absorption du comté par la Savoie, la famille de Regard accède à la fonction de châtelain. Le duc de Savoie Emmanuel-Philibert autorise le 2 novembre 1576 l'évêque Gallois de Regard, ce proche des Papes, à faire bâtir sa résidence sur des éléments médiévaux qui composaient la maison de son père, notaire.
Un de ses successeurs, Alexandre Gaspard de Regard, seigneur de Clermont, reçoit royalement le duc Charles-Emmanuel II de Savoie ce qui a donné lieu à de superbes réjouissances.
Réalisés à partir d'un ensemble d'édifices préexistants, les travaux ont néanmoins abouti à la mise en place d'un ensemble monumental cohérent et harmonieux. Le Château est composé de grands bâtiments, avec une cour intérieure entourée d'une triple galerie à arcades, une cuisine d’époque, escalier.
Certains éléments architecturaux, telles que les grandes fenêtres sans meneau ni traverse du corps de logis, les galeries sur la cour intérieure et la façade imposante décorée percée d'une immense fenêtre-balcon, qui servait autant à voir qu’à être vu, témoignent à la fois du raffinement et de la connaissance architecturale de son commanditaire.
L'ensemble du château a été classé Monument Historique le 21 avril 1950 et le château est propriété du département de la Haute-Savoie depuis 1966.
Les décors intérieurs sont inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 6 juillet 1988.
En 2006, il devient un domaine départemental d'art et de culture. Chaque été une large programmation de spectacles y est présentée.
La visite-guidée du château est enrichie au fur et à mesure des découvertes des archéologues et historiens qui mènent depuis 2009 un grand programme de recherches scientifiques destinée à la mise en valeur du patrimoine.
Sources :
-http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Clermont_%28Haute-Savoie%29
-http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/chateau-de-clermont/74SESOR100025 (-->ce lien n'est plus actif 8:-()
-http://haute-savoie.ialpes.com/musees/chateau-clermont.htm
Photos:
- Jimre (2010, 2013)
Posté le 21-02-2013 11:44 par Jimre
La Roche sur Foron
La Roche sur Foron, est une petite ville située entre Annecy et Genève.
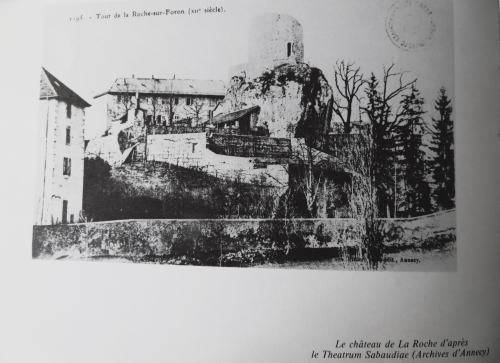
Le château visible de loin fait partie des châteaux classés dans les châteaux de site rocheux. En effet, un donjon cylindrique surmonte un étroit rocher, entouré des restes d'une enceinte polygonale.
Source:
- L'évolution des chateaux forts dans la France au Moyen-Âge, de P. chatelain, édition Publitotal.
Photos:
- Jimre (2009)
- Jimre (2023)
Posté le 27-01-2013 19:12 par Jimre
ANNECY
Située à égale distance entre Genève et Chambéry, son histoire du Xe au XIXe siècle est fortement marquée par l'histoire de ces deux villes.
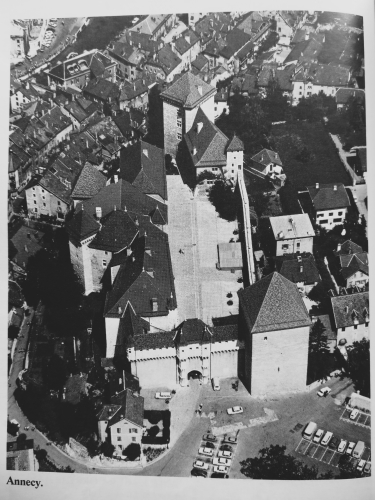
Les débuts d’Annecy
Avec l'affaiblissement de l'Empire romain, de nombreux peuples barbares déferlent sur la Gaule. En 259, le vicus subit une importante attaque, est rasé et sa population massacrée. Les survivants se réfugient dans les grottes du mont Veyrier. Restauré, Boutae connaît un nouvel essor au siècle suivant. La période gallo-romaine apparaît quelque 50 ans avant notre ère et voit rapidement émerger un "vicus" d'environ 2 000 âmes désigné du nom de Boutae et dont l'urbanisation dans la plaine des Fins a laissé suffisamment de vestiges pour permettre de connaître avec exactitude l'implantation du forum, de la basilique, des thermes (visibles 36 avenue des Romains) et du théâtre, dernier élément susceptible d'être remis à jour.
La forme triangulaire de cette cité témoigne de la prépondérance des axes de circulation convergeant à ce carrefour ; chaque pointe étant dirigée vers Faverges (Casuaria), Aix-les-Bains (Aquae) et Genève (Geneva).
Annecy et les invasions
Mais, lors des grandes invasions du début du ve siècle, le vicus est définitivement détruit. Les Burgondes occupent la région qui est annexée par les Francs au vie siècle. L'insécurité grandissante contraint les habitants à abandonner la plaine pour les collines voisines, comme l'atteste le domaine agricole de la villa « Anniciaca » (colline d'Annecy-le-Vieux) au VIIIe siècle, qui devient un domaine royal au siècle suivant.
Nul ne doute que les sarrasins qui étaient établis au Fraxinetum, sur la côte méditerranéenne, ont dû séjourner ou passer par les environs du lac d’Annecy pour mettre en place leurs embuscades.
Après la dispersion de la population de Boutae au VIe siècle, une nouvelle étape est franchie avec l'occupation progressive des rives du Thiou au débouché du lac à, emplacement privilégié comportant un passage incontournable à la grande voie nord-sud pour le franchissement de la rivière à hauteur de l'Ile.
Dès lors s'organise la cité du Moyen Age de part et d'autre des rives du Thiou sous la protection de fortifications qui deviendront le château. Au départ, il s’agit d’une simple tour adossée à un contrefort du Semnoz, marquant le siège d’une seigneurie. Un texte de 1107 confirme la naissance d'Annecy-le-Neuf sur les rives du Thiou et fait une première mention d'une église Saint-Maurice sous le château. Ce dernier et la bourgade d'Annecy-le-Neuf se développent sous le comte Amédée Ier (de Genève). Elle a alors l'apparence d'un gros village avec de nombreuses étables, mais dispose de précieux atouts :
- le lac pour la pêche et la navigation, le transport des produits pondéreux (pierres et bois) ;
- la chaux, la molasse, le sable, les graviers, les pierres de Cran, le tuf de Vieugy, le calcaire, les bancs d'argile et le minerai de fer du Semnoz ;
- les vastes forêts de Chevêne et du Semnoz pour le bois et le gibier ;
- la fertile plaine des Fins pour l'agriculture ;
- les pâquiers (pâturages) autour de la ville ;
- le canal du Thiou avec sa force motrice permettant d'installer des artifices hydrauliques (moulins, meules, pilons, battoirs, tours, martinets, soufflets, scies mécaniques...) ;
- une élite de maîtres artisans, de marchands de textile et de fer, d'hommes de loi et d'officiers...
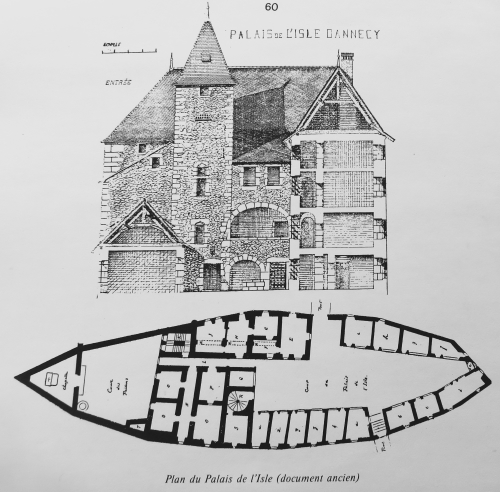
En 1132, une maison forte est édifiée sur l'île au milieu du Thiou. En lutte permanente avec les évêques de Genève, les comtes de Genève finissent, à la fin du XIIe siècle, par se réfugier à Annecy où ils occupent le manoir de Novel au fond de la plaine des Fins, puis le château qu'ils agrandissent au XIIIe siècle. La ville devient donc capitale du comté.
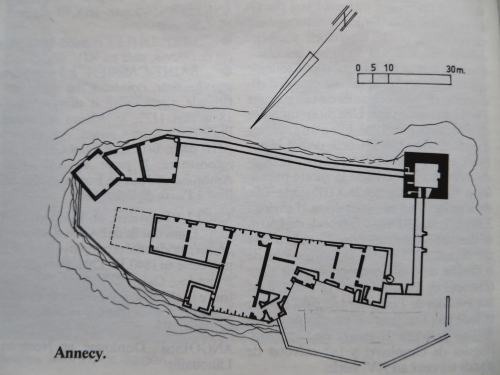
Dès le XIIIe siècle, la ville est entourée d'une enceinte fortifiée, faite d'une ceinture de courtines et de tours, utilisant souvent les murs aveugles des maisons (les murenches), appuyée sur le château et sur le canal du Vassé qui sert de fossé sur tout le pourtour au nord du Thiou, percée de poternes et de quatre portes principales : Perrière au sud-est, du Sépulcre à l'ouest, de Boutz ou Bouz (désignant l'ancien vicus gallo-romain de Boutae et non un "bœuf") au nord et du Pâquier (porta pascuorum ou des pâturages) au nord-est, ainsi que de quatre arcs fortifiés avec herses et chaînes de fer sur les canaux, un à chaque extrémité intra-muros du Thiou et du canal Saint-Dominique/Notre-Dame.
Le XIVe siècle est marqué par le long règne du comte Amédée III de Genève de 1320 à 1367, date à laquelle les franchises d'Annecy sont confirmées. La comtesse Mahaut de Boulogne, épouse du comte, donne naissance au dernier des comtes de Genève, Robert, au château d'Annecy. Celui-ci provoque le Grand Schisme d'Occident en devenant le pape Clément VII, en résidence en Avignon. En 1394, Robert de Genève fait ériger l'église Notre-Dame-de-Liesse, nécropole des comtes de Genève, en une collégiale qui, devenant le centre d'un pèlerinage très populaire, confère à Annecy un immense prestige.
Annecy et la maison de Savoie
Cette installation activera l'édification du château promu résidence princière jusqu'à l'extinction de la famille de Genève survenue en 1394 avec la disparition du dernier représentant de cette lignée : Robert de Genève, devenu antipape d'Avignon sous le nom de Clément VII. C'est quelques années plus tard, en 1401, qu'Annecy devient Savoyarde avec l'acquisition du comté de Genève par la maison de Savoie sous l'autorité du plus prestigieux de ses princes : Amédée VIII, premier duc de Savoie.
Le comté de Genève se trouve démembré en un comté de Genève proprement dit (avec la ville et ses environs) et un comté de Genevois avec Annecy pour capitale
L'ancienne capitale du Genevois va traverser une période de désolation causée par une succession d'effroyables incendies détruisant la plus grande partie de la ville en 1412 puis en 1448. Le comte Amédée VIII aide la ville d'Annecy à se reconstruire après le terrible incendie du 3 février 1412 qui la détruit entièrement et au cours duquel même le château est touché.
Il complète encore cette marque d'attachement en érigeant l'apanage du Genevois en faveur de son fils Philippe (1444). Ainsi Annecy se relève de ses cendres et reprend son rôle de capitale d'une contrée couvrant le Genevois, le Faucigny et le Beaufortin.
En 1422, le cardinal de Brogny, originaire du comté, fait édifier la grande église Saint-Dominique qui deviendra l'église Saint-Maurice. Pour rallier les habitants, qui ne voient pas d'un bon œil leur rattachement à la maison de Savoie, Amédée VIII (fait duc en 1416) crée en 1434 l'apanage de Genevois et Faucigny qu'il confie à son fils cadet, Philippe de Savoie. Cet apanage disparaît à la mort sans postérité de ce dernier en 1444, mais il est reconstitué de 1460 à 1491 au profit de Janus de Savoie, fils de Louis Ier de Savoie, qui fait d'Annecy sa résidence officielle alors qu'il est comte de Genevois, baron de Faucigny, seigneur de Beaufort-Ugine-Faverges-Gourdans. Un deuxième incendie ravage la ville le 13 mai 1448, causant des dommages importants aux maisons et aux deux églises. De nouveau capitale d'apanage, Annecy bénéficie de la sage administration de Janus de Savoie et des fastes de sa cour. C'est à ce moment-là que sont établis les principaux organes du gouvernement du comté : conseil comtal, chambre des comptes, procureur fiscal, juge mage.
À la mort de Janus, Annecy est de nouveau rattaché à la Savoie de 1491 à 1514. En 1514, Charles III de Savoie inféode le Genevois et les baronnies de Faucigny et de Beaufort à son frère Philippe. Annecy est alors de nouveau le centre d'un apanage allant du Genevois à Ugine.
Cette brillante dynastie de princes apanagés noue des liens matrimoniaux avec la famille royale de France et reçoit de François Ier le duché de Nemours (près de Fontainebleau), conférant à nos nouveaux princes le titre de duc de Genevois-Nemours.
Philippe (duc de Nemours en France en 1528) est le premier prince de la dynastie des Genevois-Nemours qui se prolonge jusqu'en 1659 (à la mort d'Henri II, dernier duc de Genevois-Nemours, le 14 janvier). En fait, c'est Jacques de Savoie-Nemours qui devient le premier duc de Genevois, le comté ayant été érigé en duché en 1564 par Emmanuel-Philibert qui entend s'attacher et surveiller ce prince trop français à son gré qu'est Jacques de Nemours, fleur de toute la chevalerie selon Brantôme. L'administration du bourg d'Annecy est alors de la responsabilité d'un conseil général, assemblée des bourgeois de la ville, qui élisent quatre, puis deux syndics pour trois ans. À partir de 1491, un conseil étroit dit des Douze, comprenant les syndics et des conseillers, prend en charge les affaires de la ville.
La ville est parcourue par des artères appelées charrières ou ruales, souvent bordées par des arcades, dont la disposition est d'une grande simplicité : deux axes est-ouest parallèles au Thiou et un axe nord-sud perpendiculaire. La première voie, la plus importante, appelée magna carreria ou « grande charrière », relie la porte Perrière à la porte du Sépulcre en longeant le rocher. La deuxième voie, parallèle, sur la rive droite du Thiou, est dénommée charrière de la Halle (rue Grenette), prolongée par la ruale du Four (rue J.-J. Rousseau). La troisième voie, perpendiculaire, part du pont de l'Isle et, par les charrières Filaterie et Notre-Dame, rejoint les portes de Boutz et du Pâquier. Le quadrillage interne se trouve complété par des quais, des places, des rues transversales, des allées et de nombreux passages couverts. Un canal intérieur, issu du Thiou près de l'église Saint-Dominique, traverse la cité et va se jeter dans le Vassé après la collégiale Notre-Dame-de-Liesse.
De nombreux artifices sont installés le long du Thiou pour moudre les céréales, mais aussi et surtout pour le travail du chanvre, du cuir et notamment du fer qui confère à Annecy une solide réputation de centre métallurgique spécialisé dans la fabrication des couteaux, des armes blanches et des armures. Les armes et les couteaux d'Annecy sont commercialisés dans tout le duché et même dans les États voisins. Annecy s'inscrit dans le vaste circuit d'échanges européens, profite des retombées de la prospérité de Genève et bénéficie de sa propre foire annuelle à la Saint-André.
Annecy siège épiscopal et « Rome des Alpes »
Portrait de saint François de Sales.
Cette période a marqué durablement l'histoire d'Annecy, qui deviendra siège épiscopal avec le départ précipité de l'évêque de Genève qui préféra quitter sa ville à la veille de la Réforme protestante menée par Calvin(1535), suivi de plusieurs communautés religieuses venues renforcer encore le caractère religieux d'Annecy que des historiens appelleront "la Rome de la Savoie".
C’est ainsi, qu’à partir de 1536, les chanoines de la cathédrale Saint-Pierre s'installent à Annecy ainsi que des ordres religieux catholiques comme les clarisses.
De cette époque, Annecy conserve de beaux monuments venus enrichir son patrimoine : le Logis Nemours au château, la cathédrale Saint-Pierre, la Maison Lambert, le clocher de l'église Notre-Dame-de-Liesse. Si l'on ajoute à cela le glorieux épiscopat de François de Sales, l'ouverture du Collège chappuisien, la création de l'Académie florimontane, on peut parler sans crainte d'un âge d'or pour notre ville.
À partir de 1560, la Savoie du Nord et Annecy, placés en un point stratégique sur la ligne de partage des confessions, deviennent une citadelle avancée de la Contre-Réforme. Si le premier évêque de Genève à résider de façon permanente à Annecy est Ange Giustiniani (1568-1578), les débuts de la Réforme catholique datent effectivement de son successeur, Claude de Granier (1578-1602).
A la fin du XVIe siècle, Charles Emmanuel Ier, duc de Savoie et Henri IV, alors roi de France entrent en conflit. Les calvinistes en profitent pour faire main basse sur des biens régionaux. Cette guerre se termine à la fin des années 1590 et débouche sur le traité de Lyon.
C'est François de Sales (1657-1622), enfant du pays né au château de Thorens - Glières (son père l'envoie à l’âge de six ans au collège de La Roche, puis au collège d'Annecy, fondé par Eustache Chappuis en 1549, où il est un bon élève) - évêque de Genève en résidence à Annecy de 1602 à 1622, qui, après avoir lui-même prêché, jette les bases d'une solide réforme du clergé et d'une transformation des mœurs et des mentalités dans son diocèse. Il marque de façon durable la ville et toute la région grâce à son prestige intellectuel et spirituel. Bien plus, son rayonnement ne s’étend à toute l'Europe catholique avec l'immense succès de l'un de ses deux plus célèbres ouvrages, L'Introduction à la vie dévote. Ainsi Annecy devient la « Rome des Alpes ». Dès 1606, vingt-huit ans avant la fondation de l'Académie française, François de Sales (canonisé en 1666) et le président Antoine Favre (du Sénat de Savoie) créent, à la mode italienne, l'Académie Florimontane ("fleurs et montagnes"). En 1610, François de Sales et Jeanne de Chantal fondent l'ordre de la Visitation. Dans le cadre d'un vaste mouvement des ordres nouveaux, nés de la Réforme catholique, Annecy accueille les capucins en 1592, les visitandines en 1610, les barnabites en 1614, les annonciades de Saint-Claude en 1638, les bernardines réformées en 1639, les lazaristes en 1641, les cisterciennes de Bonlieu en 1648. La présence religieuse est donc très importante à Annecy qui compte treize maisons religieuses pour 5000 habitants. La moitié de la ville appartient à différents ordres religieux qui possèdent non seulement les églises et les couvents, mais aussi des ateliers, des moulins et de vastes terres et forêts. Ces ordres religieux, qui ont la charge de l'éducation et des hôpitaux pour les malades et les pauvres, font travailler les artisans et les commerçants locaux.
Pendant la Révolution française et l'époque napoléonienne, la ville est rattachée au nouveau département du Mont-Blanc dont le chef-lieu est Chambéry, puis, à la restauration, revient dans les possessions de la Maison de Savoie.
En 1860, suite au rattachement de la Savoie à la France, elle devient le chef-lieu du nouveau département de la Haute-Savoie.
Architecture du château
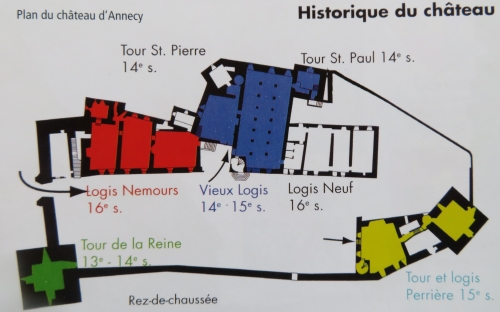
La cour intérieure est bordée d'anciens bâtiments d'habitation de trois époques différentes :
-le Logis Vieux édifié vers 1333, demeure austère des comtes de Genève. Sa tourelle avec ses escaliers en colimaçon et son arcade couvrent un puits de 40 mètres de profondeur.
-le Logis de Némours en 1545, architecture du début de la renaissance.
Occupé aujourd'hui par un musée régional.
-le Logis Neuf en 1571. Ce bâtiment abritait la garnison du château.
Deux tours encadrent cette cour : la tour de la Reine datant du 12ème siècle et la tour Perrière du 15ème.
La tour Perrière et son logis furent construits par le duc Louis 1er de Savoie. Les services administratifs du duché s'y installèrent. Aujourd'hui dans cette tour, se trouve la salle des Fresques : lieu d'exposition de peintures et conservatoires de décors muraux peints au 15ème, ainsi que l'observatoire régional des lacs alpins avec ses aquariums. Une muraille entoure le château pour le protéger des assaillants éventuels.
Sources:
-http://www.annecy.fr/index.php?idtf=47
-http://www.annecylevieux.org/articles.php?lng=fr&pg=28
-http://www.annecy-ville.fr/ville-annecy/histoire-de-la-ville-dannecy/
-http://www.123savoie.com/article-271-1-chateau-annecy.html
-http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d'Annecy
-http://www.annecy-info.com/histoire.html
- Plans, dessin et photo fournis par Nano.M d'après:
* Châteaux, blasons et vieilles pierres de
Haute-Savoie, Jacques Grombert, Editions Neva,
* Châteaux et maisons fortes savoyards, Michèle Brocard, Elisabeth Sirot,
Editions Horwath.
Photos:
- Jimre (2011, 2024)
Posté le 12-11-2011 11:03 par Jimre
Montrottier
Situation et histoire :
Le château médiéval de Montrottier, près de Lovagny, est un superbe ensemble de batiments dont certains remontent au XIIIe siècle. C’est une forteresse pentagonale réalisée sur le plan s’ordonne autour d’un donjon cylindrique à machicoulis et courtines.
Son rôle consistait à surveiller la route Chambéry-Genève franchissant les Gorges du Fier, endroit éloigné des ponts d'Annecy et d'Hauteville. Sa situation est liée au travail d'érosion du Fier, descendant du Mont-Charvin, sculptant de profonds défilés naturels.
C'est au-dessus des gorges du Fier, à Lovagny, que ce château-fort fut édifié entre le XIIIe et le XVe siècle.
Malgré les remaniements, le château de Montrottier conserve aujourd'hui encore des éléments significatifs de l'architecture militaire médiévale.
Au XIIIe siècle, fut construite une enceinte hexagonale, protégée au nord par les gorges du Fier, comportant une tour carrée, la « Tour des religieuses », isolée sur le piton rocheux et protégée au nord par la «Grande Fosse» (lit du Fier au quaternaire), ainsi qu'un bâtiment pour le corps des gardes. La tour présente des caractéristiques de Maison-forte sans en être une à proprement parler. Les poutres de la tour ne furent pas incrustées dans les murs mais seulement posées sur des corbeaux, afin d'évacuer l'humidité et permettre un changement plus facile.
C’est au XIVe siècle qu'est édifiée la tourelle d'angle abritant l'escalier hélicoïdal à limon suspendu.
Des ajouts ont été faits au XVe siècle et la partie ouest fut remaniée au XIXe siècle. Le logis des chevaliers, le logis des comtes, la courtine et le donjon datent du XVe siècle. Les terrasses et les jardins du XIXe.
Le donjon, le corps de logis des Chevaliers et la tour de la Religieuse font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 1er septembre 1919 et la visite du château est possible depuis 1919.
Les terrains entourant le château font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 5 janvier 1935. La ferme et les bâtiments composant le château à l’exception des parties classées font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 3 novembre 1987.
Le château abrite de remarquables ensemble de meubles, faïences, dentelles, armes, objets rares d'Afrique et Extrême-Orient, réunis par Léon Marès, l'un des derniers grands collectionneurs de la fin du 19ième siècle, et, quatre bas-reliefs en bronze, chefs-d'œuvre de Peter et Hans Vischer de Nuremberg, fondeurs du 16ième siècle.
Les Propriétaires du château :
Depuis Jean de Montrottier au 13ième siècle jusqu'à l'Académie Florimontane de nos jours, le château a appartenu à divers propriétaires dont les plus notables sont :
- - Il fut la résidence des seigneurs de Montrottier dont il porte le nom jusqu'au milieu du XIIIe siècle et passe à la famille de Grésy qui le donne en 1425 à Amédée VIII, qui le revend à Pierre de Menthon. Ce dernier va faire effectuer beaucoup de travaux de construction et de rénovation.
- - Pierre de Menthon, conseiller et ambassadeur d'Amédée VIII, premier duc de Savoie (15e siècle à la révolution française). Sous Pierre de Menthon est construits le « Logis des chevaliers », le « Logis des Comtes », et le donjon central à mâchicoulis : 33,5 m de haut pour une circonférence de 30,6 m ; comprenant 5 salles superposées et accessibles par une passerelle de bois depuis le premier étage du « Logis des Comtes »
- - A la Révolution, il est vendu comme bien national à un consortium genevois puis à Bénédict Dufour. La famille Dufour le vend en 1839 au baron Jules de Rochette, dont l'épouse fera aussi d'importants travaux, en remaniant le « Logis des Comtes » et en remplaçant l'escalier du « Logis des Chevaliers » par un escalier d'honneur.
- - Victor Frèrejean, industriel lyonnais qui achève le grand escalier (fin XIXème siècle).
- - Léon Marès, prodigieux "collectionneur des collections" qui à sa mort, en 1916, légua le domaine à l’Académie Florimontane (société savante fondée à Annecy, en 1606, par Saint-François de Sales et son ami le juriste Antoine Favre, père du grammairien Vaugelas).
Sources :
Photos:
- Jimre (2011)
- Nano.M (2022)
Posté le 11-11-2011 18:22 par Jimre
Thorens
Retranscription d'une partie du livret(publié en 1971) sur l'Historique du château de Thorens, écrit par le Comte J.F. de Roussy de Sales (1928-1999) .
"Texte reproduit avec l'autorisation exclusive de la comtesse Isabelle de Roussy de Sales. Toute autre reproduction, même partielle est soumise à autorisation." / "Brochure en vente sur place, au château de Thorens."
Le paysage de la région est semblable au dieu romain Janus à double visage. D'un côté, il présente une face sévère, évoque un décor d'opéra wagnérien. De l'autre, c'est la partie souriante : elle est faite de calme champêtre.
Ici la nature a profondément marqué les hommes de son empreinte. L'histoire en donne une remarquable illustration : le seigneur Jean de Compey est le féodal arrogant, imbu de sa puissance brutale.
L'autre, l'évêque empli de mansuétude et de paternelle douceur, c'est François de Sales.
La vallée de Thorens était reliée aux autres régions par un chemin indigène allobroge. Il permettait aux habitants du Haut-Fier de gagner la vallée de l'Arve. Contournant la montagne de Parmelan, la sente passait à gué la Fillière.
A l'époque romaine, ce chemin abrupt fut amélioré au passage le plus dangereux, à Dingy, par les esclaves de L. Tincius Paculus, dans le premier siècle de notre ère. Avant ces travaux, on escaladait péniblement le rocher, mais à partir de ce moment les véhicules purent emprunter la voie, augmentant ainsi considérablement son trafic. Cela permet de présumer que le gué fut remplacé par un pont entretenu.
A partir de la moitié du troisième siècle la quiétude dans laquelle prospérait la région fut gravement troublée par une succession d'invasions particulièrement celles des alamans et des burgondes alliés aux goths.
Les burgondes établirent un royaume éphémère dont Genève devint le centre. Puis, sous la poussée des peuplades franques, ce royaume fut absorbé et incorporé, en 532, à l'empire Franc durant quatre siècles. Lors du partage de l'empire carolingien, une portion, la Lotharingie, revint à l'empereur Louis II. Celui-ci en concéda très probablement une partie, le duché de Transjurane, à Conrad, Comte d'Auxerre, dont le fils Rodolphe fut proclamé et sacré roi de Bourgogne dans l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, en 888.
En 1032, le dernier roi de Bourgogne remit en mourant le royaume à son suzerain, l'empereur germanique. Ce retour du royaume à l'empereur irrita fort la parenté du dernier roi. Gérold, Comte de Genève, son neveu direct par sa mère, entendait en tirer avantage et tous se rebellèrent contre l'empereur. Grâce à l'appui de ses vassaux qu'un quatrain patoisant mentionne :
« Terny, Viry, Compey Sont les meillous maisons dou Genevey.
Salanova, Menthon Ne leu cédont pas d'un boton ».
Gérold conserva sa position de Comte de malgré la soumission des prétendants lorsque l'empereur entra à Genève, en 1034, à la tête de ses troupes.
Monseigneur Charles-Auguste de Sales en 1659, se référait à la chronique de La Roche. Il relata la construction du fort de Thorens en 1060 par le comte Gérold, celui-ci aurait donné le gouvernement du château et de la région à messire Oddon de Compey, en remerciement de son appui contre l'empire.
L'aspect du fort de Thorens au XIe siècle devait être celui d'un burg montagnard. Il était perche sur l'emplacement de la butte de sable glaciaire, circonscrite entre les deux rivières. Son plan irrégulier suivait le haut des escarpements. A l'Est, ceux-ci n'étant pa assez prononcés, les hommes durent creuser de larges et profonds fossés, bordés d'épaisses palissades faites de troncs d'arbres emmêlés. La défense principale était constituée par le donjon carré, figure formidable et sauvage tournait le dos au val âpre et farouche, fermé par la dentelure des sommets II surveillait de sa lourde masse le pont entretenu et la voie serpentine. Elle poudroyait lorsque passaient les marchands aux charriots lourdement charges. Ses murailles étaient renforcées aux angles de platebandes en pierres de taille frustes, elles encadraient les ouvertures longilignes des meurtrières, éclairaient d'un jour parcimonieux les pièces du rez-de-chaussée.
Leurs plafonds voûtés étaient faits d'un appareillage de pierres oblongues noyées dans un mortier de chaux grasse, très dur.
Le sol rugueux, grossièrement pavé, laissait percevoir une ouverture centrale plongeant dans le sous-sol, au fond duquel gisait l'onde noire d'un puits. Les Seigneurs de Compey le firent combler par la suite pour en faire une citerne en cas de siège, une prison-oubliette en temps de paix.
Les fortifications étaient complétées aux angles par des tours irrégulières, compagnes du donjon, dont l'actuelle restante en est le témoin.
Le portail d'entrée, formé d'une triple archivolte romane, était fortifié par une tour ronde. Il conduisait au rez-de-chaussée vers des salles aux voûtes surbaissées, percées au-dessus d'ouvertures : les conduits de fumée. Ces conduits de fumée témoignaient de grands feux auprès desquels les hommes d'armes reposaient.
La fin du millénaire, grâce à un climat chaudement sec, engendra une croissance économique essentiellement agricole.
Peut être cette époque vit-elle l'édification des trois digues sous le château. Celles-ci étaient faites d'énormes accumulations de galets diluviens, de pierres roulées extraites de la rivière Fillière. Elles s'opposaient à sa marche, en déviaient le parcours. Elles transmuaient de façon imperceptible l'eau par le sable, les débris organiques flottants par l'humus. Elle faisaient naître une plaine alluvionnaire au sol léger, celui-ci facilitait le travail superficiel de la charrue en bois.
Jadis les anciens y voyaient l'œuvre d'une fée de la montagne, dans son tablier elle emportait des charges de pierres, les laissaient choir avec grand fracas, à l'entrée de la vallée.
Cette période plus clémente dut inciter, parmi la houle sombre des noirs sapins, l'essartage. L'essartage enfanta la précieuse chrysolite des prairies où l'herbe grasse, richement fleurie, fut soigneusement recueillie, elle était vitale pour le seigneur et le paysan. Des hommes entreprenants s'établirent dans les montagnes. Ils se taillèrent dans les combes de Champlaitier, des Glières et de Nerval, de vastes pâturages. Nomades, sans cesse sur les sentiers qui parfois déchirent la paroi abrupte, ils accomplissaient les travaux de la vallée, tout en soignant le bétail sur les hauteurs.
Un petit chemin reliait le village de Thorens à Usillon, centre de ces montagnards dont une partie hivernait. La voie surplombant une source abondante, passait auprès de la Pierre Taillée où une petite grotte hébergeait la fruste statue en bois de la Vierge. Elle protégeait le voyageur attardé, contre la vision fantastique du veau à deux têtes, qui se dissipait à son approche dans un rire effrayant.
Les seigneurs de Compey.
Originaires de Compois situé dans le canton de Genève, les seigneurs de Compey possédaient à une époque très reculée (carolingienne) un château comprenant église, habitations et fort.
Cette période primitive est extrêmement pauvre en documents écrits. Elle permet de les voir apparaître de temps à autre mentionnés en bonne place, à titre de vassaux importants comme témoins ou garants, sur les actes des Sires de Faucigny et des Comtes de Genève.
Ces actes sont rédigés en belle écriture gothique sur de magnifiques parchemins, scellés de sceaux imposants.
Des lueurs mettent en évidence certains personnages : Albert de Compey, sénéchal du Genevois en 1228. Gérold, official et prévôt de l'église de Genève en 1256.
Girard voit, dans son enfance, Thorens ravagé par une bande soldatesque durant l'été 1242. Il prend part, en 1287, avec ses hommes d'armes et arbalétriers au siège du château de l'Ile de Genève, mené par le comte Amédée V de Savoie. Par la suite, il est nommé gouverneur, puis vidomne de la ville, cette charge lui confère les pouvoirs d'un juge d'instruction et ceux d'accusateur public.
Peut-être lui doit-on le donjon circulaire destiné à renforcer les défenses du château de Thorens à sa partie la plus faible, c'est à dire vers le fossé, à l'opposé du donjon carré. Il présente une épaisseur égale faite d'un appareillage en pierres de taille sur toute sa hauteur. Les archères sont largement ébrasées afin de permettre au jour de pénétrer et aux archers de s'assoir. Elles sont particulièrement allongées pour avoir un tir plongeant, disposées judicieusement aux divers étages, elles alternent et battent par leur champ de tir le pourtour de la défense. Au rez-de-chaussée un cul de basse-fosse, le ratier, sert de cachot en temps de paix. Il contient les provisions, les projectiles en temps de guerre. Un escalier coudé facilite la défense d'un étage à l'autre.
Le chevalier Guillaume, seigneur de Thorens, obtint en 1339 par sa mère Isabelle de Lucinge et une transaction avec sa famille, la haute et importante fonction de sénéchal de la ville épiscopale de Lausanne. Cette situation élevée fait de lui le vassal de l'évêque, l'administrateur de ses biens et revenus. Il préside la frappe de la monnaie, exécute les jugements prononcés par le bailli. En contre partie, l'évêque l'associe à la perception de droits divers d'échutes, de prébendes. Guillaume de Compey gouverne, au nom du comte de Genève Amédée III, le Grésivaudan. Il en est le bailli, cumulant les attributions administratives, militaires, financières et judiciaires. Il sert en 1352 de caution, avec ses châteaux de Thorens et de Saconnex, à l'accord entre le comte de Genève et le Roi de France Jean le Bon. Accord par lequel Amédée III s'engage à rendre hommage au dauphin et l'évêque de Genève à lui remettre son château de Peney. L'évêque Alamand de Saint-Jeoire, furieux d'être dépossédé, excommunie le comte et ses vassaux pendant 26 ans !
Philibert participa au drame sanglant de Thonon, en 1462. Philippe, comte de Bresse, fils du duc de Savoie Louis Ier, se laissa influencer par un parti d'extrémistes xénophobes. Ils étaient exaspérés par les procédés levantins dont usait l'entourage ducal. Ce parti accusa le Grand Chancelier de Savoie, Jacques de Valperga et Jean de Varax, le Maitre d'Hôtel de la duchesse Anne de Chypre d'être les responsables de tous leurs maux. Le premier, d'avoir discrédité le comte de Bresse, d'être l'agent du Roi de France Louis XI. Le second d'être l'âme damnée de la duchesse et l'exécutant de la camarilla chypriote.
Le comte de Bresse, s'adjoignant le Bâtard de Rochechouart et les nobles les plus virulents, se rendit au château de Thonon où résidait la Cour.
Les conjurés se saisirent du chancelier, et Compey de son fils. Le bâtard poignarda aussitôt le Maitre d'Hôtel Varax. Tous se retirèrent, non sans avoir pillé les appartements. Le comte de Bresse emmena Valperga à Morges, obligea les procureurs de rendre une sentence expéditive, tortura sa victime en la désarticulant et la fit noyer dans le lac Léman. Le Roi de France Louis XI, très irrité de la mort du Grand Chancelier de Savoie, son ami, attira le comte de Bresse et sa suite, à laquelle appartenait Philibert de Compey, dans un piège. Le prince resta captif au donjon du château de Loches. Les gentilshommes furent emprisonnés au château de Chinon pendant quatre ans.
Philibert de Compey termina son existence comme gouverneur du Comté de Nice où il fut aimé et apprécié.
Jean de Compey, seigneur de Thorens, cousin du précédent, né en 1410, illustre son époque faite de chevalerie ostentatoire, à la fois formaliste et fastueuse.
Il est appelé par le duc Louis 1er de Savoie aux fonctions diversement importantes de chambellan, grand bailli du Genevois, commandant en chef des armées. Son caractère altier le fait exceller aux exercices de guerre : la chasse et le tournoi.
Durant l'été 1443 le duc Louis 1er, son épouse, Philippe comte de Genevois et une nombreuse suite, dont Compey fait partie, se rendent à Châlon auprès de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Parmi les fêtes de réception organisées en l'honneur des savoyards figure un pas d'armes, (variété de tournoi) à Marcenay, près de Dijon où le seigneur de Thorens se distingue.
Ce pas d'arme a pour décor la frondaison majestueuse d'un chêne séculaire au tronc orné de tapisseries armoriées; au pied, un héraut bigarré clame les noms et qualités des seigneurs combattants. Les tribunes dominent le tumulte humain, fourmillement de têtes dont les voix, les rumeurs mêlées aux frissons des bannières, font un bruit d'essaim.
Voilà les cavaliers superbes, dressés debout sur leurs étriers, ils échangent de hautains défis tout en assurant leur lance valeureuse. Le chroniqueur décrit le seigneur de Thorens :
"armé, heaume et paré de grands plumars, vêtu d'une longue robe d'orfèvrerie bordée de perles, monté sur un destrier couvert de cendhal blanc semé des lettres d'or A-U-F, suivi de ses pages mis à sa devise : robe rouge à manche bleue.
Plusieurs lances furent rompues par les habiles jouteurs, mais le combat à pied fut plus remarquable et plus rude".
Duels d'hommes en habits de fer, sombres, ardents, ils luttent d'un furieux acharnement avec l'épée à deux mains, la hache aux éclairs meurtriers. L'acier mord le fer, les étincelles jaillissent sous les coups, le sang coule, ils sont enivrés d'une sombre démence. Le duc et sa cour applaudissent, mettant fin au combat.
La chasse est une autre activité importante car on imagine aisément ce qu'elle apporte de plaisirs quotidiens parmi les solitudes montagnardes. Les antiques forêts, peuplées d'une multitude d'animaux grands et petits, y entretiennent une vie active, quoique discrète. Dès les brumes matinales évaporées, les chiens, compagnons fidèles, s'élancent à la quête du gibier. Les valets partent reconnaitre l'endroit où le cerf se dissimule parmi les taillis, cherchent les traces laissées. L'animal identifié, c'est l'approche des cavaliers précédés par les meutes de chiens courants dont les limiers dirigent la quête. Débusqué, le cerf tire parti de ses admirables facultés de ruse, d'astuce pour égarer les chiens, les distancer par sa ténacité, sa vitesse. Enfin, impassibilité hautaine ou ruée désespérée, lorsque la bête est sur ses fins. " L'hiver, les cerfs sont paralysés par une masse de neige qu'ils s'efforcent de repousser avec leur poitrail. On s'approche, on les égorge. Tandis qu'ils brament sourdement on les abat et on les emporte avec de grands cris de joie ".
D'autres fois, durant les fortes chaleurs de l'été, la résistance du sanglier diminue. Les chiens font jaillir la bête noire de sa bauge, elle fonce toutes soies hérissées, l'œil en feu, d'une ruée brutale. Alors l'habileté du chasseur, son courage s'expriment de façon éclatante par l'estocade mortelle portée avec la lance. Avant les premières neiges, dans le but de faire disparaître ses traces, l'ours hiverne dans une tanière aménagée parmi les hautes futaies résineuses, sous un tronc d'arbre séculaire et déraciné. Il veille, les sens en alerte. Dès que le chasseur guidé par son chien approche, il s'élance au dehors, ayant localisé ses agresseurs grâce à son oufe et son odorat remarquables. Atteint par l'épieu il dresse sa masse imposante, enserre le chasseur dans l'étreinte formidable de ses pattes musculeuses armées de griffes redoutables.
Avec le règne de Louis I, duc de Savoie, on aborde une période décadente. Sa femme Anne de Lusignan, duchesse de Chypre, belle et impérieuse, se substitue à lui dans la direction du duché.
La mode s'exalte pour l'île lointaine, les levantins arrivent par groupe familiaux prêts à exploiter les territoires commerciaux.
L'entourage ducal est balloté entre des factions impudentes et rivales.
Jean de Compey, habile courtisan, sait intéresser la duchesse Anne et être une puissance dans la camarilla qui la soutient. Cette situation privilégiée exacerbe l'hostilité des seigneurs savoyards jaloux. Elle porte à son paroxysme. L'animosité de la maison de Menthon contre celle de Compey. Ces derniers avaient gagné un long procès fertile en péripéties, en retentissantes disputes relatives au partage du château de Montfort, en 1413.
Par une chaude journée d'août 1446, la duchesse, Yolande, sœur du roi Louis XI et la princesse Annabelle d'Ecosse accompagnées de leur suite gagnent les hauteurs du Salève. Le seigneur de Thorens y avait disposé le déploiement des cavaliers porteurs de faucons à tête encapuchonnée, posés sur le poing ganté de cuir. A un signal, les oiseaux de proie prennent leur essor haut dans le ciel. Leur regard perçant et scrutateur détecte le gibier, l'ayant perçu ils se laissent tomber sur la proie maintenue par les serres puissantes ; elle reçoit le coup de bec fatal qui l'assomme prestement et il la porte au cavalier, leur maître et ami. Le soleil darde ses rayons, la chaleur est accablante pour l'organisateur, hôte attentif au déroulement complexe de cette forme de vénerie. Il se rafraîchit quelques instants dans une chaumière, y est rejoint par un groupe de cavaliers dans lequel il reconnait ses implacables ennemis.
Par ruse, il les détourne et rallie les nobles dames. Les conjurés furieux d'avoir été joués, se précipitent sans égard pour les altesses et la cour assemblée, ils l'assaillent à coup d'épée et le laissant à terre grièvement blessé.
Profitant de la stupéfaction provoquée, ils s'enfuient promptement en Dauphiné.
Jean de Compey est nommé en 1448, lieutenant général et commandant en chef des armées de Savoie. Il reçoit mission de secourir la ville de Milan dont la province a été mise à mal par la république de Venise. Les troupes vénitiennes commandées par les prestigieux et célèbres condottieri Colleone et Sforza auront peu de difficultés à vaincre les savoyards moins bien commandés et plus éloignés de leurs bases.
Défait près de Verceil avec quatre cents cavaliers, il est fait prisonnier. Il se libère par une forte rançon. Cela l'oblige à remettre sa charge de sénéchal à l'évêque de Lausanne, Georges de Saluces. Ce dernier lui verse en échange 1000 ducats d'or, en 1450.
Ainsi les seigneurs de Compey garderont la sénéchalie de Lausanne pendant 110 ans.
Le dauphin Louis, futur roi Louis XI, épouse Charlotte de Savoie au grand déplaisir de son père, le roi de France Charles VII. En Savoie, nous assistons à une lutte entre le père et le fils par seigneurs interposés : le dauphin soutient Compey, le roi les seigneurs savoyards agresseurs et exilés. Tour à tour ces derniers sont un danger pour leur ennemi ou réciproquement.
Dès 1451, par des raisons de sécurité et d'économie, le seigneur de Thorens entreprend des aménagements défensifs dans sa forteresse. Il érige une tour carrée, face au donjon circulaire, une poterne ou porte fortifiée les précède, elle domine le fossé qu'enjambe un pont levis. Le tout est relié par des chemins de ronde permettant aux soldats de circuler sans péril à l'intérieur des fortifications. Ces dernières sont disposées de manière à ce que l'attaquant ne soit nulle part à l'abri des flèches ou des projectiles. Les archères du donjon circulaire sont complétées par des canonnières formées d'un trou rond pour le tube de l'arme, d'une fente verticale pour la visée et l'échappement des gaz.
Ces améliorations permettent des tirs horizontaux avec les canons, plongeants avec les arbalètes. D'autre part, la conversion en argent des prestations en nature d'autrefois, permet au seigneur de rémunérer des soldats de métier, permanents et spécialisés, tel les arbalétriers, canonniers, fabricants de poudre, de boulets. La qualité remplace le nombre. Avec des fortifications modernisées, il économise des hommes de plus en plus coûteux.
La considérable Maison des princes de Luxembourg se divise en plusieurs branches. L'une d'elle intéresse Thorens. Il s'agit de la famille du prince Pierre Ier, comte de Saint Pol. Elle se distingue par ses immenses besoins pécuniaires.
Sa fille Hélène épouse le fils de Louis Ier, Janus, comte de Genevois. Celui-ci inféode tous les biens de Jean de Compey, sous prétexte que ce dernier refuse de lui rendre hommage. Il constitue par des procédés analogues d'importantes donations à la princesse son épouse.
Leur fille Louise, est fiancée dès l'âge de six ans à son cousin germain paternel, une dot de 60 000 florins d'or est promise. Devenue veuve, elle épouse son oncle maternel François 1er de Luxembourg, vicomte de Martigues. La somme promise par son père n ayant jamais été versée, le second mari en réclame le payement, celui-ci est ramené après transaction à 40 000 florins assignés sur le Pays de Vaud. Cela fait du couple des seigneurs importants, ils obèrent ainsi les finances de la Savoie.
Leur fils François II, gouverneur-général, épouse Charlotte de Brosse, comtesse de Penthièvre. Elle lui apporte des biens considérables situés dans l'ouest de la France. Les biens savoyards sont gérés par des châtelains amodiataires, tel son Maître d'Hôtel François de Sales qui avait pouvoir de traiter jusqu'à concurrence de 7 000 écus.
Après cette parenthèse sur le rôle des princes de Luxembourg, revenons en arrière afin de suivre le cours des événements auxquels Jean de Compey fut mêlé.
Jacques de Savoie, comte de Romont, fils de Louis Ier est ami intime de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Il est le protecteur du Pays de Vaud que lui disputent ses voisins bernois, bientôt victorieux occupants. Il reprend les territoires perdus, ceux-ci devant servir à Charles le Téméraire de bases à sa marche sur Berne.
Arrêté dans sa progression, c'est le siège de Grandson par le duc lui-même venu à la tête de ses troupes. Jean de Compey et une centaine d'hommes d'armes servent dans ce corps d'armée. Ils ont mission d'attirer, par une feinte, l'armée bernoise massée à Morat, vers la rive orientale du lac de Neuchâtel et Yvonand. C'est là qu'il est surpris par la sombre défaite bourguignonne du 2 mars 1476.
Huit jours plus tard, il arrive à Vevey où il répartit ses soldats dans les villages voisins. Dépité parla défaite il est particulièrement insolent, hautain et méprisant envers les habitants. Ceux-ci lui imputent l'incendie de Saint Saphorin, village de pêcheurs des rives du lac Léman.
Dès le 14 mars le Duc de Bourgogne établit son camp près de Lausanne, où ses 20 000 soldats sont souvent en maraude. La tension entre les riverains du lac et la soldatesque est grande.
Vers Pâques, le seigneur de Thorens, accompagné de son fils Philibert, dit le borgne, se querelle avec Yblet de Gerdilli, le vice-châtelain de Vevey. Altercation dangereuse car Philibert de Compey donne un coup d'épée à la tête du magistrat, pendant qu'un comparse lui enfonce son poignard dans la cuisse. Le malheureux réussit à s'esquiver chez le banderet, les assaillants n'osant aller achever leur victime au domicile du chef de la police municipale ! Ce dernier accompagné des délégués du capitaine général, de bourgeois armés, poursuivent les agresseurs enfuis vers les vignobles étages sur les hauteurs. L'expédition prend tournure de battue, elle s'achève par la découverte du seigneur de Compey caché dans un épais fourré du Mont Pèlerin.
Resté seul à lutter contre ses poursuivants, ses compagnons l'ayant abandonné lâchement, il redescend vers Vevey encadré par deux archers au milieu des huées, des paysans menaçants, on le frappe. D'un ultime effort il s'échappe et court de toute ses forces. Rejoint, il roule à terre avec son poursuivant, prend son épée avec laquelle il lui fait une profonde blessure au crâne. Le blessé, d'un revers de pertuisane atteint Jean de Compey à la tête et l'achève d'un coup de dague. Le seigneur de Hauteville le fait porter dans l'église de Corsier pour l'inhumer.
Philibert, dit le borgne, fut le cruel acteur de l'attaque menée contre le vice-châtelain. Il continua la lutte contre les seigneurs de Menthon, âmes de la conjuration des nobles savoyards qui avaient décidés la disparition de son père. Le seigneur Bernard de Menthon devait se rendre à Genève, conférer avec l'évêque Jean-Louis de Savoie pour mettre fin aux agissements du dit Philibert. Par un cruel hasard, chemin faisant, les deux hommes se rencontrèrent le 15 septembre 1479. S'étant abordés, ils se devinèrent. Compey avait pénétré les desseins de son ennemi, il alla trouver l'évêque ; celui-ci confirma l'entretien. Ivre de fureur, il s'élança, à bride battue avec une suite armée sur les traces de Bernard de Menthon. La petite troupe rencontra ce dernier, accompagné de son frère, dans une forêt où tous deux cheminaient. Instantanément les meurtriers les entourèrent. Malgré leurs supplications, un homme à la robe rouge, au capuchon baissé enfonça sa dague par deux fois dans le corps de l'infortuné qui rendit l'âme.
Par sa séance solennelle du 20 novembre 1479, le conseil souverain condamna Philibert de Compey et ses complices à mort, à la confiscation de tous leurs biens au profit de la couronne. La seigneurie de Thorens fut, par la suite, donnée en investiture à la princesse Hélène de Luxembourg, épouse du Duc Janus de Savoie.
La tradition veut que Philibert, fugitif, proscrit, soit mort en 1496.
Jean de Compey, héritier naturel de son frère assassin du seigneur de Menthon, était privé de sa succession par le jugement de confiscation et l'investiture faite à la princesse Hélène de Luxembourg. Il obtint, en 1496, du comte Philippe de Bresse, une révision de la sentence, la fit signifier à Louise de Savoie, vicomtesse de Martigues. Ce fut le début d'un long procès poursuivi encore après sa mort en 1512.
Au début du XVIe siècle, le duché poursuit sa décadence, amorcée quelques années plus tôt, malgré les ambitions de Charles III. Celui-ci ne peut se soustraire aux conséquences de la guerre entre la France et Charles Quint, ni maîtriser l'accession à l'indépendance du peuple des villes épiscopales de Genève et Lausanne.
Depuis les défaites de Charles le Téméraire, les armées suisses confédérées, l'influence bernoise grandissait. Ainsi Fribourg se rendit indépendant de la Savoie grâce à son alliance avec Berne. Les patriotes genevois et lausannois se rendirent compte qu'un traité de combourgeoisie avec Berne Fribourg neutraliserait l'évêque et le duc dans ars ambitions respectives. Un certain nombre de patriotes s'établirent temporairement à Berne et à Fribourg. Ils tâchèrent d'intéresser les autorités au sort des villes épiscopales en grand danger d'être absorbées par le duc Charles III de Savoie, rendu furieux de leurs velléités d'indépendance politique. Ces démarches aboutirent, en 1526, à un traité solennel de combourgeoisie, conclu en l'absence de l'évêque. Le duc fut contraint de réhabiliter les patriotes fugitifs, de suspendre les peines édictées contre eux à Chambéry.
Parallèlement à l'émancipation politique, l'affranchissement religieux se poursuit. L'humanisme chrétien remet en question les dogmes par une nouvelle étude biblique et évangélique conduite r les philosophes Lefèvre d'Etaples et Erasme. Leurs idées sont, par la suite, radicalisées par l'allemand Luther et le zurichois Zwingli. Berne accueille, soutient les évangélistes réformés, par son entremise une communauté évangélique se forme à Genève parmi les patriotes fugitifs et leurs adhérents.
Philibert de Compey, seigneur de Thorens et dernier du nom, était en relation très amicale et suivies avec la plupart des patriotes genevois dont il partageait et appuyait les idées politiques auprès de Pierre Girod, secrétaire d'Etat à Berne et aussi de son parent Dietrich d'Englisberg, avoyé de Fribourg, un des principaux artisans du traité de combourgeoisie.
Ce dernier obtint d'une sentence prononcée par le duc Charles III, en octobre 1526, à Chambéry, la restitution totale des biens de son cousin, le seigneur de Thorens. Cela mettait fin au procès commencé en 1496 par son père contre Louise de Savoie, vicomtesse Luxembourg Martigues.
Il entreprend durant trois années d'importants travaux de réfection dans le château de Thorens, dévasté et abandonné pendant quarante sept ans. Acquis aux idées des patriotes genevois ses amis, il sera comme eux un fidèle du réformateur Guillaume Farel, le disciple de l'humaniste Lefèvre d'Etaples. Peut être connut-il le réformateur par l'entremise de leur ami commun Pierre Girod, le secrétaire d'Etat à Berne ? Ce dernier avait suggéré à Farel de s'installer, dès 1526, comme maître d'école sous le pseudonyme d'Ursinus, à Aigle.
Farel protégé par Berne vint à Genève accompagné de disciples pour prêcher et répandre les nouvelles doctrines. Par l'entremise de Pierre Girod et de Sébastien de Diesbach, avoyé de Berne, le seigneur de Thorens acquit une maison, contigüe à celles d'autres adeptes, où les évangélistes se réunissaient et entendaient les prédications des réformateurs Viret et Farel.
L'agitation à Genève allait grandissant, des conflits éclataient parmi la population.
Le soir du 4 mai 1533 des bagarres produisirent une mêlée générale au chevet de la cathédrale. Le chanoine fribourgeois Werli, armé, blessa de nombreux antagonistes. Poursuivi, isolé, percé de nombreux coups d'épée, il est achevé par une dague enfoncée à la jointure de sa cuirasse. Cet assassinat fit grand bruit à Fribourg où la famille Werli avait de l'influence.
La famille de Sales
« La famille de Sales parait être originaire de La Roche-sur-Foron. Elle dût, de bonne heure, donner son nom à un hameau de la paroisse de Thorens où se développe la maison-forte devenue le château de Sales ».
La première filiation authentique remonte à Jordain, mentionné dans le testament de son fils en 1468. A cette date ce fils, Jean de Sales, est vidomne de la ville de La Roche. L'année suivante il vend sa charge au comte de Genevois Janus. Ses successeurs sont les vassaux des seigneurs de Compey, leurs proches voisins, en leur nom vidomne de Thorens.
Christophe de Sales est le premier à s'affranchir de ce service en devenant page de la princesse Hélène de Luxembourg, épouse de Janus comte de Genevois. Par la suite, il est écuyer de leur fille Louise de Savoie. Lorsque celle-ci se marie avec son oncle François Ier de Luxembourg, vicomte de Martigues, Christophe est promu Maître d'Hôtel, (chef de la maison du vicomte de Martigues). Il bénéficie de ses libéralités en se faisant octroyer divers biens dans la vallée de Thorens. Il était en 1505 amodiataire, c'est-à-dire concessionnaire de terres en échange de prestations particulières, (sorte de fermier) dans l'abbaye d'Entremont. Trois fois il se maria, les deux dernières avec des veuves. Sa vie s'harmonisa entre la dévotion et le soin des choses temporelles.
Son fils Jean épousa la fille d'une de ses belle-mère. Il continua la fonction paternelle auprès de François II de Luxembourg, gouverneur-général de la Savoie. Ce dernier lui accorda la permission d'élever moulins et battoirs sur les rivières Flan et Filière en 1550.
Ce fut l'essor d'une animation industrieuse. Grâce aux nombreux barrages faits d'énormes troncs de sapins entremêlés, l'eau tombait en larges cascades tumultueuses, canalisées par des biefs vers les moulins aux roues énormes, tournant inlassablement dans un nuage de gouttelettes irisées par le soleil. Du moulin au toit de chaume verdi par les mousses, s'échappait de façon ininterrompue la chanson grondante des meules écrasant les grains des céréales, les cliquetis régulier des cames actionnant les battoirs à chanvre et les stridulations des scies. En hiver cette inlassable activités se pétrifiait, les glaces pendaient en gigantesques stalactiques.
Ces industries rudimentaires, jointes à la profonde sagesse administrative, le dévouement aux intérêts des princes de Luxembourg, portèrent leurs fruits. François de Sales, seigneur de Boisy, le père de François le Saint, put acheter en 1559, terres, châteaux, village, juridiction de la seigneurie de Thorens au prince Sébastien dont il était le Maitre d'Hôtel. Cette fonction consistait à être procureur constitué à différentes dates pour la vente de terres en Savoie. Les sommes recueillies servaient à payer la forte rançon exigée pour la libération du prince, fait prisonnier à Thérouanne, en 1553.
Son frère Louis épousait demoiselle Janine de Guasquis. Etaient de la fête une foule de gens nobles, parmi lesquels on distinguait le seigneur de Sionnaz et sa fille unique Françoise dont la grâce candide fit sensation. La noce finie l'inattendu arriva : François avait observé l'aimable petite, son charme l'avait conquis.
Peu après il alla au château de Boisy (Groisy) faire une visite à la famille de Sionnaz. Il confia son sincère désir d'avoir un jour pour femme la petite Françoise. Encouragé par un accueil étonné mais cordial, il conta son histoire.
Né au château de Sales en 1522, il était devenu page-écuyer de son parrain le prince François de Luxembourg-Martigues, gouverneur de Savoie.
En 1544, officier de cavalerie, il prenait part dans les armées royales de François 1er (celui-ci avait conquis la Savoie en 1532) à la guerre contre l'empereur Charles-Quint allié au roi Henri VIII d'Angleterre. François de Sales ne put cacher qu'il s'était comporté en brave. En effet il avait résisté, à la tête de sa compagnie, dans la place forte de Saint-Dizier-sur-Marne, assiégée par des armées impériales, pendant quarante jours. Par la suite le siège de Landrecies lui offrit l'occasion de semblables exploits. Après quelques missions au service des princes de Luxembourg, resté célibataire, il s'était retiré au château familial de Sales. Il ne conservait de sa vie militaire qu'une fonction : celle de capitaine de garnison à Annecy.
Il fut agréé par les seigneurs de Boisy. Françoise, fillette de huit ans, resta dans sa famille quelques années encore.
Le mariage eu lieu au printemps 1566. La petite mariée vint habiter le château de Sales, en compagnie de Louis de Sales, son beau-frère et son épouse.
Ces derniers avaient leurs appartements ornés de précieuses tapisseries de haute lice, des Flandres, dont les scènes bibliques représentaient l'histoire de Tobie.
Les bordures de chaque tableau représentent des oiseaux, des animaux symboliques sont disposés parmi les feuillages. Aujourd'hui ces tapisseries servent d'écrin aux précieuses reliques de Saint François de Sales. Grâce à leur restauration faite par les Monuments Historiques en 1976, le visiteur peut apprécier cet admirable travail de tissage : majestueux pour l'ensemble, merveilleux pour les détails.
L'été 1566, le duc de Nemours, son épouse Anne d'Este, vinrent à Annecy. La ville leur réserva une brillante réception, la noblesse leur rendit hommage. Pour accroitre la solennité, son cousin germain, le duc de Savoie Emmanuel-Philibert, autorisa l'exposition du Saint-Suaire à Notre Dame de Liesse. Devant cette relique insigne la jeune épouse fit le vœux de consacrer à Dieu son premier né.
L'année suivante, le 21 août 1567, naissait François de Sales (1567-+1622), le futur saint évêque, glorieuse illustration de la Savoie, l'une des figures les plus charmantes de son époque.
Cette figure est trop connue pour que nous en retracions une vie détaillée. Le visiteur déjà au fait de l'œuvre, des reliques, les contemplera tel un bouquet fleuri, dont la disposition nous est décrite dans l'introduction à la Vie Dévote. Cette variété de bouquet nous guidera dans la visite.
Son père, le voulant sénateur de Savoie, l'envoya couronner ses études à la célèbre université vénitienne de Padoue où il se rendit accompagné de son frère Gallois. Deux documents particulièrement émouvants parmi les trésors salésiens marquent son passage.
Son brevet d'immatriculation établi par le recteur de la faculté de droit Fabio Turchi, à son arrivée le 16 octobre 1588. Document d'identité aussi : il y est fait mention d'une cicatrice au sommet droit du front. Le cachet représente l'image du Rédempteur, protecteur des Légistes.
Son diplôme de docteur en droit canonique et civil, forme livret, il est relié en veau fauve ; les plats sont ornés de fers au centre, parmi les arabesques, un médaillon ovale représente le Christ crucifié entouré de la Vierge et du disciple Jean. Le sceau de l'évêque de Padoue, Alvise Cornaro, l'accompagne. Ce fut le 3 septembre 1591 l'examen solennel en latin, présidé par l'illustre Pancirola, recteur de l'université. Le candidat triompha et fut comblé de louanges.
Après son retour de Padoue, son père l'exhortait au mariage et à prendre charge d'avocat. Doucement mais fermement le fils se déroba, soutenu dans son désir d'être prêtre par sa mère et surtout par l'appui résolu de l'évêque diocésain Monseigneur Claude de Granier.
Son père obtenait par faveur exceptionnelle d'Emmanuel-Philibert, duc se Savoie, une patente nommant François de Sales sénateur. A la même époque une occasion se présentait : la charge de Prévôt du chapitre de Saint Pierre de Genève devenait vacante. Charge importante puisqu'elle était suivante de celle de l'évêque.
Les concours nécessaires aux démarches romaines aboutirent rapidement. Le 7 mars 1592 la bulle nominative, les lettres apostoliques scellées par le sceau de plomb (bulla) au chiffre du Pape Clément VIII arrivèrent. Le 12 mai 1593, François de Sales reconnaît la mise en possession de la Prévôté. Il y adjoint la formule du serment par lequel il promet son soutien, avec toutes ses forces, à l'Eglise romaine.
Le visiteur se penche et s'interroge, ces écrits ne sont-ils pas le témoignage, le résumé de l'œuvre salésienne ?
Devenu diacre, dès l'automne il passa à l'action en fondant la confrérie des Pénitents de la Sainte Croix.
Prieur de cette association religieuse, sa première œuvre d'apostolat, il la voulait, un camp de prière, un bastion de vie fervente, un attrait des Réformés aux pouvoirs de l'Amour Divin, un rempart des vertus sociales.
François de Sales est ordonné prêtre par son évêque Monseigneur Claude de Granier le 18 décembre 1593 et il entreprend sur les ordres de son évêque la mission du Chablais.
Il reçoit la consécration épiscopale dans l'église de Thorens le 8 Décembre 1602.
François de Sales est ordonné prêtre par son évêque Monseigneur Claude de Granier le 18 décembre 1593.
Divers objets rappellent au visiteur le rôle sacerdotal.
Son calice, somptueuse pièce d'orfèvrerie, est orné de scènes symboliques finement burinées.
Sur l'extérieur de
la coupe, dans des réserves ovales, on voit les quatre Evangélistes accompagnés
de leur emblème. Sur le pommeau son représentés quatre Docteurs de l'Eglise. Le
pied, à six lobes, présente trois chérubins encadrant le Crucifix, les
instruments de flagellation et ceux du Calvaire.
Les burettes avec son plateau ovale, gravées à ses armoiries, servent à la purification.
Son bréviaire, gros in folio à
reliure de veau, porte une dédicace imprimée par Edmond Auger. Elle est datée
du 25 janvier 1587, adressée au très chrétien Henri troisième, roi de France et
de Pologne.
L'année
suivante, en 1593, il entreprend, sur ordre de son évêque, la mission du
Chablais. C'est dans la petite chapelle aux jolies fresques romanes du château
des Alinges, aujourd'hui haut-lieu salésien, qu'il célébrait sa messe avant de
s'élancer vers ses courses apostoliques.
Trois documents liés entre
eux sont relatifs à la cure du Petit-Bornand dont François de Sales devait être
bénéficiaire :
II s'agit de la Bulle du Pape Clément VIII : institution de François de Sales à la cure du
Petit-Bornand, écrite sur parchemin le 13 septembre 1597.
Puis une bulle du même Pape, donnant commission à François de Chissé, vicaire général
et officiel de Claude de Granier, évêque de Genève, pour la mise en possession
de la dite cure. Parchemin du 13 septembre 1597.
Enfin acte de mise en possession de la cure,
papier daté du 27 juillet 1598.
Le frère du
curé précédent mit opposition, porta l'affaire devant le tribunal éclésiastique
où il eut raison. François de Sales saisit alors l'autorité civile qui lui
donna gain de cause. Le Sénat de Savoie s'entremit, arbitra le différend,
celui-ci se termina par une transaction.
En 1599, Monseigneur de Granier l'envoie à Rome auprès du Pape. Il y retrouve son frère Louis venu là faire
ses études littéraires et juridiques. Le Pape Clément VIII, après examen
théologique, proclame François de Sales coadjuteur c'est-à-dire suppléant de
Claude de Granier avec le titre d'évêque de Nicopolis (ville de Bulgarie sur le
Danube). Le visiteur a connaissance de cette promotion épiscopale par une bulle
du Pape Clément VIII accompagnée de la formule de serment inscrite sur un grand
parchemin.
L'année 1601 réunit les huit enfants autour de François de Sales, vénérable gentilhomme, éteint pieusement au milieu des siens.
Durant son séjour à Paris auprès du Roi Henri IV il signe,
comme nouveau chef de famille, l'achat de la seigneurie de Thorens à Marie de
Luxembourg, duchesse de Mercœur, le 8 juin 1602.
Il reçoit la consécration épiscopale dans l'église de
Thorens le 8 décembre 1602.
Durant la cérémonie du sacre il eut la vision de la Sainte-
Trinité. Cet événement est illustré de nos jours par la belle mosaïque du chœur
de l'église paroissiale, commandée en 1937 par le curé-archiprêtre M. Pagnod.
Son sceau épiscopal présente au centre ses armoiries frappées du croissant, des étoiles, entourées de l'inscription : « Francis de Sales. Eps. et princeps. Genebennen ». Une poignée de buis, brunie par les ans, permet de le saisir.
Signe de son activité sacramentelle d'évêque, le visiteur voit deux
grémials : l'un en velours de Gênes, l'autre de soie violette. Ces pièces de
tissu étaient posées sur ses genoux lors des confirmations.
Trois mitres sont exposées :
L'une de soie brodée, ornée de perles est celle avec laquelle il
fut enterré.
Une autre en drap d'or
porte une attestation d'autenticité de Mgr. Rey. Enfin une troisième en drap d'argent, ornée de
deux miniatures en médaillon, brodées de soie.
Il se recueillit quelque jours au château de Sales auprès de sa mère avant d'aller à Dijon en 1604. Il célébra sa messe dans la chapelle, où Dieu le transporta d'extase, lui inspira de fonder l'ordre de la Visitation. A cet emplacement, le comte Eugène de Roussy de Sales fit ériger, en 1875 une croix de pierre. Cette croix est abritée par les frondaisons d'un gigantesque tilleul pluri-centenaire, face aux montagnes, à la vallée.
Photos:
- Jimre (2009)
Posté le 29-11-2009 20:24 par Jimre